L'ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Différentes modalités[1]
- Patrick
ROBO -
octobre 2002
http://probo.free.fr/ - patrick.robo@laposte.net
· · ·
Que répondre
à la question : "Qu'est-ce que
l'analyse des pratiques ?"
En examinant
le n° 346/1996 des Cahiers pédagogiques
qui fait référence en la matière et intitulé "Analysons nos pratiques professionnelles", nous y entrevoyons
déjà une diversité de types, de modalités et d'appellations (plus ou moins
contrôlées) d'analyses :
-
L'analyse
en groupe ;
-
L'analyse
didactique ;
-
L'analyse
pédagogique ;
-
L'analyse
de situations ;
-
L'analyse
transactionnelle ;
-
L'auto-analyse
de sa pratique ;
-
L'analyse
par entretien individuel ;
-
L'analyse
de l'action en situation directe ou vidéo-filmées ;
-
L'analyse
à partir du récit qu'en fait un acteur oralement ou par écrit ;
-
Les
Groupes d'Entraînement à l'Analyse de Situations Educatives (GEASE) initiés
dans les années 1980 et "spécialité
montpelliéraine" selon Claude VINCENS[2].
-
Les
Groupes d'Approfondissement Professionnel créés dans les années 1975 par André
de PERETTI ;
-
Les
groupes Balint pour enseignants ;
-
Les
jeux de rôle.
A cette première liste "à la
Prévert" nous pouvons ajouter, avec possiblement encore des oublis, un
certain nombre de dispositifs se réclamant également de l'analyse de pratiques :
-
Les
Groupes de Parole (GP) dont ceux mis en œuvre, par exemple, par Fernand OURY
dans le cadre de la pédagogie institutionnelle (PI) ;
-
Les
Groupes de Soutien au Soutien avec supervision psychanalytique, initiés par
Jacques LEVINE[3] ;
-
Les
Groupes de Formation à l'Analyse de Pratiques Professionnelles (GFAPP) tels que
je les développe ;
-
Les
Groupes d'Analyse de Pratiques Professionnelles (GAPP) développés selon la
démarche des GFAPP par des formateurs s'étant formé et se formant dans ces
derniers ;
-
Les
Groupes d'Analyse de Pratiques Professionnelles (GAPP) développés par Jacques
NIMIER[4] ;
-
Les
études de cas ;
-
La
métacommunication avec les élèves (PERRENOUD, 1994) ;
-
Les
Séminaires d'Analyses de Situations de Communication (SASCO) mis en œuvre par
Eric AUZIOL ;
-
Les
simulations ;
-
La
vidéoformation ;
-
L'observation
mutuelle ;
-
L'entretien
en visite formative ;
-
L'instruction
au sosie initiée par ODONNE pour les ouvriers de chez FIAT en 1970 ;
-
L'auto-confrontation
(croisée) ;
-
L'entretien
d'explicitation inspiré par VERMERSH (1994) ;
-
L'écriture
clinique (PERRENOUD, 1996a, p. 200 ; CIFALI, 1998b, p. 293-313)
-
Les
histoires de vie ;
-
L'expérimentation
et l'expérience (PERRENOUD, 1996a, p. 204-205)
-
L'analyse
du travail ou de l'activité dans la perspective tracée en particulier par Yves
CLOT ;
-
etc.
En complément
de ces énumérations certainement non exhaustives, il est à noter que suivant
les approches sont convoquées diverses terminologies-typologies d'analyses,
ainsi : l'analyse institutionnelle,
l'analyse systémique, l'analyse organisationnelle, la psychanalyse, la socio-psychanalyse, la socio-analyse,
l'analyse transactionnelle,
l'analyse interactionnelle,
l'analyse didactique, l'analyse clinique…
Des différences sont
notamment liées aux objectifs divers
attribués à l'analyse de pratiques : objectifs d'élucidation, de connaissance,
de remédiation, d'approfondissement, d'aide au changement personnel, de formation, de recherche, de transformation,
d'intervention, voire objectif thérapeutique ou encore d'évaluation...
Ces différences peuvent
également être liées au fait que l'analyse
est davantage centrée sur le métier,
ou sur la profession, la personne, un groupe, une situation,
une (des) pratique(s), la tâche,
une activité, une discipline, un système, une institution,
une organisation, un problème, des comportements, les relations,
la pédagogie…
La diversité
montre donc la complexité de ce concept d'analyse de pratiques ; d'aucuns
diront le "compliqué de la chose".
A y regarder de plus près, nous pouvons percevoir/repérer qu'une pratique
peut être :
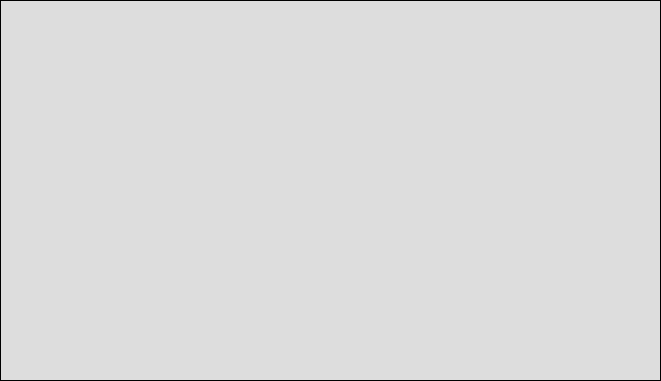
traitée par
son auteur/acteur ou[5] par un
tiers extérieur
observée ou décrite,
racontée
de manière impliquée ou
non-impliquée par
oral ou par écrit ou par image
l'objet d'un récit ou l'objet d'un discours
(développement)
abordée en faits (ce qui est) ou abordée en phénomènes (ce
qui est perçu)
traitée in vivo ou traitée
in vitro
traitée hic et nunc ou traitée
a posteriori
perçue subjectivement ou perçue
objectivement
traitée consciemment ou traitée inconsciemment
analysée individuellement (auto) ou analysée
collectivement (socio)
avec
des pairs ou des experts / ex-pairs
gérée en micro-analyse ou gérée en
macro-analyse
etc.
Sans nous engager dans de la
taxinomie, nous pouvons également distinguer deux grands ensembles / catégories
d'analyses :
-
l'analyse
de l'action située ;
-
l'analyse
de l'action sur récit,
et deux
grands ensembles / catégories de modalités :
-
l'analyse
individuelle (seul ou avec l'aide d'un autre acteur) ;
-
l'analyse
groupale
Avec du temps, cet
inventaire rapide mériterait ordonnancement et explicitations, identification
de similitudes et de différences, repérage des valeurs et champs théoriques de
référence, clarification des objectifs, présentation des modalités de mise en
œuvre… Certains praticiens-chercheurs-auteurs[6] ont entrepris ce travail
mais aucun encore, semble-t-il, de manière synthétique. Ce début de recherche
ne prétendra pas à une synthèse mais plutôt à placer des jalons pour une quête
de savoirs plus savants.
Pour tenter d'éclairer ce
concept, et sans vouloir présenter une approche historique, je fournirai
succinctement quelques repères complémentaires[7] liés à l'inscription dans
le temps de l'analyse des pratiques traitée en groupes.
Il semble que cette démarche
ait commencé avec les travaux de Enid et Michael BALINT dans les années
1950/1960 à Londres d'abord dans le cadre du Family Discussion Bureau avec des travailleurs sociaux puis à Tavistok clinic, sous forme de groupes
de recherche-formation pour des omnipraticiens sous le contrôle d'analystes,
avant d'aboutir à ce que l'on nomme les "groupes Balint" fonctionnant sur des études de cas (case work) librement commentés autour de
trois axes : la relation médecin-malade, le contre-transfert du médecin envers
le patient, le rôle du leader.
Quelques années plus tard
(1973), J. LEVINE démarre ce qui deviendra les Groupes de Soutien au Soutien
(GSAS) définis ainsi :
"Appareil
groupal ayant valeur de lieu de ressourcement, de décentration et de contre-espace,
permettant un changement de perception. C'est un lieu de parole où peuvent se
dire les blessures narcissiques du praticien et de l'élève ; c'est un lieu de
l'intelligibilité de ce qui alimente les conduites qui font problème ; c'est un
lieu de recherche du modifiable sur le plan pédagogique et relationnel ; c'est
un lieu où chacun peut opérer une conscientisation de son mode de
fonctionnement professionnel." (LEVINE J.,
MOLL J., 2000, p. 29)
Ces groupes
fonctionnent jusqu'à maintenant en présence d'un psychanalyste et suivant une
méthode en quatre temps, à partir de l'exposé d'un participant volontaire.
A la même époque (1975)
et également dans le milieu de
l'éducation, André De PERETTI s'inspirant de BALINT mais aussi de Carls ROGERS
et recherchant une formule ne nécessitant pas la présence d'un expert,
développe ce qu'il nomme des "groupes
d'approfondissement professionnel" (GAP). Ceux-ci sont tournés vers la
résolution de "problèmes professionnels" à partir de l'exposé d'un
participant suivant un protocole en quatre temps.
Dans cette période des
"Groupes et séminaires Balint-enseignants" ont vu le jour (par
exemple : IUFM de Versailles, GRAPIEN[8], GRPI[9]…) s'inspirant bien entendu
des principes du père fondateur dont celui, consistant à utiliser "la horde des frères plutôt que le père
primitif" (BALINT, 1960, p. 327) tout en permettant à chacun d'avoir
"le courage de sa propre bêtise".
Nous pouvons penser ici en particulier aux travaux et écrits de Francis IMBERT
(1992) initiateur de tels dispositifs.
Dans les années 1980/90,
venant de l'Université de Toulouse Le Mirail[10], avec un détour par les
CEMEA[11], apparaissent autour de
Claude VINCENS, Alain LEROUGE et de leurs collègues[12], dans le département des
Sciences de l'éducation de l'Université Paul Valéry de Montpellier, les Groupes
d'Entraînement à l'Analyse de Situations Educatives (GEASE) dont l'objectif
principal est, à partir de l'exposé d'un participant volontaire, de s'entraîner,
"au sens
sportif ; on s'entraîne, c'est la place faite à l'essai, à l'erreur, au geste
nouveau pour voir, au geste imité de l'autre, au geste décomposé. C'est se
laisser entraîner, se faire entraîner, entraîner les autres." (Vincens, Fumat, Porte,
1992, p. 118),
à comprendre la complexité
d'une situation en tant que
"fraction
temporelle de l'environnement passé d'un participant présentant à la fois des
caractéristiques objectives et la façon dont il les a ressenties, la manière
dont il s'est comporté et qu'il rapporte à des fins d'études par le
groupe" (p 26-27) ;
Cette situation est qualifiée d'éducative,
"englobant
aussi bien les situations pédagogiques, d'enseignement, d'apprentissage ou
thérapeutiques." (p. 119).
Dans ces
groupes, l'analyse est menée, sur le principe de l'approche multiréférentielle,
autour de cinq champs : la personne, le groupe, l'institution, le didactique,
la pédagogie (p 7-10) et suivant un parcours en cinq ou six phases suivant les
"variantes" et/ou les formateurs-animateurs.
Dans les années 1990/95, J.
NIMIER (1991) et une équipe de formateurs de l'I.U.F.M. de Reims ont mis en
place des "groupes de suivi"
en formation initiale puis des "Groupes
d'analyse de pratiques professionnelles" en formation continue.
D'autres IUFM (Grenoble, Lyon, Montpellier, Rennes, Strasbourg…) ont cheminé en
même temps et parallèlement sur des voies analogues, mettant en œuvre pour
certains des Séminaires d'Analyse de Pratiques (SAP), des Ateliers de Pratique
Réflexive (APR), des Séminaires Cliniques d'Analyse des Pratiques Educatives
(SCAPE), des Séminaire d'Analyse des
Pratiques d'Enseignement et d'Apprentissage (SAPEA)…
J'oserai ici, humblement,
signaler l'émergence des Groupes d'Entraînement puis de Formation à l'Analyse
de Pratiques Professionnelles (GEAPP devenus GFAPP) que j'ai initiés en
1995/96, dans le cadre de l'Inspection
académique de l'Hérault.
Pour clore hic et nunc cette approche chronologique
j'ajouterai, de manière anecdotique (ou symptomatique), que le Ministère de
l'Education Nationale, désireux de développer à grande échelle l'analyse des
pratiques dans la formation de ses personnels a mis en œuvre, pour la première
fois, deux séminaires importants à cet effet :
-
"L'analyse des pratiques
professionnelles" organisé par la Direction des personnels
administratifs, techniques et d'encadrement (DPATE) les 18 et 19 octobre 2001 à
la Grande Motte. Objectif : sensibiliser les responsables et formateurs de ces
personnels à l'utilité de l'analyse des pratiques à travers les GEASE.
-
"L'analyse des pratiques professionnelles et
l'entrée dans le métier" organisé par la Direction de l'enseignement
scolaire (DESCO) les 23 et 24 janvier 2002 à Paris[13]. Objectif :
sensibiliser les responsables (de formation) académiques à l'importance et à la
nécessité d'accompagner les enseignants débutants (mais aussi les autres) par
cette démarche.
L'analyse
de pratiques apparaît bien comme un concept polysémique, polymorphe et se
déclinant en poly-pratiques. Une clarification s'avère donc nécessaire,
clarification qui devrait être le souci premier de tout formateur désireux de
mettre en œuvre une telle démarche.
· · ·
"Le concept commun d'analyse qui, selon le cas, connote plus ou moins la psychanalyse, me semble signifier bien plus qu'une opération de connaissance : une production de sens et une ouverture à agir." Gilles FERRY "
· · ·
Eléments bibliographiques
CIFALI M., «Clinique et écriture : une
influence de la psychanalyse dans les sciences de l''éducation», in HOFSTETTER
R. et SCNEUWLY B., Le pari des sciences
de l'éducation, Raisons édiucatives
n° 1-2, Bruxelles, De Boeck Université, 1998, b.
IMBERT F., «Groupe Balint et formation des pédagogues», Pratiques de formation (Analyse), Paris, Université Paris VIII, n° 23/1992.
Nimier J., Bonicel M.F., Gaillar d P., Ghesquière M., Mandrille A.. Une expérience de formation d'enseignants à l'analyse de la pratique dans le cadre de l'I.U.F.M. de Reims (Ronéo), Ed. I.U.F.M. de Reims, 1991
Perrenoud, P., La formation des enseignants entre théorie et pratique, Paris, L’Harmattan, 1994.
Perrenoud, Ph., «Le travail sur l'habitus dans la formation des enseignants. Analyse des pratiques et prise de conscience», in Paquay, L., Altet, M., Charlier, É. et Perrenoud, Ph. (dir.), Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ?, Bruxelles, de Boeck, 1996a, p. 181-208.
VERMERSCH P., L'entretien d'explicitation en formation initiale et en formation continue, Paris, ESF, 1994.
Vincens
Cl., Fumat Y., Porte J., Analyser les Situations Éducatives, Montpellier : Publications
de l’Université Paul Valéry, département des sciences de l’éducation, 1992.