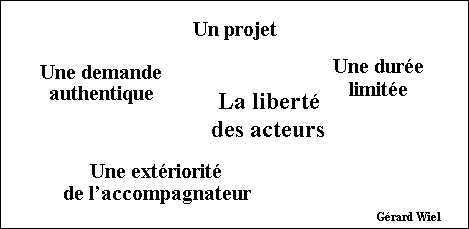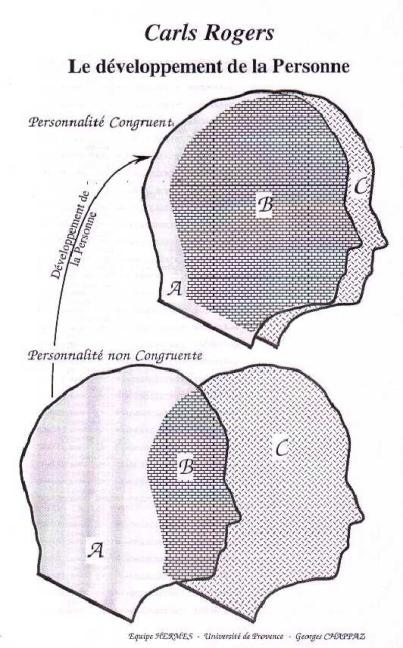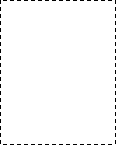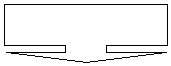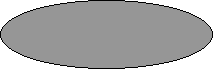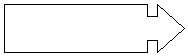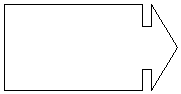Plan Académique de Formation
Stage du 24 au 28 mars 2003-09-23- MEZE (34)
▲
▲ ▲
SOMMAIRE
Fiche d'identité du stage 3
Ouverture du stage 92
La grille du stage 211
Le partage des
responsabilités 253
Le concept d'accompagnement
- principes et réalités 277
Dispositifs d’accompagnement
dans l'académie de Montpellier - année scolaire 2002 – 2003 387
Compte rendu de
l'intervention de G. Chappaz 527
Accompagnement et formation
- Retour sur le travail de groupes Georges CHAPPAZ 618
L'analyse de pratiques professionnelles -
panorama - 779
Le G.F.A.P.P. - un dispositif
d'accompagnement des C.P.C. - 910
Grille G.F.A.P.P. 34
(version 10) 1032
Notes sur "les phases
5" des quatre GFAPP vécus 1047
Mise en œuvre des groupes de projet 1162
Fiche-guide de présentation des groupes de projet 1181
Les groupes de projet 1192
Comment
démarrer un groupe d'accompagnement de T.1 ? 1195
La
zone proximale de rencontre : comment favoriser son développement ?. 1284
Comment
démarrer un groupe d'analyse de
pratiques ?
Comment présenter le GAPP ?. 1371
Comment
demarrer un groupe d'analyse de
pratiques ?
Construire la première demi-journée avec un GAPP. 1385
Traces… des quoi de neuf ? 1489
Les cahiers de roulement 1531
Fiche guide pour cahier de
roulement 1723
Bilan sur les contenus de la
session de mars 2003 1785
Bilan sur l'organisation de
la session de mars 2003 1851
Bilan et suivis de session 1932
Bilan distancié 2044
ANNEXES 2175
Le concept d'accompagnement 2181
L'analyse de pratiques
professionnelles - un dispositif de formation accompagnante - 2370
Témoignage :
présentation du dispositif GAPP auprès des T1 (situation factice) - Lozère 2566
Construire des savoirs et
des compétences pour l’enseignement à travers l’interaction professionnelle 2688
Glossaire 2776
Citations du stage 2815
Bibliographie du stage 2874
Les sigles du stage 2907
Le violet 2956
C'était le repas
coopératif de lundi 2986
Liste des participants -
adresses professionnelles 3036
Notes personnelles 3065
p
p p
PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION
Années 2002-2003 &
2003-2004
FORMATION DE FORMATEURS DU
PREMIER DEGRE
«Former des formateurs d'accompagnateurs de T1 et T2 du 1er degré»
|
1° - LES RESPONSABLES
DE CETTE PROPOSITION
- le (ou les) responsable(s)
scientifique et pédagogique :
ROBO
Patrick ; Chargé de mission Formation 1er degré - I.U.F.M. -
MONTPELLIER
Tableau des intervenants (interventions ponctuelles)
|
NOM Prénom
|
Qualité
|
Rôle
|
|
Mireille
CIFALI
|
Université
de Genève
|
Conférencier
|
|
Jean
DONNAY
|
Université
de Namur
|
Conférencier
|
|
Georges
CHAPPAZ
|
Université
d'Aix en Provence
|
Conférencier
|
|
ROBO
Patrick
|
Chargé
de mission Formation 1er degré - I.U.F.M. -
|
Conférencier
|
Tableau des formateurs (le formateur encadre en continu la formation)
|
NOM Prénom
|
Qualité
|
Rôle
|
|
ROBO
Patrick
|
Chargé
de mission Formation 1er degré - I.U.F.M.
|
Responsable
|
|
VIDAL
Michel
|
Conseiller
Pédagogique de Circonscription
|
Co-responsable
|
2° - LA DESCRIPTION
DE L’ACTION DE FORMATION
a/ A quelle priorité
nationale correspond l’action proposée ?
Formation de Formateurs –
Accompagnement des entrants dans le métier
b/ Le public visé :
Formateurs du 1er
degré de l'Académie de Montpellier
- Effectif souhaité : 25
- Autres précisions :
Il sera
demandé à chaque stagiaire de communiquer avant le stage des informations liés
au thème du stage. Ces informations seront communiqués à tous les participants
et pourront servir de base de réflexion durant le stage.
Durant le
stage les participants produiront collectivement un document facilitant les
actions sur le terrain.
c/ Les dispositifs
pédagogiques prévus :
Formation-Action en alternance
(deux sessions et une intersession) avec :
§
Apports d'experts ;
§
Mise en situation-expérimentation d'accompagnement, de
projets, d'analyse de pratiques de formation, d'observation, d'entretien,
d'écriture personnelle ;
§
Mutualisation, échanges de pratiques de terrain ;
§
Formalisation écrite des travaux ;
§
Activités
collectives, de groupes et personnalisées.
Nb : les trois principes clés du
stage seront : Cohérence - Implication - Production.
d/ Les objectifs de
la formation :
§
Permettre à des formateurs du 1er degré
d'appréhender des dispositifs, démarches et techniques conduisant à mettre en
œuvre une "formation accompagnante"
destinée à des enseignants entrant ou non dans le métier.
§
Permettre à des formateurs du 1er degré
d'appréhender des dispositifs, démarches et techniques d'analyse de pratiques
professionnelles ;
§
Permettre à des formateurs du 1er degré de
se mettre eux-mêmes en Réseaux d'entraide et de Formation-Action.
e/ Les résultats
attendus :
1.
Implication des stagiaires, acteurs et auteurs de leur
formation ;
2.
Production d'un document mutualisable ;
3.
Réinvestissement sur les "terrains" respectifs de
stagiaires (effet de démultiplication) ;
4.
Mise en réseau (de préférence par l'Internet) des stagiaires.
f/ Les contenus de la
formation :
1.
L'accompagnement ;
2.
L'analyse de pratiques professionelles ;
3.
La médiation ;
4.
L'échange et la mutualisation de pratiques ; les réseaux
d'entraide pédagogique.
5.
L'Internet : courrier électronique et listes de diffusion
6.
Mise en œuvre de groupes de projet intersession.
3° - LES MODALITES
D’ORGANISATION
Lieu du stage: Centre
Thalassa - 34140 MEZE.
Durée du stage : 2
fois 5 jours en hébergement.
Nombre de sessions : DEUX Répartition des jours : 5
j. en 2003 + 5 j. en 2004
Dates première session : 24 au 28 mars 2003
Liste des documents qui seront adressés aux stagiaires :
-
Courriers préparatoires ;
-
Compilation de textes de référence ;
-
Documents fournis par les stagiaires avant le stage.
-
Bibliographie conseillée avant le stage ;
4° - LES MODALITES
D’EVALUATION
Modalités et dispositifs d’évaluation :
Avant : Recensement des expériences, questionnements,
problématiques des stagiaires sur leurs terrains respectifs d'action.
Pendant : Evaluation formative par méta-analyse du vécu de
formation et bilan de fin de stage.
Après : Questionnaire différé, adressé après le stage sur
les effets de cette formation
5° - REMARQUES
Ø Cette
action de formation ne se déroulerait qu'avec un nombre de participants
supérieur ou égal à 12.
Ø Si
le nombre de candidatures dépassait 25, il conviendrait de procéder à une
sélection équitable entre les différents départements de l'Académie.
p
p p
- Patrick
ROBO & Michel VIDAL -
BIENVENUE
Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à MEZE. Nous nous
retrouvons à une vingtaine pour ce stage de formation de formateurs inscrit au
Plan Académique de Formation 2002/2003.
Dans le contexte du PAF actuel son acceptation et sa mise en œuvre
n'ont pas été si simple qu'il peut y paraître. Mais l'essentiel est que cette
action de formation se déroule, ce qui est cohérent avec des besoins repérés
quant à la formation à l'accompagnement des néo-titulaires en particulier.
QUI
SOMMES-NOUS ?
J'ai
demandé à Michel VIDAL qui a participé à plusieurs des stages que j'ai
organisés d'être le co-pilote de celui-ci. Qui est-il ? Je lui laisse le
soin de se présenter :
ÄMichel Vidal : J’occupe actuellement les fonctions de Conseiller Pédagogique de
Circonscription sur le secteur de Montpellier-Nord,Montpellier-Ouest, secteur couvert à 80% par
la Zone d’Education Prioritaire. Je suis chargé plus particulièrement de l’E.P.S. et cela depuispresque
dix ans. Auparavant, j’ai enseigné, pendant dix ans aussi, dans les écoles
d’application de Montpellier, en ZEP puis en centre ville. J’ai commencé ma
carrière à la périphérie de Montpellier avec un passage en classe unique.
Au
début des années 90, j’ai doublé cette expérience pratique d’un temps de réflexion
à l’université. Une licence puis une maîtrise en Sciences de l’Education m’ont
amené en 1995 à la rédaction d’un mémoire traitant de la professionnalisation
de la fonction d’enseignant du 1er degré : « De
l’instituteur au professeur d’école ».
De mars 99 à mars 2000, j’ai
participé au dernier stage du PNF, dirigé par Patrick, sur le thème du
« CPC et l’accompagnement des personnels débutant avec des publics
difficiles particulièrement en ZEP ». Depuis, sensibilisé à l'APP, je me suis intégré au
GFAPP de l'Hérault pour me former à l'analyse et à l'animation, puis j'ai fait
démarrer dans la circonscription un GAPP pour les T1.
Patrick
m’a proposé d’être à ses côtés aujourd’hui, ce que j’ai accepté avec
l’intention de vous faire partager l’enthousiasme que j’ai retiré de ma
précédente participation au
stage dit "de Mèze".
Comme
vous l'avez vu dans l'annonce du stage, j'en suis le responsable.
Ä Patrick Robo : Qui suis-je ? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas…J'occupe
actuellement la fonction de Chargé de mission formation de formateurs à l'IUFM
de Montpellier.
Auparavant
j'ai été Conseiller en Formation Continue auprès de l'Inspecteur d'Académie de
l'Hérault à Montpellier, après avoir été conseiller pédagogique auprès de l'IEN
Adjoint à l'I.A., et travaillant sur la Z.E.P. de Montpellier.
Avant
cela, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en zones sensibles comme
Instituteur spécialisé en classe de perfectionnement et dans un regroupement
d'adaptation, praticien de la pédagogie Freinet, puisant aussi le sens de ma
pratique dans la pédagogie institutionnelle et la pédagogie coopérative.
J'ai
été, pendant plusieurs années, responsable national de l'ICEM et responsable de
revues d'échanges pédagogiques.
Mon
itinéraire de militant pédagogique m'a permis de côtoyer différentes approches
et sensibilités éducatives, entre autres de l'UFOLEP à l'A.G.S.A.S. en passant par l'ICEM, l'OCCE, les C.R.A.P.…
Ce
stage-ci de Formation de Formateurs n'est pas le premier que j'organise
toujours sur la configuration en deux semaines séparées par une intersession.
Au plan national, j'ai eu le plaisir d'en organiser trois sur le thème de
"L'individualisation et la
personnalisation des apprentissages", deux sur le thème de "L'éducation civique" et un sur
"Le CPC et l'accompagnement des
personnels débutant avec des "publics difficiles", particulièrement
en ZEP". Au plan académique j'en ai déjà organisé un sur ce dernier
thème et tout récemment j'organisais le stage qui continue cette semaine à
Montpellier avec pour intitulé "Maître Formateur d'adultes".
Par ailleurs, certains le savent pour y avoir participé, j'ai développé des
actions de formation à l'analyse de pratiques en groupe à travers le dispositif
"GFAPP" sur lequel nous aurons l'occasion de travailler cette
semaine.
Pour
information, je viens de démarrer une thèse en Sciences de l'Education autour
de la problématique liée à ce que je nomme "une didactique de l'Analyse de
Pratiques Professionnelles".
Certains ici le savent, il nous arrive souvent de faire référence à
cette phrase extraite du livre de Jean DONNAY et Evelyne CHARLIER, Comprendre
des Situations de Formation (Ed. de Boeck) : “Si le métier de formateur
recelait des solutions miracles qui fonctionnaient à tous les coups, on le
saurait !”. Nous y restons attachés et malgré notre pratique /
expérience de formation d'adultes, nous ne prétendons pas être des experts qui
apportent des réponses "clé en main".
"Construire ensemble" est pour
nous un principe fondamental. Partant de là, nous considérons que chaque
formation d'enseignant, de formateur, devrait, comme l'éducation, se bâtir avec
les différents acteurs concernés. Placer l'élève au centre du système et placer
les "en formation" au cœur de leur formation personnelle avant
de pouvoir dire "personnalisée".
C'est la démarche que nous vous proposons ici.
Nous tâcherons donc de construire ensemble à Mèze.
Nous savons tous ici que la mise en œuvre d'un tel principe de
formation n’est pas facile et qu’elle requiert, la mise en commun des problématiques
et expériences des uns et des autres et qu'elle requiert aussi implication de
chacun.
L’organisation de ce stage devrait permettre d'aller dans ce sens...
organisation dans laquelle nous vous proposerons à chaque participant de
prendre en charge quelques responsabilités, afin, d’être, ensemble, plus
efficients.
Reprenant Mireille CIFALI, nous dirons que la
formation relève de l'Humain et
qu'elle n'est pas que transmission de connaissances et de techniques. Nous
référant encore à elle, nous dirons aussi que monter une action de formation
est toujours un rendez-vous avec l'énigme.
C'est un pari que nous vous
proposons de gagner ensemble.
Durant ce stage nous serons tous les deux
organisateurs, animateurs, intervenants et même accompagnateurs (quatre des
facettes du métier de formateur) et si vous n’y voyez aucun inconvénient, nous
adopterons entre nous le tutoiement.
Le groupe ici présent
est constitué de Conseillers Pédagogiques de Circonscription, de Maîtres
Formateurs, de Directeurs d'Ecoles annexes ou d'application. Certains ont déjà
participé à un premier stage sur le thème de l'accompagnement, certains ont
participé et/ou animé des groupes d'analyse de pratiques professionnelles.
D'autres vont découvrir de nouvelles approches de ces concepts, découvrir aussi
le type d'organisation et de formation de ce stage. L'hétérogénéité nous
accompagnera donc et par là nous enrichira.
POURQUOI
AVOIR A NOUVEAU PROPOSÉ CE STAGE AU PAF ?
Ø D'une part, ma
pratique de Conseiller Pédagogique, de formateur et mon parcours de militant,
compagnon pédagogique m'ont souvent permis de rencontrer, voir et entendre des
collègues, enseignants et/ou formateurs qui, dans certaines situations, étaient
en réflexion, dans le doute, parfois en difficulté, surtout quant ils avaient à
faire à des publics qu'ils qualifiaient de "délicats", voire de
"difficiles"… et qui demandaient de l'aide. Je me suis trouvé
moi-même dans cette situation à certaines occasions tout au long de ma
carrière.
Ø D'autre part, l'évolution du recrutement des P.E. et de
la Formation Initiale, l'état de la
Formation Continue, les injonctions et textes ministériels me
laissent encore penser qu'une réflexion et une formation sont nécessaires pour
aider, dépanner et accompagner les collègues enseignants qui débutent ou non,
en difficulté ou non.
J'ai en même temps la faiblesse de penser que la formation continue des
enseignants du 1er degré, quand elle est de type
"classique", sous forme de conférences y compris pédagogiques et/ou
de stages "parenthèses" (3 jours, une semaine, 3 semaines…), parfois
(souvent ?) inscrits dans le transmissif et l'applicationniste ne suffit plus
pour répondre aux besoins et attentes de ces enseignants surtout lorsqu'ils
rencontrent ou sont en difficulté eux-mêmes. Les "Ya qu'à", les
"Il faut", les "Vous devriez", les "bons
conseils" (toujours de bon sens)… ne sont plus toujours opérationnels.
Ø Par ailleurs
l'évolution de la fonction et des missions du Conseiller Pédagogique ou du
Maître Formateur, et les réflexions auxquelles j'ai pu participer à ce sujet
m'incitent à penser que nous avons encore aujourd'hui à travailler sur la
professionnalisation de ces métiers… la simple obtention du CAFIPEMF, autrefois
du CAEA, (certificats reconnaissant une aptitude) ne suffisant pas à garantir
les compétences nécessaires à l'exercice de ces fonctions. (Le CAFIPEMF me
paraît aujourd'hui non cohérent avec le référentiel de compétences qui
pourrait, devrait être celui du C.P.C. ou du Maître Formateur du XXIe
siècle.s
Ø Par ailleurs encore,
les informations que j'ai pu glaner relativement à "l'accompagnement
des T1" dans notre académie, mais aussi dans d'autres académies, font
apparaître que l'application de cette mesure ministérielle, que je trouve très
judicieuse sur le fond, n'est pas si simple que certains ont pu le croire et
qu'elle ne provoque pas toujours les effets escomptés, mettant parfois certains
formateurs, certains "accompagnateurs" dans des situations
professionnelles inconfortables.
Ce sont ces raisons majeures qui m'ont conduit à proposer à nouveau un
stage de formation de formateurs sur le thème de l'accompagnement.
QUELLE
FORMATION DANS CE STAGE ?
Pour nous, un stage du P.A.F. est une situation de rencontre de formateurs,
d'enseignants, de praticiens, de chercheurs... pour échanger, réfléchir et
construire de la formation pour soi, avec et pour les autres.
Le choix d'un stage en hébergement est lié au
constat d'efficience et d'intensité de formation dues à ce type d'ingénierie,
constat pointé dans tous les bilans effectués lors de stages analogues
précédemment organisés… et non pas, comme le disent certains contempteurs avec
un sourire au coin des lèvres, pour aller se dorer une semaine au bord de
l'étang de Thau.
Nous savons que les pratiques d'accompagnement
(dirons-nous à l'issue de ce stage de "formation accompagnante"
?), et que les formations à ces pratiques sont peu développées alors que le
terme d'accompagnement fleurit de plus en plus dans les écrits officiels,
n'étant plus seulement réservé, pour ce qui nous concerne, à "l'accompagnement scolaire" ou à
"l'accompagnement des innovations".
Nous sommes, ou serons, tous ici directement
interpellés par l'institution, et par des stagiaires, par des enseignants sur
le terrain, qui sont demandeurs d'un accompagnement. Ce qui pose encore des
questions :
® Comment leur répondre ? Que leur proposer ?
® Que leur montrer ? Que leur offrir ?
® Quelles démarches ? Quelle formation ?
® Etc.
Nous pourrons, pendant ce stage, apporter nos points
de vue et nos expériences en la matière ; nous accueillerons et partagerons la
pratique, la réflexion, la recherche de praticiens, de chercheurs, de
praticiens-chercheurs, de formateurs-réflexifs... Nous pourrons mettre en
commun des difficultés mais aussi des réussites vécues.
Dans ce cadre et pour cette première session, nous
travaillerons avec Georges CHAPPAZ de l'Université d'Aix-en-Provence,
enseignant, formateur, praticien, chercheur, qui a été à l'initiative, avec
Monique LAFFONT, d'une Université d'été sur le thème "Accompagnement et
formation".
Pour cette session, j'avais sollicité mes amis
Mireille CIFALI et Jean DONNAY. Ils m'avaient donné leur accord, mais, compte
tenu des aléas liés à la mise en acte de la formation des formateurs du 1er
degré dans notre académie (suspension pendant un moment de ces actions par
l'administration), ils n'ont pu au dernier moment répondre favorablement à ma
demande ayant pris d'autres engagements.
Pendant ce stage, nous pourrons ensemble, chercher
quelles pratiques de formation, d'accompagnement, proposer, suggérer, mettre en
œuvre.
Pendant ce stage (proposé à l'administration
en deux sessions avec une intersession), nous n'apporterons
peut-être pas toutes les réponses aux questions qui se posent, mais nous
tâcherons d'organiser l'apport du plus grand nombre de réponses possibles.
Quoi qu'il en soit nous nous inscrirons dans un
projet de mise en acte et de démultiplication de cette formation et nous
placerons ce stage sous le triple signe de :
La cohérence –
L'implication – La production
Avec le souhait que chacun ici ne soit pas
simplement agent mais qu'il se
constitue acteur et même auteur de sa formation, selon la
terminologie évoquée par Jacques ARDOINO.
LA
FICHE D'IDENTITÉ DE CE STAGE.
Rappelons d'abord son intitulé initial :
«Former des formateurs
d'accompagnateurs de T1 et T2 du 1er degré»
Ses objectifs :
§
Développer
des ressources au service de l'accompagnement.
§
Produire
des documents mutualisables au service des accompagnateurs.
Ses contenus :
§
Concept
d'accompagnement.
§
Analyse
et élaboration de stratégies, dispositifs, techniques et outils
'accompagnement.
Le dispositif
pédagogique
:
Formation-Action en alternance (deux sessions et
une intersession – 2ème session en 2004) avec :
§
Apports
d'experts ;
§
Mise
en situation-expérimentation de projets, d'analyse de pratiques de formation,
d'observation, d'entretien, d'écriture personnelle ;
§
Mutualisation,
échanges de pratiques de terrain ;
§
Formalisation
écrite des travaux ;
§
Activités
collectives, de groupes et personnalisées.
MAIS, compte tenu des évolutions et de la réalité
des terrains, entre la date de dépôt d'une action de formation et sa
réalisation, des ajustements ont été nécessaires et apportés à la lumière des
échanges que nous avons pu avoir en amont du cette session, ce qui conduit à la
"grille" de travail que nous vous avons déjà adressée pour la
semaine.
Notre nouvel intitulé devenant donc :
«Former des formateurs à l'accompagnement de T1, T2, Tn du 1er degré»
D'ores et déjà, je nous souhaite un bon stage.
p
p p
|
|
LUNDI 5
|
MARDI 6
|
MERCREDI 7
|
JEUDI 8
|
VENDREDI 9
|
|
9H
|
ACCUEIL
|
Quoi de neuf ?
|
Quoi de neuf ?
|
Quoi de neuf ?
|
Quoi de neuf ?
|
|
|
INSTALLATION
|
|
L'APP
|
|
|
|
|
DOCUMENTATION
|
Accompagnement
|
Panorama
|
Travaux des
|
Suite des travaux
|
|
10H
|
|
Et
|
et
partage
|
Groupes de Projet
|
des
|
|
|
|
formation
|
d'expériences
|
|
Groupes de Projet
|
|
10h30
|
DEMARRAGE
|
G. CHAPPAZ
|
P. ROBO
|
|
|
|
|
DU STAGE
|
|
|
|
|
|
10h45
|
Présentations
|
PAUSE
|
PAUSE
|
PAUSE
|
PAUSE
|
|
|
Objectifs
|
|
|
Mise en commun
|
Mise au point
|
|
|
Organisation
|
(suite)
|
Travail des
|
des rravaux des
|
des Projets
|
|
|
Lancement
|
|
Groupes de Projet
|
Groupes de Projet
|
de
|
|
12H
|
Document de stage
|
|
|
|
l'intersession
|
|
|
REPAS
|
REPAS
|
REPAS
|
REPAS
|
REPAS
|
|
14H30
|
|
|
|
|
Finalisation des
|
|
|
Le concept
|
|
|
Mise en pratique
|
projets intersessions
|
|
|
d'accompagnement
|
|
|
et analyse
|
et du document
|
|
|
principes
|
(suite)
|
|
du GFAPP
|
de session
|
|
|
et réalités
|
|
Temps libre
|
M. VIDAL
|
BILAN & SUIVIS
|
|
|
P. ROBO
|
|
|
A. RAMPLOU
|
DE
|
|
16H
|
|
|
|
P. ROBO
|
SESSION
|
|
|
PAUSE
|
PAUSE
|
|
|
|
|
16H30
|
Vers
|
Echange de pratiques
|
|
|
|
|
|
des Groupes
|
Travail
|
Mise
|
|
RANGEMENTS
|
|
|
de Projet
|
des Groupes
|
en pratique
|
PAUSE
|
|
|
17H30
|
Retour & Régulation
|
de Projet
|
du
|
Retour & Régulation
|
|
|
|
Documentation / BCD
|
Documentation / BCD
|
G.F.A.P.P.
|
Documentation / BCD
|
|
|
|
Activités libres
|
Activités libres
|
M. VIDAL
|
Activités libres
|
|
|
|
à l'initiative
|
à l'initiative
|
A. RAMPLOU
|
à l'initiative
|
|
|
19H
|
des participants
|
des participants
|
P. ROBO
|
Des participants
|
|
|
|
REPAS
|
REPAS
|
REPAS
|
REPAS
|
|
|
20H30
|
Activités
|
Activités
|
Activités
|
Activités
|
|
|
|
libres
|
libres
|
libres
|
libres
|
|
|
|
à l'initiative
|
à l'initiative
|
à l'initiative
|
à l'initiative
|
|
|
|
des participants
|
des participants
|
des participants
|
Des participants
|
|
p
p p
|
·
Photocopies…………………..
|
Valérie ; Odile
|
|
·
Intendance……………………
|
Annette ; Dominique
|
|
·
Pauses (café-thé-etc.)………...
|
Laury ; Marie-Thérèse
|
|
·
Responsables du document…..
|
Daniel ; Patrick C ; Maryse
|
|
·
Responsables du Cdrom….…..
|
André ; Jacques R
|
|
·
Bibliographie…………………
|
Claude ; Patricia
|
|
·
Sigles…………………………
|
Jacques C ; Maryse
|
|
·
Gestion Offres / Demandes…..
|
Philippe ; Jean-Louis
|
|
·
Affichage…………………..
|
Sandrine ; Maryvonne
|
|
·
BCD livres/vidéos + magnéto
|
Marie-Thérèse ; Christian
|
|
·
Ordinateurs…………………...
|
André ; Daniel
|
|
·
Magnétoscopes………………
|
Philippe ; Jean-Louis
|
|
·
Rétro-vidéoprojecteur………..
|
André ; Jacques C
|
|
·
Citations……………………...
|
Dominique ; Pierre
|
|
·
Album photo du stage………..
|
Valérie ; Pierre
|
|
·
Feuille de présences……….…
|
Pierre
|
|
·
Cahiers de roulement Acc…....
|
Annette ; Odile
|
|
·
Cahiers de roulement APP…
|
Patricia ; Maryse
|
|
·
Repas coopératif ……………..
|
Odile, Maryvonne, Laury,
Daniel, Maryse
|
|
·
Glossaire……………………..
|
Jean-Louis ; Maryvonne
|
LE CONCEPT D'ACCOMPAGNEMENT
PRINCIPES & REALITES
@
Patricia DENIS
& Marie-Thérèse MASCARIN ?
1.
Préalable
Tous les membres du groupe ont participé à des actions d’accompagnement
de T1 ou de PE.
Le document "Accompagnement et formation accompagnante"
de Patrick Robo (version du 01/03/01 – Cf. en Annexe) a été envoyé aux
stagiaires par mel avant le stage. Ce document a été présenté et commenté par
son auteur durant la séance.
2.
Présentation du concept d’accompagnement
Que recouvre la notion de Concept d’accompagnement ?
- Pour nous stagiaires
3.
LES MOTS CLES
Chaque participant est
invité à dégager 5 mots clés à partir
de
"L'ACCOMPAGNEMENT
C'EST…"
 AIDE...................................... 9[6]
AIDE...................................... 9[6]
ECOUTE............................... 7
ECHANGE........................... 6
CHEMINEMENT................ 4
ANALYSE............................ 4

 REFLEXION...................................... 3
REFLEXION...................................... 3
PARTAGE.......................................... 3
SOUTIEN........................................... 3
SUIVI.................................................. 2
MUTUALISATION .......................... 2
PARTENARIAT................................ 2
CONFIANCE..................................... 2
collaboration,
maturation, prise de recul, durée, outil, proposition.
respect, distance, impulsion,
communication, secret, guidance, co-formation,
réflexivité,
côte à côte, conseil, médiation, interactivité, interactions, construire,
donner et
recevoir, rencontre, soutainement, étayage, sécurité, assistance, recherche.
De façon générale, que
peut-on mettre sous cette notion ?…
4.
L’ACCOMPAGNEMENT...
Une idée neuve en éducation
Une pratique émergente
Un concept fluide, passe-partout
Une nouvelle donne éducative
Un changement de paradigme
Une rupture avec les modèles traditionnels de la
formation
Un nouvelle fonction de médiation
Un nouveau champ de professionnalisation
Une activité multiforme
Etc
5.
Connotations :
suivi, soutien, aide, guidance, conseil, assistance, tutorat, mentorat,
parrainage, médiation, entraide, mutualisation, évaluation formative, mise en
réseau, coopération, compagnonnage, régulation…
6.
Définition de l’accompagnement
de compagnon, lat. pop. companio, celui "qui mange
son pain avec" ;
action d’accompagner, aller de compagnie avec quelqu’un
7.
Accompagner, c’est ...
D'après Mireille Cifali
"Savoir être là",
"être pris dans une énigme",
"être intelligent dans les
situations singulières" ce qui nécessite
des "connaissances extraites des sciences humaines" mais aussi des
"compétences relationnelles".
"Construire des
connaissances à même le vivant".
"Restituer à celui qui est tellement engouffré dans le présent son
rapport à un passé et un futur".
"Etre fiable" et
"accepter l'incertitude".
"Aller avec",
"être à côté de", "donner une place à l'autre".
"Intégrer le fait que l'on
ne peut pas agir et décider à la place de quelqu'un".
"S'éloigner de la prise de
pouvoir qui peut advenir si facilement dans nos métiers".
8.
Les dispositifs d’accompagnement
9.
Typologies d’accompagnement
l'accompagnement pédagogique (dans les dimensions éthiques, éducatives, didactiques,
praxéologiques, etc.)
l'accompagnement psychologique (reconnaissance, encouragement, soutien, valorisation, gratification, etc.)
l'accompagnement matériel (prêt de documents, d'outils, etc.)
l'accompagnement social (intégration à un groupe, travail en équipe, etc.)
l'accompagnement professionnel (aide à une qualification, développement de
compétences, etc.)
l'accompagnement formatif (cf. l'évaluation formative et la zone proximale de
développement professionnel)
l'accompagnement ...
10.
Typologies d’accompagnés
-Un enseignant débutant dans la profession et/ou
dans une pratique pédagogique
- Un enseignant qui
rencontre des difficultés dans l’exercice de son
métier
* celui qui ose
l’exprimer ;
* celui qui n’ose pas l’exprimer ;
* celui qui n’a pas conscience de sa difficulté
- Un enseignant qui souhaite
améliorer, modifier sa pratique
- Un enseignant qui
souhaiterait poursuivre
une recherche
- Un enseignant en quête d’une nouvelle qualification
11.
Démarches d’accompagnement
12.
Quelles dispositions ? Quels dispositifs ?
13.
Quelles compétences pour un accompagnement ?
14.
Cinq repères pour un accompagnement .
15.
Vers une charte déontologique de l’accompagnement
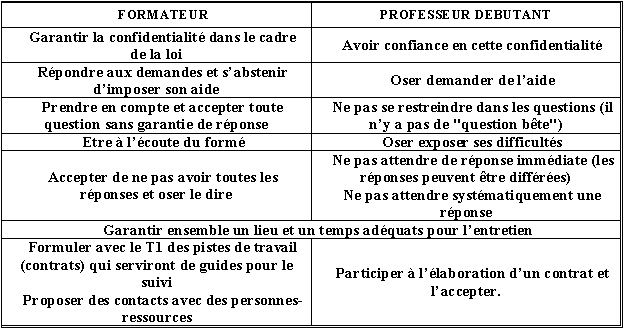
16.
Quels contenus dans l’accompagnement des T1 ?
Approfondissement des
savoirs professionnels abordés en formation initiale :
-
adapter ses savoirs
disciplinaires à la réalité du terrain
-
gérer la classe
Une attention toute
particulière à des compétences liées à l'exercice du métier d'enseignant :
-
analyser l'activité de la classe en relation avec sa pratique pédagogique, en s'appuyant
notamment sur l'analyse de pratiques
-
travailler en équipe disciplinaire ou de niveau
-
identifier et comprendre les caractéristiques du territoire
-
s'approprier une éthique professionnelle
-
prendre en compte l'exigence d'actualisation des savoirs, ainsi que les avancées de la
recherche
Circulaire N°2001-150 DU 27-7-2001
17.
Quelle cohérence dans l’accompagnement des T1 et T2 ?
18.
Et maintenant… ?
dégager des principes : - éthiques
-
institutionnels / structurels
-
pédagogiques / andragogiques
préciser les objectifs
penser les modalités
prévoir des contenus
repérer, constituer des ressources
envisager des formations de
formateurs-accompagnateurs ?
p
p p
Les participants au stage ont été invités, en début se séance, à se
regrouper par départements et à mettre en commun les informations (éparses)
qu'ils pouvaient avoir sur "ce qui se passait dans leur département
quant à l'accompagnement des T1", puis à présenter une synthèse à
l'ensemble.
Force fut de constater une grande hétérogénéité de pratiques entre les
cinq département mais aussi au sein d'un même département, laissant penser
parfois que la dimension organisationnelle a prévalu sur la dimension
formatrice.
1.
Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 dans l’Aude
Même dispositif pour toutes les circonscriptions.
Deux semaines de stage, une semaine à l’IUFM, une semaine en
circonscription. Formateurs CP, PIUMF, IMF.
Six demi-journées d’analyse de pratiques, le mercredi matin entre
septembre et février. Formateurs CP, IMF formés au principe du GAPP.
Une demi-journée de présentation en début de session.
Une demi-journée de synthèse en fin de session. Formateurs, IEN chargé
de la formation continue, CP, IMF.
Une semaine de récupération.
Les T1 ont été divisés en deux groupes :
§ Ceux affectés sur des postes
classiques qui ont eu leur formation IUFM et circonscription au premier
trimestre.
§ Ceux qui étaient sur des
postes particuliers (AIS, décharges…) qui ont eu leur formation au dernier
trimestre.
2.
Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 dans le Gard
Pour les T1 sur des postes fractionnés ou en AIS deux semaines de stage
en début d’année.
Pour les autres T1 :
§ Deux semaines de stage
§ 8 demi-journées sur des
mercredis filés.
Ce qui a marché
-
partir
du référentiel de compétences de PE2 et des priorités dégagées par les souhaits
exprimés.
-
échelonnement
dans la durée (septembre à février)
-
cohésion
de l’équipe d’intervenants (même formation donc cohérence des interventions)
-
prise
de conscience du dispositif
-
essai
de réflexion entre pairs, situation de partage de vécu
-
harmonisation
du processus au niveau du département en entier
-
stage
en circonscription adapté
Ce qui n’a pas marché
-
articulation
formation initiale / formation continue
-
manque
de cohérence dans le calendriers des mercredis filés (regroupés au premier
trimestre, manque de recul par rapport aux pratiques)
-
des
tâches supplémentaires pour les formateurs
-
dans
le cadre des GAPP obligation et non
volontariat
difficulté de la mise en confiance des participants
trop tôt dans l’année, trop lourd, difficile à comprendre
présentation du dispositif
aucun sujet proposé
grille trop contraignante
-
stage
à l’IUFM : contenu non adapté aux demandes des T1
-
problème
de méfiance à propos de la confidentialité à cause des deux rôles du conseiller
pédagogique
-
réticence
à s’engager dans le processus
-
ressenti
du remplacement dans les classes
3.
Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 dans l’Hérault
Dispositif général imposé à toutes les circonscriptions du département
par l’Inspection Académique
a- Deux
journées d’accueil pour le groupe de T1 de chaque circonscription (début du
mois d’octobre). Certaines circonscriptions se sont regroupées pour cette
initiative.
Le remplacement est assuré par des TR Brigades.
b- Deux semaines de
stage avec une distinction liée à la nature du poste
·
groupe
de T1 en charge d’une seule classe pour l’année : 1 semaine du 4 au 8
novembre 2002, 1 semaine du 25 au 29 novembre 2002.
·
groupe
de T1 sur des postes morcelés ou TR Zil/Brigade : 2 semaines consécutives
du 5 au 16 mai 2003.
Le remplacement est assuré par des PE2 en Stage responsabilité (R1 ou
R3).
c- Huit demi-journées filées
(mercredi matin) : l’organisation de ces demi-journées a été laissé à
l’initiative de chaque circonscription.
La formation est prévue par l’équipe de circonscription aidée en cela
par des formateurs IUFM.
Remarque : comme le département est formé de 18
circonscriptions, pour certaines très éloignées les unes des autres, il n’y a
eu aucune harmonisation quant au contenu donné à ce dispositif commun.
Mise en œuvre de l’accompagnement des T1 dans la
circonscription de Bédarieux
* Deux jours d’accueil : animés
par les 4 formateurs (2 CPC + 1 Directeur d’Ecole d’Application + 1 PIUFM)
·
Prise
de contact, présentations des participants, présentation du dispositif
départemental, calendrier
·
Emergence
des besoins (essentiellement : gestion de la classe, de l’hétérogénéité,
du temps et des relations)
·
Elaboration
concertée accompagnants / accompagnés du contenu des stages et des ½ journées
«filées» prenant en compte leurs besoins exprimés.
* Stages : Un
animateur en «fil rouge» (CPC)
·
Pour
le groupe 1 (T1 en charge d’une seule classe pour l’année) : Une semaine,
15 jours d’intersession, une semaine. Projet personnel contractualisé pour
l’intersession
·
Pour
le groupe 2 (T1 sur des postes morcelés ou TR Zil-Brigade) : Le stage se
déroulera en mai, sans intersession.
* Les demi-journées «filées»
·
7
demi-journées ont déjà eu lieu, la 8ème étant prévue courant juin pour un bilan
de l’accompagnement
·
Même
date, même lieu pour les deux groupes
·
En
alternance : un groupe en séance d’APP animée par le CPC, l’autre groupe
en travail thématique avec un autre formateur
* L’accompagnement individualisé
·
Visites
des CPC dans les classes, des entretiens hors de la classe, des observations de
classes «ressources», mise en réseau grâce à un cahier de roulement.
Bilan : le bilan général est
prévu courant juin mais déjà quelques points ont été dégagés.
|
Positif
|
–
avoir un formateur référent tout au long de l’accompagnement ,
–
avoir été associé à l’élaboration du contenu de l’accompagnement,
–
avoir trouvé sa place dans le dispositif,
–
avoir vécu une formation totalement différente de celle de l’IUFM,
–
être considéré comme des enseignants à part entière et non comme des
élèves,
–
avoir eu l’occasion d’observer des collègues dans leur classe et
avoir pu échanger avec eux,
–
avoir pu évoluer dans un climat convivial,
– avoir pu se rencontrer.
|
|
Négatif
|
–
le stage de 2 semaines pour le groupe 2 est placé beaucoup trop tard
dans l’année,
–
l’Analyse des Pratiques Professionnelles pour le groupe 2.
|
4.
Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 dans les
Pyrenees-Orientales
Les T1 sont répartis en deux groupes :
Ø T1 sur poste
« normal »
Ø T1 sur poste spécial (ZEP,
AIS, Regroupement de services…)
A. T1 sur poste
normal :
Ø R3 (1 + 2) au mois de
novembre
Ø Vendredis filés
B. T1 sur poste spécial :
Ø Vendredis filés
Ø R3 au mois de mai
5.
Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 en Lozère
à
44
enseignants Titulaires 1ère année
à
3
circonscriptions : dispositif départemental
à
Formateurs :
les 3 CPC généralistes, 1 CPD EPS, des CPC EPS, 1 CPD AIS, des IMF
Construction de deux groupes (A et B) de 22 T1
Chaque groupe a bénéficié d’un stage de formation continue d’une durée
de 3 semaines réparties de la façon suivante :
Ø Une journée commune (Groupes
A et B) d’accueil : mercredi 18 septembre
(1er mercredi filé*)
à
Accueil
par l’IA de la Lozère, présentation des structures institutionnelles du
département (CDDP, EMALA, IAI, RASED, équipes de circonscription, etc.)
à
Présentation
d’une enquête destinée à établir les attentes et besoins de cet accompagnement
à
Regroupement
des enseignants T1 par circonscription : Questions / Réponses :
Installation dans le poste
Ø Deux semaines
d’accompagnement dans le cadre du PDF
(T1 remplacés par des PE2 en
SR1)
à
Contenus
élaborés suite à la lecture de l’enquête
Ø
Deux
mercredis filés* consacrés à des volets choisis à l’issue des deux semaines de
stages : Points administratifs, Santé et Ecole, Valise pédagogique et
présentation du dispositif de Groupe
d’Analyse de Pratique Professionnelle
(GAPP)
Conduite de l’accompagnement sous forme de 4
ateliers tournants
(5 février et 16 avril)
Ø
Un
dernier mercredi «filé*» programmé en juin pour fermer le dispositif et en
établir
le bilan
* les 8 demi-journées des mercredis filés initialement prévus ont été
«regroupées» en 4 mercredis complets, en raison des contraintes de déplacements
importants inhérents à la géographie du Département. Les enseignants T1 ont
bénéficié d’une semaine de congé en «compensation» de ces 4 jours travaillés.
p
p p
@
Maryvonne
DELON & André FARNOS ?
GEORGES CHAPPAZ est acteur praticien de l’accompagnement, a
participé à plusieurs universités d’été
avec Monique Laffont et participe à des groupes de soutien au soutien (Lévine)
Il est maître de conférences à l’université de Provence
Parcours perso : ingénieur
math physique, CEA, université , où le
plaisir de transmettre prend le pas sur la technique.
1964-1968 : 4ans de frustration et d’isolement professionnel
pendant lesquels son cheminement personnel l’oriente vers des fonctions et des
postures différentes.
1968 : la libération de la
parole et les échanges avec collègues permettent de rompre avec l’attitude
commune de refoulement ou de
cristallisation de ses difficultés.
Cette reconnaissance de ses propres difficultés à travers l’échange de
parole participe à la structure du soi
1970 : La lecture de Carl Rogers lui apporte une révélation
sur le positionnement du sujet, une modélisation des postures et lui permet de
rebondir. Il affine sa compréhension
par un apport de connaissance qui
aboutit à la définition d’un projet.
Les éléments fondateurs de l’accompagnement :
1)
le projet :
Ø Charte/contrat
Ø Dynamique :mise en
corrélation du processus et des attentes explicites ou implicites.
Ø Constitution d’une équipe
Ø objectifs et finalités
(distinguer les deux niveaux)
ex : Objectif : réduction de
l’échec en 1ère année de fac
Finalité : changement
de posture de l’enseignant : abandonner la posture de dispensateur de
parole et de savoir pour proposer à l’autre d’entrer dans une dynamique
d’appropriation et d’apprentissage.
L’autre est il un objet qu’on façonne ? Amener l’étudiant à
s’interroger, accepter que la pensée de l’autre soit productive, quitter cette
image de toute puissance, accepter l’incertitude, ce qui légitime la constitution d’une équipe.
Désir et plaisir d’investir dans le professionnel.
Nécessité de réduire le cours magistral, mettre en place la
confrontation de la parole donc le travail de groupe et la mise en place de
dispositifs d’apprentissage.
Quels sont les éléments de la réussite de cette démarche ?
La fonction contenante
: c’est un étayage réciproque
mis en place (conflit socio affectivo cognitif) dans le travail en équipe
pour structurer la pensée.
Envie de fuir les difficultés, la complexité et l’incertitude (boîte de
Pandore) : le groupe permet de
tenir, d’éviter les régressions.
2)
pas d’accompagnement sans demande
Il s’agit d'aborder
différemment la hiérarchie :
ð quitter sa peau de
formateur, respecter l’objectif de l’autre
ð à partir du dialogue, une
demande non formalisée au départ permet de construire en chemin la charte qui
apparaît au fur et à mesure
ð chacun dit comment il se
positionne dans la relation
ð s’appuyer sur l’assertivité
(capacité à dire JE), idée Rogerienne de la congruence, "capacité à
être présent au monde", se référer à son vécu, exposer à l’autre la
structure de sa personnalité
ð partir de l’impalpable et
construire la demande. "el camino caminente"(A.Machado)
ð abolir la posture
descendante et condescendante
3)
la durée
L’accompagnement doit prendre en compte la notion de rythme, et ne pas
rechercher une optimisation du temps :
ð "donner du temps au
temps"
ð permettre les temps de
latence et de régression
ð permettre l’accommodation
(Piaget) et l’évolution des structures mentales
4)
accompagnement et
extériorité
C’est un aller- retour entre implication - rapprochement et prise de
distance, une pulsation entre relation d’aide et éloignement. L’accompagnateur
doit quitter le pouvoir, gérer sa propre
frustration, pour retrouver l’autre sur les finalités et les objectifs.
Mots clefs de l’extériorité : Je, jeu (au sens de
ludique), jeu (sens mécanique), enjeu
5)
liberté des acteurs
ð liberté de faire des choix,
ð liberté de l’accompagné,
ð ne pas manipuler le liberté
de choix d’autrui
Quelle différence existe-t-il entre le thérapeutique et le
pédagogique ?
|
pédagogique
|
thérapeutique
|
|
centré
sur l’objet
|
centré
sur le sujet
|
|
acte
interaction
stratégie
|
personne
mode
de fonctionnement
utilisation
du rôle du miroir
|
|
miroir
mobile
|
miroir
fixe
|
|
kaléïdoscope
à mille facettes
éclairages
très mobiles et variables
c’est
la personne elle même ce qui ne va pas chez elle
|
|
"L’empathie consiste à percevoir le cadre de
références internes d’autrui avec les composantes émotionnelles qui s’y rattachent
comme si on était la personne elle même mais sans jamais perdre de vue le comme
si… ». ROGERS «Liberté pour apprendre»
Qu’est-ce que ressent l’autre ? ("logique de l’usager")
"Le regard positif inconditionnel" : je te
respecte mais je suis autre.
"La congruence"…
Cette notion a été apportée par Carls Rogers, psychothérapeute. Il
définit toute personne comme étant composée de deux parties :
Ø la structure du soi
(affectivo-cognitive) rejoignant-là Piaget et Lévi-Strauss ;
Ø l’expérience vécue.
Une partie de celle-ci ne fait pas sens pour le sujet, n’est pas
intégrée à la structure du soi. Elle fonctionne comme une besace dans laquelle
il peut puiser.
Conscientiser cette expérience, c’est faire la part des choses, des
liens avec d’autres expériences de façon à obtenir une zone de congruence (B
sur le dessin ci-après) la plus large possible.
Rogers postule que la communication entre deux personnes se situe dans
cette zone.

La congruence…
p
p p
Rappel de la consigne
1. «Que dites-vous après avoir dit
bonjour dans un groupe d'accompagnement qui démarre ?»
2. Produire un guide d’entretien permettant
de présenter l’accompagnant et l’accompagné et d’élaborer un contrat ou une
charte de l’accompagnement.
Démarche du groupe :
Après discussion sur les expériences collectives, l’important est de
commencer en amont avant de définir un projet.
1) Prise de rendez-vous
·
de
l’accompagnant vers les accompagnés
·
ou
hors présence des élèves
2) La rencontre
·
Recueil
des représentations
§
mots
clés pour définir l’accompagnement
§
analyse
de ces mots
·
Elaboration
d’un accompagnement possible et partage à partir de cette analyse
§
comment ?
§
sous
quelle forme ?
Démarche du
groupe :
Choix d’effectuer un travail de présentation
chronologique sur les possibles et non les obligés. Définir la zone proximale
de rencontre (Z.P.R.) en se demandant ce qui est possible et ce que l’on partage.
1) Un temps de présentation
accompagnant accompagné
 au plan
personnel
au plan
personnel
cursus scolaire,
professionnel possibles
volet
social, familial

 cadre institutionnel projet
personnel
cadre institutionnel projet
personnel
2) Projet d’accompagnement
 Construction
Construction
Mise en œuvre d’un projet
Régulation
Démarche du
groupe :
Le groupe s’interroge sur les conditions de
mise en place d’une relation. Le processus est-il similaire dans le cadre de
l’accompagnement d’une personne ou d’un groupe ? Oui, mais selon
différentes techniques de communication.
Guide
d’entretien
1) Mise en confiance
– prise de rendez-vous
par téléphone : dans quel cadre cette rencontre va-t-elle se situer ?
Il s’agit bien d’une rencontre et non d’une visite.
– si possible dans
l’école mais hors de la présence des élèves pour la première.
2) Ecoute de
l’accompagné : un temps pour libérer la parole
3) Echange(s) et partage(s)
Co-construction des règles
du jeu permettant l’explicitation de la démarche et de la posture de
l’accompagnant (jouer avec les règles)
4) Contrat
– Jouer sur les règles
pour les faire évoluer ;
– Revenir sur le
cheminement (échanges, partages) qui vient d’être parcouru ;
– Fixer d’après ce
travail les axes du contrat
5) Cheminement en respectant
les règles préalablement définies (jouer dans les règles).
Démarche du groupe :
Elle met en évidence la difficulté d’élaborer un cadre statique pour
formaliser une dynamique.
Des principes : réversibilité,
continuité, rupture.
– S’identifier, se situer :
donner son nom, son prénom, sa fonction, son parcours professionnel, les
travaux effectués et études menées, les expériences dans l’accompagnement déjà
vécues et les différentes approches (duelles - groupes).
Les maîtres-mots : dynamisme, sincérité,
neutralité, «objectivité», justesse (poids des mots).
– Concevoir
l’accompagnement - contractualiser : à partir d’une co-exposition des
attendus sur le côte à côte professionnel (parole donnée en priorité à
l’accompagné), il s’agira de confronter des «logiques» aux référentiels professionnels,
de dégager une hiérarchie «partagée» d’action et d’intervention.
Les maîtres-mots : reformulation, éclairage,
compréhension commune (sémantique). Priorisation.
– Dégager des modalités
d’intervention : équilibrer les demandes existantes (j’aimerais bien
que cela se passe comme ceci) et le panel d’offres (voilà comment cela peut
aussi se passer).
Les maîtres-mots : opérationnaliser,
diversifier, croiser les regards, dispositifs multiples.
– Durée/Fréquence : préciser
l’échéancier sur la durée mais aussi les temps d’observations des situations.
Les maîtres-mots : prendre le temps,
combien de temps, a-t-on le temps ? quand ? etc.
– Le retour au contrat -
régulation : formaliser les avancées (retour aux référentiels de
compétences et aux priorités dégagées).
Les maîtres-mots : les compétences
développées, les compétences à renforcer, etc.
- Mise en confiance
Ø Prise de rendez-vous par
téléphone : dans quel cadre la visite va se situer
Ø Fixer dans quel cadre
institutionnel se passe la RENCONTRE (plutôt que «visite»)
Ø Rencontre si possible dans
l’école, mais pour la 1ère rencontre, si possible en dehors de la
présence des élèves
- Ecoute
Ø Un temps pour libérer la
parole
- Echange(s) et
partage(s) :
Ø Règles du jeu :
explicitation de la démarche et de la posture de l’accompagnateur (jouer AVEC
les règles)
- Contrat :
Ø Jouer SUR les règles
(évolution)
Ø Revenir sur le cheminement
(échanges, partages) qui vient d’être fait
Ø Fixer d’après ce travail des
axes de travail pour la rencontre ultérieure
- Cheminement
Ø Jouer DANS les règles
Réactions de Georges CHAPPAZ
et du groupe
1) Sur l’objectivité
Nous ne sommes jamais objectifs mais avons des objectifs négociés par
le biais de subjectivités croisées.
Il s’agit de tenter de négocier avec les subjectivités des autres pour
créer une ZPR où vont se rencontrer les objectivités.
Un travail de décentration est indispensable en développant diverses
formes de communication.
2) Sur les approches des
différents groupes de travail
Ils n’ont pas décliné les concepts d’envie, de désir, de plaisir.
Nous sommes dans une société de l’offre : en quoi l’accompagnement
peut-il devenir une offre désirable ?
L’accompagné peut alors s’impliquer en termes personnel et affectif,
exprimer ses attentes, s’autoriser une part de rêve, de désir. Ainsi
libère-t-il sa parole.
Elle s’exprime parfois de manière paradoxale à l’image d’un adolescent
affirmant qu’il n’est bon à rien et que, de toute façon, il n’y arrivera pas.
3) La durée du contrat
d’accompagnement
Il ménage des moments de renégociation. Sa durée est fixée à l’avance
comme un contrat à durée déterminée (C.D.D.). Il reste la possibilité de
rebondir à la fin de l’accompagnement.
4) La reformulation
C’est la capacité à communiquer, un des ingrédients de l’écoute active.
C’est rentrer dans le « comme si » de l’empathie.
5) La dynamique de
l’accompagnant
Elle est portée par une utopie fondatrice : les valeurs citoyennes
et le pari de l’éducabilité. Pour militer, il faut une part de rêve. Ne doit-on
pas être soit même convaincu pour convaincre ? La société n’a-t-elle pas
besoin de paix sociale pour aller de l’avant ?
Ainsi doit-on établir une relation de confiance avec l’accompagné qui
n’est pas, pour autant, de la connivence.
6) La «posture de
l’ingénieur»
Contrairement à l’usage qui tend à mettre les contraintes avant les
possibles, la formation d’ingénieur privilégie une approche fonctionnelle (ce
que je veux) sur la prise en compte des contraintes.
Par exemple, la construction du pont-canal à l’entrée de Toulouse a été
retardée par la difficulté de concilier les différents réseaux de communication
existants (voie ferrée, route, autoroute, canal du Midi). Pour autant le
principe de la construction d’un pont-canal ne présentait en soi aucun obstacle
au regard du principe d’Archimède. Encore eut-il fallu s’attacher à définir le
projet (en l’espèce les caractéristiques des modes de communication) avant d’en
envisager les contraintes techniques. Ainsi apparaissent d’abord les possibles
qui prennent le pas sur les obstacles.
Transposer la « posture de l’ingénieur » au monde de la
formation pourrait en améliorer l’efficience. Toute institution pourrait être
comparée à un gruyère dont les trous constituent des possibles et non des
contraintes qui interdiraient toute action.
7) Comment identifier et
réinvestir des compétences construites dans un autre cadre ?
Par l’écoute de l’histoire de la vie de l’accompagné, par la mise en
valeur de son bilan de compétences pour construire un projet s’appuyant sur
celles-ci, lui permettant d’en acquérir de nouvelles.
p
p p
-
Patrick ROBO -
Nous pourrions nous demander pourquoi, aujourd'hui, s'intéresser autant
à l'Analyse de Pratiques Professionnelles (APP)… Une réponse pourrait être :
"Parce que c'est dans l'air du temps" si l'on partage celle faite par un
conseiller du Ministre de l'Education nationale à qui cette question était
posée. Je ferai plutôt l'hypothèse que c'est la conséquence, d'une part, du
développement de telles pratiques dans des institutions et organismes hors
Education nationale (milieux médical, socio-éducatif, ONG, IRTS, entreprises…)
et, d'autre part, des travaux, recherches et écrits autour de ce concept en
Sciences humaines dont les Sciences de l'Education. J'ajouterai également
l'effet de quelques textes officiels liés à la formation des personnels de
l'Education.
Devant les idées, approches,
conceptions, représentations diverses et variées que l'on entend ici et là,
peut-être est-il utile d'apporter quelques précisions à propos de l'APP en
général.
Que dire à ce sujet ?
L'APP : UN CONCEPT EMERGENT, EXPLOSIF,
PROBLEMATIQUE
En premier lieu je dirai que l'APP est un concept à la fois émergent,
explosif et problématique.
Ø Concept émergent dans les écrits existants,
tels certains textes officiels qui nous régissent, comme :
·
La
Note de service n° 94271 du 16-11-94, "Référentiel
des compétences professionnelles du Professeur des Ecoles stagiaire en fin de
formation initiale", qui stipule, entre autres que :
"C'est un enjeu fondamental de la formation initiale que de
s'attacher à développer chez tous les futurs enseignants à la fois les capacités à analyser et à évaluer sa pratique professionnelle et le goût
de poursuivre sa propre formation. Ceci implique que l'acquisition des
compétences professionnelles se fasse selon des modalités qui permettent au
stagiaire de prendre le recul nécessaire à l'analyse
de son activité (analyse de son action, analyse du public destinataire,
analyse du contexte dans lequel se situe l'action). (…) Il [le P.E. stagiaire] doit
avoir été mis en situation d'analyser sa pratique individuellement et
collectivement."[8]
A noter que si pour bon nombre de
formateurs, l'APP revêt aujourd'hui un caractère obligatoire et nouveau… cette
note de service date de 1994.
·
La
Circulaire n° 2001-150 du 27-7-01 "L'accompagnement
de l'entrée dans le métier et formation continue" qui préconise (extrait) :
"Une démarche à privilégier :
Les ateliers d'analyse de
pratiques qui permettent d'identifier et d'analyser des expériences
professionnelles, avec des collègues et des experts, doivent être
privilégiés : études de cas, mise en relation des résultats obtenus et des
démarches utilisées, analyse des incidents critiques et des réussites, etc. Ils nécessitent une organisation
particulière : étalement dans le temps, groupes restreints et travail de
proximité.
Ce travail d'élucidation des pratiques pédagogiques
doit, dans un premier temps, prendre appui sur la polyvalence et/ou les
disciplines enseignées pour développer des problématiques qui interrogent plus
particulièrement le nouvel enseignant, notamment la gestion de la classe et la
prise en charge de
l'hétérogénéité des élèves.
Une démarche d'analyse de pratiques bien comprise
fait appel à de fortes compétences et ne doit pas être confondue avec de
simples échanges de pratiques."
Par ailleurs, si l'on se réfère à la littérature disponible, il
appert, selon M. MAILLEBOUIS et M-D. VASCONCELLOS (dans “Un nouveau regard sur
l'action éducative : l'analyse des pratiques professionnelles”, Repère
bibliographique. Perspectives
documentaires en éducation n°41, 1997)
que "c’est un concept émergent" depuis une quinzaine d'années.
Ø Concept explosif pour plusieurs raisons :
·
Par
le phénomène de "massification" de cette pratique en vertu des textes
officiels ainsi que des injonctions et actions ministérielles (dans le cadre du
Programme National de Pilotage et des Universités d'Eté/Automne) ; en effet,
tous les professeurs stagiaires en IUFM, tous les entrants dans le métier
devraient bénéficier d'actions de formation et d'accompagnement fondées sur
l'APP.
·
Par
les tensions que suscite, entre décideurs, formateurs, courants de pensées… la
mise en œuvre ou non d'APP.
·
Par
les résistances, voire oppositions que ce concept provoque chez des décideurs
institutionnels, chez des formateurs, chez des personnels de l'Education en
formation (initiale ou continue).
Ø Concept problématique
à différents niveaux :
·
Selon
les définitions ou acceptions que l'on attribue à l'APP, des désaccords,
incompréhensions, malentendus peuvent voir le jour entre autre à propos des
finalités ou objectifs visés.
·
En
ce qui concerne sa mise en œuvre des questions et difficultés apparaissent :
quelles modalités appropriées choisir en fonction des objectifs retenus ?
comment mettre en adéquation certains protocoles avec l'organisation
institutionnelle de la formation ? comment articuler cette démarche avec les
autres composantes de la formation ? Parmi les difficultés rencontrées : des
résistances, des refus, des blocages de certains responsables opposants ou
opposés au principe même de l'APP ; la compréhension du sens et de l'intérêt de
telles pratiques par des stagiaires ou des néo-titulaires ; le peu de
formateurs formés aux pratiques de l'APP, etc.
·
Des
questions se posent quant à la
Formation à l'APP et ce pour les personnels en formation mais aussi pour
les formateurs. Formation à l'analyse ou au "savoir analyser" ?
Formation par "imprégnation" (en participant à des dispositifs d'APP)
ou par une posture "meta" (sur le dispositif vécu) ? Application de
théories ou régulation de pratiques par des théories ? etc.
L'APP : BESOIN, CONGRUENCE, COHERENCE
A propos de l'APP, certains pensent qu'il s'agit d'une mode dans le milieu éducatif. D'autres
avancent que cela est une nécessité.
D'autres encore l'évoquent comme la "solution
miracle" aux maux de l'enseignement voire des enseignant. Question de
mots…
J'avancerai, de manière généralisante, que l'analyse de pratiques correspond à un besoin, compte tenu notamment des changements de société, de
l'hétérogénéité des publics, des évolutions de la formation initiale et de la
formation continue, du recrutement des enseignants, des nouveaux programmes… et
donc de l'évolution des métiers de l'enseignement.
Il s'agit tout particulièrement d'un besoin d'accompagnement des enseignants, des personnels de
l'Education nationale, quelle que soit leur fonction.
Je dirai également que l'analyse de pratiques est en congruence avec la Loi d'orientation de
1989 notamment parce que, à l'image de l'élève acteur de ses apprentissages,
elle permet de rendre l'enseignant acteur, voire auteur, de sa formation.
Elle est par ailleurs en congruence
avec les injonctions de certaines Instructions Officielles comme par exemple
les textes évoqués précédemment.
L'analyse de pratiques est aussi en cohérence avec des théories actuellement développées par les
Sciences humaines telles que le constructivisme, le socio-constructivisme,
l'interactionnisme, le méta-cognitivisme…
L'APP : QUELS OBJECTIFS ?

La question a été posée aux participants
présents de dire "Quel(s) objectif(s) assigner à l’Analyse de Pratiques
Professionnelles ?"
Ø
Groupe 1
§
Professionnalisation
– mieux
appréhender les déterminants de la professionnalité
– sécurisation
– évolution :
dynamique avec le formateur et le formé
– inter-agir
Ø
Groupe 2
§
Evoluer
Ø
Groupe 3
§
Entité :
faire émerger situation de problème et répondre
§
Prendre de la
distance : analyse systémique (évolution, dynamique)
Ø
Groupe 4
§
Réflexion
permanente
Dès lors que l'on s'intéresse de plus près à l'APP il est utile de
s'interroger sur les objectifs qui peuvent lui être assignés. Ainsi suivant les
approches, suivant les sensibilités nous pouvons repérer des objectifs :
d'élucidation, de connaissance,
de remédiation, d'approfondissement, de résolution de problème, d'aide au
changement personnel, de formation, de recherche, de transformation,
d'intervention, voire objectif thérapeutique ou encore d'évaluation...
Jean DONNAY, par exemple,
identifie les objectifs suivants :
• améliorer sa pratique
• améliorer l’apprentissage des élèves
• développer un savoir sur ses propres pratiques
• avoir une meilleure prise sur ses situations de travail
• pouvoir bénéficier du regard de l’Autre et de ses apports
• s’adapter au changement
• résoudre des problèmes
• transférer l’expérience acquise dans d’autres situations
• clarifier son identité professionnelle
A titre personnel et au travers du dispositif que je développe depuis bientôt
une dizaine d'années, le Groupe de Formation à l'Analyse de Pratiques
Professionnelles (GFAPP), j'avance que l'objectif premier est de
développer "un savoir analyser"
(Cf. FERRY G., Le trajet de la formation,
les enseignants entre la théorie et la pratique, Paris, Dunod, 1983, p. 57)
pour "s'anticiper autrement"
et ainsi construire un "savoir
devenir professionnel".
J'ajouterai que certes, s'il est nécessaire de se former à l'APP en
analysant des pratiques, cela n'est point suffisant et donc qu'il convient de
s'interroger sur ce que l'on pourrait nommer "une didactique de l'APP"
et sur la formation de formateurs-animateurs compétents pour développer de
telles démarches de formation à et par l'APP.
L'APP : QUELLES MODALITES ?
Une autre interrogation peut porter sur les différentes modalités de
mise en œuvre de l'APP qui pourrait être qualifié de "concept
valise".
Dans un premier temps nous
pourrions repérer schématiquement, sans pour autant nous engager dans une
taxonomie, deux grands ensembles / catégories d'analyses :
-
l'analyse
de l'action située (par observation) ;
-
l'analyse
de l'action sur récit, (d'aucuns diront "analyse de l'activité")
et deux grands ensembles / catégories de modalités :
-
l'analyse
individuelle (seul ou avec l'aide d'un autre acteur) ;
-
l'analyse
groupale.
Dans un deuxième temps, j'indiquerai sans commentaire et de manière non
exhaustive, une série de modalités "repérées" ou
"annoncées" comme étant de l'APP ; chacune d'elle méritant une
approche particulière pour ne pas en rester à des représentations plus ou moins
imprécises, voire erronées :
|
§
Groupe de Parole
§
Jeux de rôle
§
Etudes de cas
§
Groupes Balint
§
Simulations
§
Vidéoformation
§
Entretien d'explicitation
§
Ecriture clinique
§
Histoires de vie
|
§
Instruction au sosie
§
Métacommunication
§
Observation mutuelle
§
Auto-confrontation
§
Entretien en visite formative
§
Analyse du travail
de l'activité
§
GAPP - GFAPP - GAP - GEASE - GSAS - SASCO
§
Etc.
|
Lorsqu'il est question d'APP
des conceptions et pratiques fort différentes peuvent effectivement donner un
sentiment d'opacité ou "d'auberge espagnole". A y regarder de plus
près, nous pouvons percevoir / repérer qu'une pratique peut être appréhendée de
différentes façons comme le montre imparfaitement le cadre ci-dessous :
Une pratique peut être…
traitée par son auteur/acteur ou
par
un tiers extérieur
observée ou décrite, racontée





de manière impliquée ou non-impliquée par oral ou
par écrit ou par image
l'objet
d'un récit ou l'objet d'un discours
(développement)
abordée
en faits (ce qui est) ou abordée en phénomènes (ce
qui est perçu)
traitée
in vivo ou traitée
in vitro
traitée
hic et nunc ou traitée a posteriori
perçue
subjectivement ou perçue
objectivement
traitée
consciemment ou traitée inconsciemment
analysée
individuellement (auto) ou analysée
collectivement (socio)


avec
des pairs ou des experts / ex-pairs
gérée
en micro-analyse ou gérée en
macro-analyse
etc.
D'où certainement
la nécessité en tant que formateur, praticien de l'analyse de pratiques, de repérer
dans quel registre on se situe dès lors que l'on prétend ou souhaite
"faire de l'APP". Ceci pour souligner que, quelle que soit la
démarche, la modalité, le protocole que l'on utilise on ne peut s'improviser
praticien de l'APP et qu'une formation minimale de formateur est nécessaire.
Pour conclure, je
soulignerai que l'analyse de pratiques professionnelles relève de l’humain, de
la complexité et donc demande prudence et clairvoyance.
"Tout être humain
est langage humain et toute expression sourd de son individualité laquelle est
toujours ordonnée par d'autres s'ils l'accueillent en humain, par des paroles
qui l'honorent."
Françoise DOLTO
p
p p
- Michel VIDAL -
Présentation
du dispositif mis en place dans l’Hérault :
Groupe de Formation à l’Analyse de Pratiques Professionnelles
Il s’agit d’un groupe qui pratique l’analyse de pratiques
professionnelles et qui se forme en agissant.
_______________________
C’est un dispositif d’accompagnement des C.P.C. ; pour cette
raison il se situe dans le PDF sous la forme d’un G.F.A.(Groupe de Formation
Action), ce qui constitue une reconnaissance institutionnelle.
Il fonctionne depuis plusieurs années, à raison
d’une huitaine de séances de trois heures par an. Ce rythme, d’une séance par
mois, représente de l’avis des participants, une bonne fréquence.
Le G.F.A. s’adresse aux CPC et plus largement aux
enseignants qui n’ont pas la charge d’une classe. L’effectif varie selon les
années de 5 à 10 personnes.
Cinq principes essentiels régissent son
fonctionnement :
·
volontariat
·
assiduité
·
régularité
·
confidentialité
·
convivialité.
Concrètement :
-
Chaque
séance se déroule dans un lieu choisi par le membre du groupe qui
accueille ; ce lieu est distinct des bureaux de l’Inspection de
l’Education Nationale (principe d’extériorité) où le groupe ne doit pas être
dérangé car il s’agit de favoriser la concentration nécessaire des
participants.
-
Pour
que chacun se sente en confiance, la convivialité est importante, elle est
cultivée (boissons, biscuits, sucreries…).
-
Les
3 heures s’organisent en deux temps :
- un Quoi de neuf ? de 30 mn
- une séance d’analyse de 2h 30 maximum.
-
Pas
d’interruption.
La séance d’analyse :
-
Le cadre :
-
le
temps est minuté
-
cinq
phases distinctes se succèdent (Cf. Grille ci-après)
-
le
contenu est une situation professionnelle qui pose problème (ou pas)
-
règles
de prise de parole (celui qui souhaite intervenir manifeste son intention
auprès de l’animateur en levant le doigt - pas plus de 3 questions par
intervention)
-
respect
des participants et du fonctionnement.
-
L’animateur :
à il est volontaire, il dirige la séance.
à il est le garant du
fonctionnement du groupe selon le rituel établi et accepté par tous
à il est aussi un arbitre
(celui qui protège en s’assurant que les règles sont respectées)
à il est le garant du temps
à il distribue et régule les
prises de parole
à en début de séance, il
invite les participants à se porter volontaire pour exposer une situation
professionnelle qui sera analysée, puis il dirige le choix de l’exposant (la
priorité est donnée en fonction du caractère d’urgence de la situation par
rapport à l’exposant, et d’un tour de rôle entre tous les membres)
-
L’exposant : celui qui présente la
situation (oralement le plus souvent, par écrit possible)
-
Les participants : les autres membres.
A noter que l’animateur peut aussi se comporter
comme un participant (en plus de sa tâche d’animation)
-
L’observateur : il est volontaire (tour de
rôle)
à il observe le fonctionnement
du groupe
à il livre au groupe le
contenu de son observation à la fin de la séance.
-
La séance : elle est découpée en 5
phases (voir grille jointe) qui sont un cadre de fonctionnement et qui
constituent un rituel. Ce cadre qui peut apparaître comme contraignant au
début, s’avère indispensable très rapidement.
-
Les experts : le groupe a fait appel à
deux psychanalystes qui ont apporté, chacun leur regard.
Jacques LEVINE (créateur des Groupes de
Soutien au Soutien) nous a invités à orienter notre réflexion vers la
« recherche du modifiable ».
René BAJET qui a suivi les séances,
une année durant, nous a amenés à réfléchir
sur la prise en compte de l’inconscient.
Quelques principes de
fonctionnement :
-
Assiduité des membres du groupe. C’est un engagement réciproque et un gage
d’efficacité sur la durée.
-
Régularité des séances. Le calendrier est établi en début d’année.
-
Nombre de séances : il faut au moins six séances pour permettre à un
débutant en APP de commencer à maîtriser le protocole.
Un engagement contractuel :
Une production
écrite annuelle
à
pour
faire connaître notre expérience
à
pour
nous imposer une réflexion sur notre pratique.
Cette production peut être
transmise à l’Institution.
La démultiplication dans les
circonscriptions :
Au-delà de la formation à l’analyse, il s’agit d’une formation à la
mise en œuvre d’un groupe et à l’animation de celui-ci.
A noter que deux réalisations fonctionnent
particulièrement bien depuis plusieurs années sur Bédarieux et Pézenas, (et un
groupe sur Perpignan) ; un groupe a fonctionné à Montpellier pendant un
an.
Les thèmes abordés :
Quels thèmes ont été abordés dans les situations et
cas analysés dans le cadre du G.F.A.P.P. ?
En voici quelques uns, dont certains correspondent à
plusieurs cas exposés :
ð Le C.P.C. chargé d'une
animation pédagogique et en difficulté ;
ð Le C.P.C. invité comme
médiateur dans un conseil d’école conflictuel ;
ð Le C.P.C. chargé, à la
dernière minute pour "dépanner", d'animer un stage
école/collège ;
ð L'aide à un enseignant
débutant qui "ne travaille pas" ;
ð Evaluation délicate d’un
PE2 en stage responsabilité
ð Accompagnement d’un T1 en
difficulté ;
ð Accompagnement d’une Liste
Complémentaire en difficulté ;
ð Accompagnement d’une liste
complémentaire chargée d’un CP ;
ð Accompagnement d’un
enseignant en grande difficulté dans sa classe (délégation de l’IEN)
ð Le C.P.C. sollicité pour la
préparation au C.A.F.I.P.E.M.F. d'un candidat qu'il connaît ;
ð Aide à la préparation au
CRPE interne pour un(e) enseignant(e) connu(e) ;
ð Le (non)travail en équipe
de circonscription ;
ð Difficultés de
positionnement dans l’équipe de circonscription ;
ð Problèmes liés aux
relations avec l’IEN ;
ð La gestion des conflits
entre enseignants dans une école ;
ð Le C.P.C. face à ses
Statut, rôles, missions, compétences ;
ð Le C.P.C. sollicité pour
une intervention en Formation Initiale à l'I.U.F.M. ;
ð Le C.P.C. témoin de la
"dénonciation" d'un enseignant violent ;
ð Le C.P.C. indirectement
témoin de la violence d’un enseignant ;
ð Représentation à la place de
l’IEN dans une situation difficile ;
ð Trouver sa place dans une
équipe lorsqu’on n’est pas conseiller pédagogique ;
ð Impossibilité de faire face
à toutes les demandes du terrain et de l’institution ;
ð Accueil d’un collègue
conseiller pédagogique nommé en cours d’année ;
ð Insatisfaction
professionnelle du C.P.C. ;
Perspectives :
Le groupe est en réflexion permanente sur son vécu et son
fonctionnement (d’où évolution).
Il se propose d’approfondir à présent les notions
de :
-
neutralité
-
autorisation
-
confiance
-
travailler
sur l’observation.
-
présentation
du protocole
-
comment
démarrer un GAPP
-
…
GRILLE
G.F.A.P.P. 34 (version 10)
Ci-dessous la trame du déroulement
d'une séance d'analyse de pratiques professionnelles, trame qui peut évoluer
avec l'expérience du groupe notamment grâce à la "phase 5".
A noter qu'avant de démarrer la
séance, il est procédé à un "Quoi de neuf" d'une vingtaine de minutes
où chacun peut donner l'information qu'il souhaite à l'ensemble des
participants, en dehors de toute évocation d'une situation à exposer.
|
|
ANIMATEUR
|
EXPOSANT
|
PARTICIPANTS
|
|
|
• Phase 0 :
Rituel de démarrage
|
Présente les objectifs et le déroulement du GFAPP. Permet, par
négociation, le choix de la situation
qui sera exposée puis analysée.
Répartit le temps des différentes phases.
|
|
Les exposants potentiels proposent, avec
un titre, le sujet de la situation
qu'ils pourraient exposer.
|
5 à 10'
|
|
• Phase 1 :
Le temps de l'exposé
|
Rappelle au besoin les consignes de temps et de contenu.
Est garant du temps.
Fait éventuellement
reformuler la problématique.
|
Un volontaire présente le récit d'une situation professionnelle
vécue qui lui a posé question, problème.
(Possibilité de faire un retour-suite sur un récit traité lors d'une
séance antérieure)
|
Écoutent.
|
10 à 15'
|
|
• Phase 2 :
Le temps des questions
|
Distribue et régule les
prises de parole.
Peut intervenir pour recentrer les échanges, les orienter vers un
niveau d'analyse non abordé.
Est garant du temps et de la sécurité des personnes
|
Répond aux questions,
s'il le souhaite.
(pas de
justification nécessaire en cas de non réponse)
|
Posent des questions à l'exposant pour recueillir plus d’éléments
d'information sur la situation évoquée.
("vraies"
questions et non conseils ou hypothèses déguisés)
Niveaux d'analyse :
groupe, personne, institution, partenaires, société, valeurs, finalités, etc.
|
30 à 45'
|
|
• Phase 3 :
Emission d'hypothèses
et recherche du modifiable sur l'amont de la situation
|
Rappelle que l'on ne
donne pas de conseils, mais que
l'on émet des hypothèses.
Recentre, guide, veille
aux différents niveaux d'analyse.
Est garant des prises de parole, du temps et
de la sécurité des personnes.
|
Écoute.
|
Travaillent sur l'amont et le présent de la
situation évoquée.
Émettent des hypothèses pour la compréhension
et éventuellement pour
une recherche du modifiable.
Peuvent inter-réagir
sur des hypothèses émises.
|
30 à 45'
|
|
• Phase 4 :
Conclusion
|
Est garant de la consigne et du temps.
|
Reprend la parole et réagit
à ce qu'il a entendu, dit ce qu'il veut, s'il
le souhaite.
|
Écoutent.
|
0 à 5'
|
|
• Phase 5 :
Analyse du fonctionnement
|
Participe à l'analyse du fonctionnement de ce GFAPP.
Fait déterminer qui
sera l'animateur du prochain
GFAPP.
|
Participe à l'analyse du fonctionnement de ce GFAPP.
|
Participent à l'analyse du fonctionnement de ce GFAPP. (Un
participant anime cette phase qui sera objet d'écriture réflexive)
|
5 à 30'
|
|
|
|
|
Durée
totale de 1h 20' à 2h 30'
|
|
Lors des quatre Groupes de Formation à l'Analyse de
Pratiques Professionnelles vécus pendant le stage, des notes ont été prises
uniquement lors de la "phase 5" dite phase de
"meta-analyse" dont l'objectif majeur est de contribuer à la
formation des (futurs) animateurs du GAPP.
Voici les quatre comptes rendus effectués :
GFAPP 1
@ Dominique FARRAN et Michel VIDAL
Lors
de la phase 5, nous avons abordé les points (thèmes) suivants :
·
choix de la situation
ð qui choisit ?
ð selon quels critères ?
·
émission d’hypothèses
Elle pose problème pour les initiés comme pour les
débutants :
ð au niveau de la formeà espèce de rituel verbal
ð au niveau du fondà comment se situer dans l’hypothèse sans
dériver vers le conseil ou autre ?
·
reformulation
ð de la règle, de la
problématique, des hypothèses
ð qui reformule ? celui
qui énonce ou l’animateur ?
·
différents champs
ð L’animateur peut inviter le
groupe à poser des questions ou émettre des hypothèses en essayant de balayer
le plus grand nombre de champs, avec la possibilité d’utiliser une grille.
·
rôle de l’animateur
ð les tâches qui lui sont
confiées
ð son comportement (souci du
respect des personnes)
·
le silence
ð au moment de l’invitation à
exposer une situation, il est nécessaire à la concentration de chacun. S’il est
trop long, il peut engendrer une gêne pour certains participants.
ð dans les échanges, il peut permettre
un temps de réflexion. Il peut signifier une non-réponse.
·
phase 5
ð en GFAPP, c’est dans cette
phase que le groupe, par une analyse de son propre fonctionnement, assure pour
une part la formation de ses membres
ð en GAPP, cette phase peut
être utile à l’explicitation du vécu collectif. Elle est souhaitable mais non
impérative.
GFAPP 2
@ Patricia DENIS et Sandrine
BOUCHE
Compte-rendu
de l’analyse du fonctionnement.
·
Choix de la situation
Trois situations proposées.
Critères de choix (hiérarchisés)
ð Caractère d’urgence
ð Caractère d’importance / de
souffrance
ð Définir la situation en un
titre
ð Demander l’avis des
participants
ð Faire voter si nécessaire
·
Emissions d’hypothèses
ð Souci des participants de ne
pas confondre redondance et hypothèses en cascade.
ð Une hypothèse peut faire
écho à une autre comme si on allait dans le même sens.
·
Gestion de la frustration
ð Un des rôles de l’animateur
est de prendre en compte le risque de frustration inhérent à
"l’élimination" d’exposants potentiels au moment du choix de l’exposant.
Comment ?
Pour cette séance, le critère «caractère
d’importance» proposé à chacun des exposants potentiels a permis d’éviter une
frustration possible ; un seul des trois a dit que sa situation
revêtait un caractère d'importance, donc les deux autres se sont retirés
volontairement par rapport à ce critère.
L’animateur doit également prendre en compte la
possible frustration des participants si les questions ou émissions
d’hypothèses ne sont pas suffisamment diversifiées.
GFAPP 3
@ Valérie SALLEFRANQUE et
Jean-Louis TOURVIEILLE
·
Outils pour l’animateur
ð Cavalier portant le nom des
participants
ð Feuille pour noter les
demandes de prise de parole.
ð Feuille pour noter les
différents champs de référence.
·
Attitudes de l’animateur
ð Rigueur dans la conduite à conserver
dans la durée du GFAPP.
ð Concentration, notamment
durant la phase 1, pour saisir l’exposé dans toute sa complexité.
ð Ecoute «multiple» : de
celui qui parle, du groupe, de l’analyse de la situation.
ð Savoir se détacher de ses
documents (feuille de prise de parole, etc.) pour regarder le groupe et être
attentif aux échanges.
ð La reformulation est une
aide efficace pour recentrer sur l’objet.
ð Faire reformuler à la fin de
la phase 1 la problématique par l’exposant. Vérifier qu’elle ne soit pas
généralisante.
ð Etre très attentif aux
demandes de prise de parole dont la non-prise en compte peut être mal vécue par
les participants.
·
Rôles de l’animateur
ð Veiller à ce que le groupe
ne fasse pas d’hypothèses générales.
ð Faire un signe aux
participants pour signifier la prise en compte de sa demande de parole.
·
Attitudes des participants
ð Les rires de connivence ou
les apartés peuvent gêner l’exposant ou d’autres membres du groupe qui n’en
connaissent pas la raison. Cela diminue l’écoute et le climat de sécurité.
·
Le choix
Les participants ont dû se
déterminer sur un seul critère : situation concernant un groupe de PE2 ou
de T1. Ils ont eu du mal à se positionner. L’animateur aurait pu rebondir sur
la demande de recherche de critères supplémentaires.
·
Fiche-guide pour l’animateur
Animation
Ø Choisir une aide à
l’animation qui pourrait, par exemple, noter les demandes de participation,
gérer le temps, noter les champs, etc.
Ø Préparer une fiche de
gestion de son animation.
Démarrage
Ø Rappeler la possibilité de
gêne des rires de connivence et des apartés.
Déroulement
Ø Veiller à ne pas avoir un
débit de parole trop rapide.
Ø Balayer du regard pour noter
rapidement les prises de parole.
Ø Gérer le temps ne doit pas
perturber les échanges et la réflexion en obligeant à faire court systématiquement.
Ø Les blancs peuvent être
parfois nécessaire car ils traduisent un temps de réflexion du groupe.
Fin
Ø Choisir l’animateur du
prochain GFAPP.
GFAPP 4
@ Patrick CENENT
Phase
5 : Le vécu du groupe après l’analyse réalisée.
Le
groupe souligne l’excellent climat d’écoute et le sentiment de sécurité qui
entourent cette pratique.
L’exposant
n’a pas été trop perturbé dans son
rôle, il estime que l’exposition et la mise en mots facilitent une première mise à distance
et donc une approche réflexive.
Une difficulté
est toutefois avancée : elle concerne cette frange délicate qui entoure l’émission
d’hypothèses.
Le
risque de basculer sur le registre du conseil, de la prescription est réel.
Parfois, le distinguo entre hypothèses et conseils déguisés est difficile à
opérer.
Le rôle de
l’animateur apparaît ici comme crucial . La gestion «multi tâches» est ardue
(écouter, noter, réguler, reformuler, gérer le temps, garantir la sécurité de
l’exposant…) C’est visiblement en animant que l’on devient cet animateur «expert».
Le ton utilisé est aussi important dans la perspective d’une séance apaisante
et riche.
La
multiplicité des regards et des approches des individus vient en aide à chaque
participant.
Une certaine
frustration peut naître toutefois chez un participant qui se voit autoriser à
questionner ou à émettre des hypothèses longtemps après avoir sollicité la
parole (prise de parole décalée).
La discipline (implicite à ce protocole
et qui s’applique aux participants) facilite l’écoute, le respect mutuel.
Il existe une
réelle complexité à parcourir tous les champs dans le questionnement et dans l’émission
d’hypothèses. Cela nécessite une familiarisation avec un certain nombre de
cadres théoriques. Il y a donc très certainement en amont un effort de
recherche à faire chez les participants afin de mieux balayer ces champs le
moment venu.
Conclusion : Le GFAPP doit donc
«bien fonctionner» après une certaine période d’essais.
p
p p
p
p p
@ Maryse
ROUGE-SOUILLARD ?
Mardi
·
La photocopieuse est disponible, les ordinateurs sont
fonctionnels, des dossiers ont été formatés «compte rendu et
photographies »
·
Jackie "por aqui, por aqui !" est
à Lamalou les Bains en rééducation. Une
carte postale est à la disposition de ceux qui la connaissent pour lui envoyer
un bonjour amical.
·
Question : le repas convivial est-il une forme
d‘accompagnement ?
·
Des voitures à quatre roues sont à vendre ( CV,
Xsara….) une rubrique petite annonce est proposée.
·
Les deux heures de respiration de mercredi peuvent se
passer en solo, sur un bateau à condition qu’il y ait assez de participants ou avec une visite chez un ostréiculteur.
·
Les troupes sont à 80 km de Bagdad.
·
Les lycéens manifestent contre la guerre en Irak.
·
Chirac part en guerre contre le cancer. Les buralistes
sont en colère, leur chiffre d’affaire pourrait diminuer à cause de
l’augmentation du tabac.
Mercredi
·
En réponse à la demande d’explication de D., M. dit que
pour danser le tango argentin, il faut des mots clef pour déverrouiller les
pieds. Les voici : Ecoute de l’autre, confiance, respect,
attention, posture, aménagement
d’espace de liberté dans la réponse...)
et que ce ne sont pas des figures qui s’enchaînent mais un chemin
cohérent à faire ensemble.
·
Patrick lit la dédicace que G. Chappaz a laissée :
Merci à toi Patrick pour m’avoir permis de rencontrer un groupe dynamique,
convivial, demandeur. C’est toujours un plaisir de vivre ces moments qui
laissent le goût fort et intime que la vie vaut d’être vécu.
·
Les absents de cet après-midi : Jean-Louis, Maryvonne, Patricia et Odile
seront en situation devant un jury. Pensons à eux. Patrick ira participer au groupe au Conseil Scientifique
et Pédagogique de l'IUFM où il sera, entre autre, question du devenir de ces
instituts.
·
Des nouvelles du front : Des bombes lâchent des
bombelettes jolies et colorées. Que vont en faire les enfants ?
Relevé dans un journal : On est plus près du début que de la fin.
·
Les documents de finalisation du stage : L’équipe
rappelle que le classeur est vide.
Jeudi
·
D. a été déçu car l’éloignement des êtres du
groupe dans le tango argentin malgré tous les efforts déployés par les
animateurs lui a semblé une preuve de
non-désir.
·
J. fait le point sur les achats faits et futurs
purement gastronomiques et souligne l’agitation de la nuit des pongistes qui
perturbe fortement le repos des intellectuels.
·
D. demande de renflouer la bourse commune.
·
Michel demande à son groupe s’ils veulent bien mettre
en écrit la phase 5 de la séance d’APP qu'il animait.
·
A. souhaite présenter rapidement une architecture d’un
possible saisie du document de stage sur CD-ROM.
·
Michel rappelle que la déontologie se référant à
l’identité d’un individu demande que celui-ci donne son accord pour une
possible diffusion de son image (sur un Cdrom souvenir du stage).
Vendredi
·
D. et M. : Les documents de saisie de stage sont à
peu près complets. Merci de donner la suite avant seize heures
·
J-L. a écrit la recette du Lapin à la moutarde
·
A. précise que le CDR sera finalisé plus tard et sera
envoyé aux participants. Idem pour celui sur les photos.
·
Les feuilles d’émargement sont à compléter et il faut y
glisser les ordres de mission remplis.
·
P. donne des Informations :
–
Iufm : Le Ministère recule sur les dispositifs de la
Formation Continue. Des changements sur la formation des P1 et des P2. Quel
devenir pour notre actuel ministre ? 1er avril, journée nationale qui sera
un Forum pour des réflexions dans les IUFM
–
Irack : 12 000 renforts
et une Journée nationale de jeûne et de prières en Amérique pour le
soutien à la guerre.
–
Daniel Cecaldi est mort, Zizou sera capitaine de l’équipe de
France.
·
Un document sur les règles dactylographiques peut être
mis à disposition.
·
Michel demande les clefs des chambres.
·
P. nous quitte pour aller siéger à un Conseil de
classe.
·
C. n’a pas payé le bateau.
·
M. dit qu'elle a apprécié le calme de cette nuit.
ppp
En amont de la première session du
stage, nous (responsables du stage) avons demandé par courrier à chaque
participant de répondre aux deux questions :
-
Par rapport à l'ACCOMPAGNEMENT, je me pose LA question suivante :
-
Par rapport à l'ANALYSE DE PRATIQUES
PROFESSIONNELLES, je me pose LA
question suivante :
Toutes les questions reçues
ont été colligées dans deux fois deux "cahiers de roulement" proposés
comme outil et technique de formation par
l'écrit partagé en présentiel.
Sur chaque cahier, cinq noms de participants
suivant une répartition géographique et alphabétique. Chacun était invité, quand il le voulait pendant cette session, à
écrire dans les deux cahiers où son nom figurait, des éléments de réponses, des pistes, des
informations aux questions et problèmes signalés. (à cet effet des colonnes et
des pages blanches ont été insérées dans les dossiers). Chacun était
aussi invité à lire les
deux cahiers qui circulaient sur les tables et à
réagir de manière constructive aux réponses déjà apportées.
L'ensemble des réponses fournies se trouve, ci-après.
Questions sur l'Accompagnement
1/ Ne serait pas-il nécessaire que les CP
soient intégrés en tant que partenaires de réflexion et de formation l'IUFM ?
Pourquoi ne pas organiser des rencontres, des colloques entre ces groupes de
formateurs ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Je souscris tout à fait à ce souci. Je reste
persuadée que la liaison nécessaire formation initiale – formation continue
passe par la rencontre des personnes agissantes.
Ø
Sur quel temps, sur quels objectifs ?
Ø
Est-ce que l’institution ne devrait pas déjà en être
consciente et persuadée ?
Ø
Ce sont peut-être les nouveautés à apporter à
l’Education nationale plutôt que de tout modifier.
Ø
Oui pour un lien entre théorie et réalité du terrain
(circonscription).
Ø
Oui pour groupes de réflexion (IMF, CPC, PIUMF). Oui
pour l’intégration des CPC dans la formation continue à l’IUFM dans un cadre
institutionnel défini.
Ø
Sur un département « à petit effectif », on
peut dire que les liens existent entre les formateurs IUFM et les formateurs
IA et que la « Maison » de la formation appartient à tous. Mais
cette situation est spécifique. A nous, d’une part de regarder ailleurs et,
d’autre part, de diffuser ce que nous vivons…
Ø
L’avenir est à la complémentarité des deux entités,
dénuées d’esprit de chapelle. Il passe par des relations à
institutionnaliser, une écoute, un respect mutuel bien nécessaires.
|
Ø Mais
qu’est-ce que la réalité lorsque visiblement celle-ci s’apparente à la
vérité.
Ø Le
CPC détient-il la vérité ?
Ø L’existence
des GFAPP dans notre département a permis cette rencontre riche de la
diversité des statuts de formateurs.
|
2/
A quel moment peut-on considérer qu'un accompagnement est arrivé à son terme ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Quand
il n’y a plus de demandes de la part de l’accompagné ?
Ø Quand
il n’y a plus d’envie de la part de l’accompagnateur ?
Ø Jamais
Ø Quand
on a fait le deuil de certaines priorités ?
Ø Je
ne sais pas car il y a tension entre la nécessité d’avoir l ‘apport d’un
regard extérieur et le développement de réelles compétences.
Ø Quand
on est arrivé au terme des séances prévues (possibilité pour ceux qui le
souhaitent de mettre en place un nouvel accompagnement).
Ø
Quand le potentiel d’analyse réflexive du formé (de
l’accompagné) dépasse l’offre potentielle de l’accompagnateur.
Ø
Quand l’un ou l’autre des pratiquants sent la
nécessité d’y mettre un terme.
Ø L’accompagnement
s’achève lorsque le contrat passé entre accompagnant et accompagné est arrivé
à sa phase finale
- réussite
projet réalisé
identité professionnelle
confirmée
satisfaction des acteurs
- échec
constat d’impossibilité de dialoguer entre
les acteurs
|
Pour
les T1, mais les Tn ont peut être d’autres demandes ? !
Et
lorsqu’il y a dérive ? … lorsque le contrat n’est pas respecté…
à
que l’on revoit ce contrat
à
et que de nouveau il n’est pas respecté
à
c’est un terme sur une non réussite.
|
3/
Lors d’un accompagnement, le formateur est-il un accompagnateur, un guide sur
du long terme ? Ou ne doit-il être présent et accompagner qu’en cas de
problèmes rencontrés par l’accompagné ? (cf définition du Petit Larousse)
|
En réponse, réaction, interrogation
|
En écho…
|
|
Ø Je crois que
l’on accompagne en « faisant un bout de route ensemble : « l’accompagnement
n’est donc pas dans l’instant mais dans la durée ». Par ailleurs, il
faudrait déterminer rapidement, dans l’échange, la longueur du trajet à
parcourir ensemble.
Ø Difficile de lâcher la
main quand on part pour s’intégrer dans le désir de « faire
progresser »
Ø Professionnellement,
on a le devoir mais est-ce une nécessité ?
Ø Lors
de l’accompagnement, on peut travailler sur des réussites.
Ø Cela
dépend du contrat entre accompagnant et accompagné. Etre présent sur du long terme
ne peut-il pas dériver vers un tutorat, voire de l’assistanat ?
Ø Si
j’ai bien compris : accompagner c’est prendre AVEC et on prend TOUT.
Ø Je
n’ai pas de réponse à priori. Je pense qu’il y a des possibles, aux acteurs
de les faire intervenir en fonction des situations et surtout de leurs
attitudes face à ces situations.
Ø Tout
accompagnement est une réponse à une question. S’il n’y a pas de question, il
n’y a pas d’accompagnement.
Ø Pourquoi
ne pas accompagner aussi des réussites afin de mettre en valeur auprès des
autres ?
|
|
4/
Quelles sont les vrais attentes des T1 en matière de complément de
formation ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø La
première réaction des T1 est une attente de « bons conseils » destinés
à régler des problèmes « urgents » liés à l’organisation et à la
conduite de la classe. Rien ne nous empêche de les faire profiter de quelques
« recettes » et autres « ficelles du métier » liées à
notre propre expérience, mais je crois qu’il faut entrer rapidement dans la
perspective d’une demande d’accompagnement.
Ø Au
cours de la première année d’entrée dans le métier des soucis de
l’ordre : organisation des progressions, mise en place d’emplois du
temps. Egalement gestion de la classe, relations avec les familles.
Ø Gérer
le quotidien, conforter une pratique avant le fait de s’interroger sur soi.
Ø Une
formation plus pratique que théorique.
Ø La
remontée des besoins des T1 pour fonctionner dans la classe a mis en évidence
un accompagnement ciblé sur l’organisation, la gestion du temps, des
relations, du groupe, des conflits…
Ø Celles
qu’il verbalise en lien avec son affectation.
Ø Echange
de pratiques pour :
-
se rassurer
-
étendre le champ des outils possibles
Ø Je
ne le savais pas en venant !
Ø J’ai
soulevé un coin du voile !
Affaire à suivre …
Ø J’ai
l’impression qu’ils attendent des recettes pour évacuer leur souffrance et
parfois, rarement, mais cela arrive, pour ne pas avoir à construire.
Ø Il
s’agit à mon sens de progresser dans une approche bien souvent dédramatisante
que je pourrais modéliser ici
Ø à
de l’émotionnel au fonctionnel vers l’expertise.
Ø Ne
pas oublier les attentes sur la législation, la sécurité, le fonctionnement,
la protection par rapport aux partenaires (réalités qu’ils rencontrent
quelquefois abruptement dans les premiers jours de classe).
|
|
5/
Quelle alternance entre accompagnement individuel et collectif ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø L’accompagnement
collectif est plutôt le dispositif prévu par l’Inspection Académique : ½
journées filées + 2 semaines de stage qui ne donne pas de latitude quant aux
dates et qui est obligatoire pour tous les T1. Par contre l’accompagnement
individuel peut être organisé en fonction des besoins de chaque T1 par
rapport à sa situation professionnelle personnelle. Pour certains deux ou
trois visites + entretiens seront suffisantes alors que d’autres
nécessiteront un accompagnement plus rapproché avec rencontres multiples et diverses.
Ø Il
me semble que l’accompagnement individuel et l’accompagnement collectif ne
sont pas au même niveau, tant au niveau des objectifs que des attentes.
L’alternance n’est donc pas la discussion principale !
Ø Cet
accompagnement doit-il être assuré par les mêmes personnes ?
Ø Accompagnement
individuel pour répondre aux situations problématiques immédiates, réponse
aux attentes exprimées en relation directe avec la situation vécue par le T1
(on l’accompagne quel qu’il soit).
Ø Accompagnement
collectif pour mettre en place des groupes de réflexion, d’analyse, pour
faire évoluer l’accompagné [aider à …] dans sa posture et son identité
professionnelle.
Ø Pourquoi
alternance et pas simultanéité ?
Ø Et
la demande institutionnelle ?
|
Quel rythme ?
Quelle fréquence ?
|
6/ L’accompagnement d’un
professeur des écoles entrant dans le métier se fonde, au-delà des textes, sur
la construction et le suivi d’une relation humaine. Dans cette perspective, quelles
pistes explorer, quels leviers actionner afin d’atteindre (ou au moins
approcher) un des enjeux de cet accompagnement, à savoir identifier, étayer,
élaborer un véritable savoir professionnel ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Cf
stage
Ø Sommes-nous
vraiment formés à manipuler le sensible et à ne pas trop s’y investir ?
Ø Du
grain à moudre ! !
Ø Le
GAPP peut être pour le prof. D’écoles entrant dans le métier l’occasion de
prendre du recul par rapport à sa formation personnelle. Et il ne s’agit pas
de manipuler du sensible !
|
|
7/
Quels accompagnements sont prévus à la rentrée 2003/04 pour les T1 et T2 sur le
plan national et départemental ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Est-ce
que les trois semaines institutionnelles se poursuivent !
Ø J’attends
la réponse avec crainte car comment accompagner toujours plus de personnes à
moyens constants dans le meilleur des cas ?
Ø Au
niveau national, 3 semaines pour les T1, 2 pour les T2 !!
Ø à
voir les textes !!
Ø minim ? maxim ? … ??
|
Wait and see !
|
8/
Comment passer de l’accompagnement présentiel à l’accompagnement à
distance ? Quel rôle accorder à l’écrit dans l’accompagnement ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Convaincre
que l’écrit est indispensable (mais je le fais, je n’ai pas besoin de …) pour
des raisons à découvrir ensemble.
Ø Peut
être en utilisant des médiateurs : livres, revues, outils, personnes ressources,
échanges de pratiques, cahier de roulement…
Ø L’écrit
me semble un outil très pertinent, mais trop peu développé et connu… C’est à
travailler et discuter ! !
Ø Le
non-présentiel est-il suffisamment implanté dans les processus
d’apprentissage / de formation pour avoir des chances de ne pas se déliter
dans le temps ?
Ø L’accompagnement
à distance ne me paraît pas compatible avec un réel désir de côte à côte.
Ø Le
développement des listes de diffusion et la richesse des échanges qui s’y
passent ne constitue-t-il pas un exemple d’accompagnement non
présentiel ?
Ø Paraît
difficile à part via mail.
|
Mais à mon sens les temps de
rencontre doivent réapparaître ponctuellement.
|
9/
A l'issue de deux ans PE1 / PE2, quels compléments sur le terrain / pratique
quotidienne ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Emploi
du temps, progressions, programmation…
Ø Accompagner
les besoins verbalisés.
Ø Lien
approfondi théorie - pratique
Ø Lien
formation initiale - pratique - formation continue
Ø Créer
des aller – retour
Ø à
fréquence – efficacité.
Ø Formation
continue.
|
|
10/
Peut-on accompagner un / des collègues qui ne veulent pas être
accompagnés ? Quel chemin peut-on prendre avec eux pour qu’il(s) se
décide(nt) à partager l’idée d’échanger sur les difficultés liées au métier
d’enseignant ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø « On
ne peut pas faire boire un âne qui n’a pas soif » Célestin FREINET.
Notre rôle de formateur serait donc de lui donner soif ! !
Ø Comment
a été présenté le GAPP et son dispositif ?
Ø Prendre
le temps, expliquer la notion d’accompagnement et laisser une porte
entrouverte.
Ø Respecter
la position de l’autre… mais avancer lentement ensemble .
Ø Il
est important de distinguer l’obligation institutionnelle des modalités de mise en œuvre de ces injonctions.
Ø La
prudence, l’humilité, la mise en confiance permettent quelquefois à certains
d’entrer dans un processus d’accompagnement sans qu’ils s’en aperçoivent…
Ø S’efforcer
de créer un lien authentique entre accompagné et accompagnant.
|
|
11/
Quant à l'accompagnement des T2, des T1 en 2003-2004, des PE2 ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
|
|
12/
Quelles stratégies mettre en place pour convaincre les formateurs de
l’efficacité à long terme des démarches
accompagnantes ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Une
formation ? Une pratique personnelle ?
Ø Leur
permettre de participer à des GFAPP
Ø Les
accompagner eux-mêmes. GFAPP – formation de formateurs, etc…
Ø Les
rassurer sur l’absence de vérité c’est le meilleur moyens d’inviter
l’individu à fouiller une boîte à outils qui malheureusement n’est pas
garnie !
Ø Participer
le plus possible à des GAPP.
|
Oui - merci
Maintenant quelles modalités
pour cette mise en place ?
|
13/
Quels sont les outils de base indispensables pour les T1 ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Si
on pouvait en dresser la liste, je pense qu’on leur fournirait une caisse à
outils complète à l’entrée dans le métier.
Ø Une
aptitude à développer un à-priori positif de l’autre.
Ø Beaucoup
de circonscriptions ont produit ce genre de documents : valise du débutant,
dossiers divers, je renforcerai en insistant sur la connaissance par la
pratique des outils institutionnels : programmes, évaluations, etc…
|
Une liste mais plusieurs
recettes à inventer !
|
14/
Quelle réflexion sur sa pratique personnelle, le formateur chargé d’accompagner
des collègues en formation doit-il mener en préalable pour être au clair sur
ses valeurs et ses choix implicites.
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Si
je m’engage dans cette pratique, c’est que j’y ai trouvé certaines
satisfactions personnelles, certaines réponses et certainement une stratégie
exportable pour l’autre.
Ø Quelle
identité professionnelle ?
Ø Quelle
posture ?
Ø Le
verbe « DOIT » me gêne ! ? Quelle réflexion menons-nous
sur notre propre pratique pour devenir accompagnant efficient ?
Ø Où
le formateur en est-il de sa réflexivité pratique, quelle congruence ?
Ø Analyse
de pratiques !
|
|
15/
N’est-il pas nécessaire que cet accompagnement soit conduit en concertation
avec les équipes de circonscription ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Pourquoi
cette question ? Il y a des formateurs à l’IUFM et des formateurs dans les
circonscriptions. Il semble évident que pour qu’il y ait cohérence dans
l’accompagnement nous parlions tous le même langage et visions les mêmes
objectifs.
Ø Ah !
Ø Oui
car il est bon d’avoir une certaine unité dans une circonscription.
Ø …
en harmonie avec l’IUFM
Ø …
continuité, cohérence…
Ø Pour
être la plus exhaustive possible, la formation doit mettre en parallèle, en
opposition, en confrontation… des
démarches multiples et des traitements divers d’une même situation.
Les regards croisés permettent à l’accompagné de constituer ses propres
éléments de réponse.
|
Est-ce possible ?
Ne sommes-nous pas chacun
différent de l’autre ?
Cette diversité des points de
vue peut, au contraire, constituer une richesse et donner de la consistance à
l’accompagnement.
Bien sûr.
Bien sûr !
Tout à fait d’accord pour les
regard croisés non exclusifs.
|
Questions sur l'Analyse de
pratiques
1/
Que faire pour continuer à accompagner dans ce genre de pratiques réflexives
les jeunes qui ont commencé à
cheminer (pour que cela ne reste pas
une parenthèse) et ceux qui sont encore loin
et pas encore capables d'en
analyser les tenants et les aboutissants
?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
L’institution doit intégrer les GAPP dans les animations
pédagogiques.
Ø
A chacun de trouver sa place dans le GAPP proposé.
Ø
Convaincre l’Institution de l’utilité de la mise en
place de l’A.P.P., du dispositif de groupe.
Ø
Faire confiance au bouche à oreille pour la diffusion
entre collègues…
Ø
L’APP procède d’une démarche volontariste. Il
conviendrait de mettre en place un cadre institutionnel permettant à chacun
de s’y impliquer s’il le désire.
Ø
Je me suis demandé si la liste de diffusion ne
pouvait pas permettre de faire ce lien. Mais des problèmes matériels ont
empêché l’expérience d’aller au bout. (Jean-Louis Tourvieille)
|
|
2/
Comment présenter le dispositif d'analyse de pratiques professionnelles, sans
ambiguïté ? la présentation du dispositif afin que toute la dimension professionnelle
trouve sa place ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø Faut-il
présenter le dispositif ou le laisser découvrir et le faire oraliser peu à
peu ?
Ø N’est-ce
pas brûler les étapes que de donner tout de suite les objectifs et surtout
les attendus ?
Ø Grande
importance de l’animateur
Ø Que
recouvre le terme « ambiguïté » dans cette question ?
|
Ø La
présentation claire, détaillée des objectifs et de la démarche dans un
processus de développement professionnel, lève l’ambiguïté
|
3/
Les analyses de pratiques professionnelles ne devraient-elles pas, au moment de
l’entrée dans le métier, s’accompagner davantage de réponses aux questions des nouveaux
enseignants, plutôt que de répondre au besoin de formation réflexive ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Ne faut-il pas au contraire expliquer que des modules
de formation différents donnent des effets différents et qu’il faut
rechercher soi-même à définir les cadres de recherches pour trouver ceux qui
ont répondu aux questions que l’on se pose.
Ø
Les questions des nouveaux enseignants ont leur place
dans le GAPP.
Ø
Les deux sont indispensables.
Ø
Le besoin de formation réflexive, l’entraînement à
l’analyse n’empêche pas de travailler à la recherche de solutions multiples
aux questions des nouveaux enseignants. La nouveauté n’exclut pas la
réflexivité.
Ø
Il me semble que certaines réponses (ou éléments de réponse)
que se posent de nouveaux enseignants sur leurs pratiques peuvent surgir dans
les moments d’analyses de pratiques.
Il me semble que la recherche
de réponses aux questions et l’analyse réflexive ne doivent pas être
confondues dans le même temps. (Jean-Louis Tourvieille)
|
Ø oui
|
4/
Quelles différences entre analyse de pratiques et critique de leçon ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Pratique « professionnelle » ?
« pédagogique » ?
« d’investigation » ?
de « recherche d’un chemin » ?
Critique ?
Ø
La leçon ne peut-elle pas être la situation
analysée ?
Ø
La différence ne réside-t-elle pas dans l’émission
d’hypothèses ?
Ø
La dimension analytique de la « critique » me
semble quelquefois être zappée au profit d’une proposition immédiate de
remédiation aux aspects négatifs de la « leçon ».
Ø
J’y vois une posture réflexive qui peut très bien ne
pas apparaître dans la critique de leçon. La différence de définition des
deux termes : « analyse » et « critique » implique
des différences de fond.
Ø
L’analyse de pratiques demande un dispositif
(notamment la régularité) qu’exclut la critique de leçon.
|
Ø
La « critique » de leçon est intitulée
telle que et elle est une des épreuves du CAFIPEMF.
Dénomination à modifier ?
Ø
Qu’est-ce qu’une « leçon ?
|
5/
Place et rôle du conseil dans l’analyse de pratiques ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
…à mettre dans un autre cadre de formation.
Ø
Le « T1 » ne peut-il pas trouver le conseil
dans les hypothèses émises ?
Ø
Le conseil relève plus de la critique de leçons.
Ø
Le « tenir conseil » fait-il partie de
l’A.P.P. ?
Le « donner conseil » fait-il partie de
l’A.P.P. ?
Ø
Le conseil est une invitation à agir . L’analyse est
une invitation à réfléchir.
Ø
Il me semble que le conseil ne fait absolument pas
partie de l’A.P. ð voir un autre temps et un
autre dispositif pour les conseils.
|
Ø Dicton :
« les
conseilleurs ne sont pas les payeurs »…
|
6/
Est-il judicieux, et si oui, comment rendre efficiente l’analyse de pratiques
professionnelles au sein de l’équipe pédagogique d’un même groupe
scolaire ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Volontariat de tout l’équipe (par exemple après une
inspection d’école)
Ø
Volontariat de tous
Ø
L’interférence entre les situations vécues par chacun
des membres qui pratiquent l’analyse ensemble ne risque-t-elle pas de gêner
l’analyse elle-même ? (confidentialité, extériorité, distance)
Ø
Par expérience, j’aurais tendance à répondre
« non » à cause d’une distanciation quasi impossible : tout le
monde a le nez penché sur le même guidon, l’analyse, de ce fait, est
parasitée par une multiplicité d’implications affectives (manipulations,
influences, copinage, etc.)
|
Ø Sceptique ?
« Distance, échange »
par opposition à
« vase clos, autarcie »
Ø Un
animateur (ou régulateur) extérieur serait peut-être le bienvenu dans ces APP
d’équipes pédagogiques d’école ?
|
7/
Jusqu’où ira le développement rapide de l’analyse de pratiques professionnelles
sans perdre les valeurs qui la portent ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Formation de formateurs indispensable, complétée et
donnant des outils aux formateurs, sinon… dérapages incontrôlés.
Ø
Sans formation efficiente et démarche basée sur le
volontariat, blocages multiples à venir.
Ø
Tout dépend, je crois, de la forme que l’on donne à
l’A.P.P., quel dispositif on utilise, quelles sont les personnes garantes de
ce dispositif.
Ø
Le développement de la pédagogie Freinet dans les
années 60 n’a pas éteint le mouvement ni la qualité de la recherche des
groupes.
|
|
8/
Comment favoriser le climat de CONFIANCE TOTALE nécessaire à une réelle efficience
de l’analyse en GAPP ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
En étant sincère et en l’affirmant à chaque instant
Ø
Rappel à chaque séance
Ø
Attitude de l’animateur
Ø
Dissociation animateur – encadrement normatif :
l’Animateur ne doit pas être impliqué dans l’évaluation
Ø
La confiance portée à une personne est tellement
personnelle que la confiance totale est peut-être excessive dès que l’on
parle de groupe !
|
Ø
Asservissement JE / JEU
|
9/
Peut-on animer une APP avec des participants qui ne sont pas TOUS volontaires ?
Faut-il modifier la commande institutionnelle et prévoir l'APP de façon
facultative ou changer de technique d'APP ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
oui (1), oui (2)
Ø
Il est nécessaire que les T1 connaissent l’A.P.P.
Ø
Ne pas changer la technique
Ø
(1) oui, la preuve…
Ø
(2) non, la technique doit être la même, mais il est préférable d’amener
(d’accompagner) les T1 vers une technique plutôt que l’inverse. Donner plus
de temps, laisser se développer l’échange de pratiques, la demande de
conseil, et faire émerger progressivement la nécessité ou l’intérêt d’une
recherche sur l’amont plutôt que sur la résolution d’une situation posant
problème.
Ø
Ayant travaillé dans le même contexte, il m’est
arrivé de voir adhérer des participants qui ont découvert cette pratique
« malgré eux ».
Ø
Doit-on, dans un groupe quelconque, être tous au même
niveau d’implication, de motivation, de désir pour que ça fonctionne ?
|
Ø
surtout !
Ø
Tout à fait d’accord avec ça.
|
10/
Comment faire "adhérer" des stagiaires pour qui l'APP n'est pas un
choix personnel ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
1)
On a droit à l’échec
2) Si on est convaincu, on trouvera en modulant au coup par coup et en
adaptant et en se documentant ou en participant à un groupe d’échange.
Envie, plaisir, désir et non imposer dans la durée = contrat ?
|
Ø oui,
questions et manques induisent désir et envie d’aller plus loin
|
11/
Comment mettre en pratique l'APP au sein d'un établissement scolaire ? est-ce
souhaitable ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Cf. question 6 : autarcie, vase clos //
Ouverture, échanges
Ø
Oui, si toute l’équipe le souhaite
Ø
Pas souhaitable : mélange, hétérogénéité sont
des facteurs favorisant l’A.P.P.
Ø
Souhaitable, oui, car réflexion collective !
Comment ???
Ø
Il y a de réelles difficultés s’il n’y a pas de
clarification des objectifs du Groupe d’A.P.P.
La question de l’animateur extérieur au groupe et non-impliqué reste posée.
|
|
12/
Comment effacer les représentations négatives de l’analyse de pratiques des T1
dans notre démarche d’accompagnement (pour nous faire gagner du temps en début
de formation ) ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Expliquer, expliquer…réexpliquer
Ø
Faire exprimer les représentations ou les vécus
installés, clarifier les contenus au delà des mots, des titres, des sigles
CONFIANCE
BIENVEILLANCE
NON COMPLAISANCE
DEONTOLOGIE
Bien situer les rôles, les positions des formateurs. Afficher rigueur et
bienveillance
Ø
Doit-on gagner du temps ?
Ø
Les représentations négatives ne peuvent céder que si
la démarche d’accompagnement s’inscrit dans la durée et dans le respect des
personnes et des règles de confidentialité.
|
|
13/
Jusqu’où ira le développement rapide de l’analyse de pratiques professionnelles
sans perdre les valeurs qui la portent ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Jusqu’où
voudra bien le Ministère mais aussi les formateurs Maître d’œuvre ?
|
|
14/
La formation sera-t-elle poursuivie ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
La réponse est une question ?
|
|
15/
Comment présenter l’A.P.P. ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Fiche-guide ?
Ø
En étant d’abord au clair soi-même avec ses
représentations.
Ø
Voir groupe de projet ???
|
|
16/
Quels sont les moyens les plus efficaces pour être à la fois coopératif et
institutionnel avec les T1 lors d’une analyse de séance ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
Un dispositif et un cadre donnés peuvent contribuer à
atteindre ces objectifs.
|
|
17/
Doit-on constituer un groupe d’analyse de pratiques professionnelles si l’on
n’est pas assuré de la permanence du groupe et d’une certaine durée ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
A priori non / efficience
Ø
Non / confiance
Ø
Je ne le crois pas.
|
|
18/
La rigueur du dispositif ne peut-elle constituer un blocage pour certains
T1 ?
|
En réponse, réaction, interrogation…
|
En écho…
|
|
Ø
.. et pour certains formateurs !!
Ø
surtout les silences
Ø
Peut-on, doit-on, jouer sur la rigueur ?
Ø Je
pense profondément que ce cadre permet une vraie communication. L’absence de
régulation empêche certains de parler, laissent d’autres occuper l’espace.
La liberté naît de la possibilité de dire « Je ».
|
|
p
p p
- Patrick ROBO -
Le cahier de roulement est une des formes de
travail coopératif qui permet des échanges en réseau.
Nous donnons ici quelques consignes et
conseils qui devraient permettre à chacun d'utiliser cet outil de
communication. À chacun de se l'approprier et de l' adapter à son réseau.
1 – Principe
C'est un cahier qui circule,
qui "roule" entre des personnes volontaires désireuses de communiquer
sur un thème particulier, sans forcément se rencontrer régulièrement dans des
réunions. Comme une boule de neige, le contenu abordé s'enrichit au fur et à
mesure de l'apport d'informations, de réactions, de questions, de suggestions
de la part des différents participants.
L'efficience de cette
technique de travail à distance est liée au respect de règles adoptées par
l'ensemble des participants au cahier.
2 – Les participants
Ils se choisissent, cooptent
et s'engagent à respecter les règles adoptées. Il vaut mieux ne pas dépasser
cinq à six personnes par cahier. S'il y a dix volontaires, il est préférable de
faire tourner deux cahiers sur le même sujet, quitte à les faire se croiser.
3 – L'objet de l'échange
Il doit être choisi d'un
commun accord et être bien délimité ainsi que les objectifs visés.
Ils seront clairement
explicités en début de cahier. L'objet de l'échange pourra évoluer après un
premier tour de roulement.
4 – Organisation d'un cahier
Format
Choisir de préférence un cahier
24 x 32 cm pour son format A4 (photocopies, ajouts d'annexes…)
Contenu
On écrit en noir uniquement
en recto.
1)
Écrire
au début du cahier le titre du thème choisi et le numéro du cahier si plusieurs
cahiers circulent.
2)
En
page 1, inscrire les nom, adresse, téléphone des participants avec l'ordre de
passage. Inscrire également les règles de fonctionnement adoptées.
3)
En
page 3, expliciter le thème choisi et les objectifs visés.
4)
En
page 5, celui qui démarre le cahier écrit son témoignage, son questionnement,
sa problématique… en laissant une marge d'environ 6 cm à droite qui permettra
aux autres de noter des réflexions, de poser des questions sur le texte
communiqué.
NB.
À partir de là, chaque page comportera une marge à droite.
5)
Le
suivant réagit dans les marges laissées (questions, remarques, conseils, etc.)
puis ajoute son écrit (cf. 4 ci-dessus).
6)
Quand
le cahier revient au premier qui l'a lancé, celui-ci établit une synthèse du premier tour puis écrit un texte qui
démarrera un deuxième tour.
7)
Et
ainsi de suite…
NB .
Si l'on ajoute des annexes, les numéroter et les placer en fin de cahier.
Ecrire
lisiblement ; si l'on travaille sur traitement de texte il est possible de
coller son texte à l'emplacement prévu pour sa participation.
Numéroter
les pages du cahier.
Toujours
garder un double de sa participation.
5 – Délais
Chacun garde le cahier au
maximum quatre jours à partir de sa réception et l'envoie au suivant. Si pour
diverses raisons on n'a pas le temps d'écrire dans le cahier, il faut l'envoyer
quand même au suivant pour ne pas rompre la dynamique de l'échange.
NB .
Il est important que celui qui lance le cahier (le responsable) puisse
s'assurer du bon "roulement" de celui-ci. À cet effet, celui qui
envoie le cahier au suivant signale, par téléphone ou emel, cet envoi au
responsable du cahier.
Il est possible de dresser le calendrier du
roulement à partir de la date d'envoi incrémentée de quatre (jours).
Le responsable du cahier peut envoyer ce
calendrier à tous les participants dès qu'il envoie le cahier au second.
6 – Rencontre possible
Après un ou deux tours de
roulement, les participants peuvent décider de se rencontrer pour une synthèse
collective et envisager la suite à donner à cette réflexion.
7 – Archivage
Dans un principe de
mutualisation, il n'est pas exclu de penser que dans une école, voire une
circonscription, divers cahiers de roulement (ou dossiers rouges) ayant terminé
de circuler puissent être stockés dans un lieu clairement identifié afin de
permettre à d'autres collègues de les consulter.
Dans ce cas, suivant le
contenu, un sommaire en début de cahier peut faciliter sa consultation.
NB : La
décision d'archivage relève bien évidemment des participants à chaque cahier.
Cette
décision peut être prise avant le démarrage ou à l'issue des échanges. Y
réfléchir avant.
p
p p
***
Notes de 1 à 4 ***
Très
décevant, très défavorable............................ Ø
1
Décevant,
défavorable............................................ Ø 2
Satisfaisant,
favorable............................................. Ø
3
Très
satisfaisant, très favorable............................ Ø
4
Calcul des notes moyennes à partir des 20 bilans
exprimés
|
DIFFERENTES SEANCES
DE LA SESSION
|
Utilité du sujet
(1 à 4)
|
Apport théorique
(1 à 4)
|
Apport pratique
(1 à 4)
|
|
Présentation du stage
|
3,60
|
3,18
|
3,77
|
|
Présentation
des participants
|
3,96
|
2,80
|
3,47
|
|
Emergence
des mots clés du stage
|
3,49
|
3,43
|
3,36
|
|
Lancement du
document de stage
|
3,69
|
3,38
|
3,73
|
|
Le concept
d'accompagnement (PR)
|
4
|
3,30
|
3,43
|
|
Etat des
lieux de l'accompagnement dans les départements
|
3,68
|
3,23
|
3,31
|
|
Accompagnement
et formation (GC)
|
3,70
|
3,14
|
3,11
|
|
Constitution
des groupes de projets
|
3,49
|
3,07
|
3,48
|
|
Travaux des
groupes de projets
|
3,16
|
3,30
|
2,76
|
|
L'APP :
panorama
|
3,89
|
3,72
|
3,72
|
|
GFAPP : une
situation d'accompagnement de T1
|
3,93
|
3,82
|
3,82
|
|
Mise en
commun des travaux des groupes de projets
|
3,59
|
2,95
|
3,02
|
|
GFAPP : une
situation d'animation d'un GAPP
|
3,93
|
3,83
|
3,89
|
|
Mise au
point des projets de l'intersession
|
3,18
|
3,02
|
3,15
|
|
Finalisation
des projets intersession et du document de session
|
3,23
|
3,26
|
3,13
|
|
Cahiers de
roulement
|
2,79
|
2,79
|
2,86
|
|
Documentation
et BCD
|
3,17
|
2,80
|
2,58
|
|
Activités
libres à l'initiative des participants
|
3,59
|
3,28
|
3,39
|
|
Bilan et
suivi de session
|
3,50
|
3,20
|
3,53
|
|
Satisfaction
des attentes / organisation
|
4
|
3,91
|
3,62
|
|
Réinvestissements
possibles en matière de contenus
|
4
|
3,91
|
3,85
|
Les cases grisées correspondent
à des scores inférieurs à 75% de satisfaction.
Expression libre (possibilité de continuer
au dos de la feuille)
q
Merci
pour les apports théoriques et pratiques.
q Un très bon équilibre entre
les interventions des chercheurs et les réflexions des participants. Un
complément professionnalisant. "On en redemande ! "
q
Il
est difficile de répondre à certaines demandes pour une première participation.
Un peu de recul me serait nécessaire.
q
Manque
de temps pour exploiter les cahiers de roulement et les ressources de la BCD.
q
Une
2ème session paraît indispensable :
-
pour
compléter notre formation,
-
pour
finaliser les travaux impulsés au cours de cette session.
q
Cahiers
de roulement :
-
manque
de temps
-
difficile
à concilier avec un projet d'écriture et avec un jeu de questions / réponses
(je demande, je réponds, je, ou un autre, rebondis…)
q
Merci
Patrick pour les nombreux outils présentés ici.
q
Dès
le premier jour du stage et le lancement du concept
"d'accompagnement", j'ai eu le sentiment d'être à ma place ici et pas
par hasard. Ce que j'entendais résonnait : je veux dire que depuis 1988,
mon premier poste, j'avais envie d'accompagnement, je râlais que ma profession
sur "de la matière humaine" me laisse si souvent seule et frustrée
par rapport à ma pratique et mes doutes. J'étais déjà intimement convaincue de
la nécessité d'un lieu de parole et d'échange, d'une forme de compagnonnage qui
n'existait pas dans notre métier.
En tant que PEMF, je me sens investie d'un rôle par
rapport à la nouvelle génération de PE, génération "chanceuse" de mon
point de vue car elle bénéficie de l'évolution du métier. Ne plus être seul,
dans sa classe, la porte fermée, mais la réalité du travail d'équipes (PE,
PIUMF, CPC, …). Vivre le GAPP dès le début de sa carrière ne peut que favoriser
le travail d'équipes, de groupes, de collègues.
Les cycles dans les IO, c'est bien joli. Mais la
réalité est loin du rêve. Faire avancer les mentalités, les postures, les
attitudes et les comportements est une nécessaire dynamique dans notre système
complexe Education Nationale.
On ne peut pas enseigner en 2003
Comme on nous a enseigné en 1963.
La société évolue et nous aussi.
Les enfants, nos élèves d'aujourd'hui
Seront les citoyens de demain.
Ne l'oublions pas.
Adaptons-nous et rendons les
adaptables.
q
Découvrant
ces contenus pour la 1ère fois, je ne me sens pas assez armée pour
un réinvestissement immédiat. Besoin de revivre d'autres situations de GFAPP.
q
J'ai
compris / appris beaucoup en vivant deux GFAPP en parallèle avec des apports
théoriques et des recherches en groupe.
q
Je
me demande si une intervention extérieure (cf. G. C.) est pertinente. Les
participants m'ont semblé évoluer sur tout le stage au niveau de leur
réflexion, tant par les apports lors des temps de travail, que par les échanges
hors temps de travail. Or G. C. n'a pas eu la possibilité de répondre à nos
questions, questions réfléchies après son intervention. Ceci aurait peut-être
augmenté réellement les apports théoriques et pratiques.
p
p p
*** Notes de 1 à 4 ***
Très
décevant, très défavorable............................ Ø 1
Décevant,
défavorable............................................. Ø 2
Satisfaisant,
favorable............................................ Ø 3
Très
satisfaisant, très favorable........................... Ø 4
Calculs sur 20 bilans exprimés
|
LES ASPECTS DU STAGE
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Lettre de pré-stage
|
|
|
5
|
14
|
|
Communications pré-stage
par Internet
|
|
|
3
|
16
|
|
Accueil
|
|
|
|
19
|
|
La grille emploi du temps
|
|
|
2
|
18
|
|
Respect des horaires
|
|
1
|
3
|
16
|
|
Mise en œuvre du document
de session
|
|
|
9
|
10
|
|
Mise en œuvre du document
du CDrom
|
|
|
8
|
10
|
|
Petit matériel
|
|
|
9
|
11
|
|
Affichages
|
|
4
|
12
|
4
|
|
Les ordinateurs
|
|
|
9
|
11
|
|
La BCD
|
|
4
|
8
|
7
|
|
Service photocopies
|
|
|
10
|
7
|
|
Partage des
responsabilités
|
1
|
|
|
19
|
|
L'animation générale
|
|
|
3
|
17
|
|
Temps de régulation
|
|
1
|
7
|
12
|
|
Travaux de groupes
|
|
|
9
|
11
|
|
Pot d’accueil mairie
|
|
|
3
|
17
|
|
Repas coopératif
|
|
|
|
20
|
|
Hébergement
|
|
|
2
|
18
|
|
Salles de travail
|
|
1
|
4
|
15
|
|
Vécu / Travail
|
|
1
|
4
|
15
|
|
Vécu / Relationnel
|
|
|
4
|
16
|
|
Satisfaction des attentes
/ organisation
|
|
|
6
|
14
|
|
Réinvestissements
possibles
en matière d'organisation
|
|
|
6
|
14
|
|
Impression générale
|
|
|
3
|
17
|
|
totaux
|
1
|
12
|
130
|
348
|
|
Pourcentages / score global
|
0,20%
|
2,44%
|
26,48%
|
70,88%
|
Expression libre (possibilité de continuer
au dos de la feuille)
q
Une
organisation structurée et conviviale permet une formation pertinente et très
agréable.
Les temps de GFAPP auraient peut-être gagné à être
plus espacés. Cependant, les deux organisations différentes (/animateur) ont
permis des "phases 5" très riches qui ont effacé cette proximité
temporelle.
q
Je
trouve cohérent avec les objectifs du stage et très efficace la formule en
internat.
q
BCD
: pas défavorable, mais un peu décevant cette année.
Toujours aussi satisfaisant. La qualité du travail
vécu dans ce stage dépend aussi de la qualité de l'accueil.
q
BCD
: dommage ! manque de temps.
Très satisfaite. Partante pour la deuxième session !
q
Hébergement
: bruit.
Très satisfaite mais "gavée" au sens
propre comme au sens figuré ! Sur ce dernier point… j'ai besoin de recul, et de
redoubler.
q
Petit
bémol concernant la grille : les deux séances d'analyse trop proches dans le
temps.
q
Affichages
: contraintes matérielles (impossibilité d'ajouter, problème de traces sur le
mur).
BCD : on y trouve quelque part ce que l'on y
apporte.
Il serait intéressant de séparer les responsabilités
: logistique / créatrices (prises de notes, synthèse,…) dans la mesure où
l'investissement n'est pas le même.
La présentation de mes commentaires met en relief la
rigueur de la présentation des items.
q
Le
stage est structuré et structurant.
q
Impression
globale très positive, l'impression de participer à un dispositif organisé et
"qui tourne".
Les travaux de groupe dans des salles séparées
m'auraient paru générateurs de moins d'interférences (voix fortes,
concentration).
q
Merci
pour la convivialité et la très grande qualité de l'accueil hébergement.
p
p p
1. Q-SORT
@ Maryvonne DELON
C’est un outil d’évaluation qui permet de faire émerger les
représentations d’un individu, d’un groupe à un moment donné.
Voici le Q-SORT sur l’Analyse de Pratiques Professionnelles
utilisé lors du bilan de la première session : (cf fiche ci-dessous)
Il s’agit de faire émerger sur 20 propositions : Les items les plus importants
Les
items les plus neutres
Les
moins importants
Ceux
à rejeter
On affecte ensuite des coefficients aux propositions afin
d’établir un «palmarès».
- Fiche
distribuée -
Les conceptions diverses du
groupe d’analyse professionnelle
Q-Sort en 20 Questions
Parmi
les 20 items je choisis :
Les 2 qui me
paraissent les plus importants : 3 pts chacun
4 items dignes de
considération : 2 pts chacun
8 items qui me
paraissent neutres : 0 pt chacun
4 qui me paraissent
moins importants : moins 2 pts chacun
2 qui sont à rejeter :
moins 3 pts chacun
|
|
Participer à un
groupe d’analyse professionnelle c’est :
|
|
1
|
Apprendre à émettre des hypothèses
|
|
2
|
Etre capable de tirer des leçons pour la suite
|
|
3
|
Envisager d’autres possibles
|
|
4
|
Faire confiance à un dispositif à travers son
expérimentation
|
|
5
|
Echanger, partager des expériences
|
|
6
|
Développer ses capacités d’analyse
|
|
7
|
Replacer une situation dans une dimension
multireferentielle
|
|
8
|
Etre capable de décrire une situation dans son
contexte-expliciter les éléments implicites
|
|
9
|
Développer ses capacités d’écoute
|
|
10
|
Acquérir une posture réflexive par rapport à sa pratique
professionnelle
|
|
11
|
Se référer à d’autres situations-mettre en relation les
éléments retenus
|
|
12
|
Amorcer un processus de développement professionnel
|
|
13
|
Prendre en compte la dimension conviviale du groupe
|
|
14
|
Accepter les contraintes de confidentialité, de respect de
l’autre
|
|
15
|
S’enfermer dans une démarche
|
|
16
|
Trouver des réponses à ses besoins de formation
|
|
17
|
Donner des conseils
|
|
18
|
S’autoriser à prendre la parole
|
|
19
|
Acquérir une culture professionnelle
|
|
20
|
Améliorer sa propre confiance dans la richesse du groupe
|
Les réponses des
participants à l'issue de la première session :
|
|
Participer à
un groupe d’analyse professionnelle c’est :
|
|
1
|
Développer ses
capacités d’analyse
|
|
2
|
Acquérir une
posture réflexive par rapport à sa pratique professionnelle
|
|
3
|
Développer ses
capacités d’écoute
|
|
4
|
Amorcer un
processus de développement professionnel
|
|
5
|
Replacer une situation
dans une dimension multireferentielle
|
|
6
|
Accepter les
contraintes de confidentialité, de respect de l’autre
|
|
7
|
Envisager
d’autres possibles
|
|
8
|
Apprendre à
émettre des hypothèses
|
|
9
|
Acquérir une
culture professionnelle
|
|
10
|
Faire confiance
à un dispositif à travers son expérimentation
|
|
11
|
Se référer à
d’autres situations-mettre en relation les éléments retenus
|
|
12
|
Etre capable de
tirer des leçons pour la suite
|
|
13
|
Trouver des
réponses à ses besoins de formation
|
|
14
|
Echanger,
partager des expériences
|
|
15
|
Etre capable de
décrire une situation dans son contexte-expliciter les éléments implicites
|
|
16
|
Améliorer sa
propre confiance dans la richesse du groupe
|
|
17
|
S’autoriser à
prendre la parole
|
|
18
|
Prendre en
compte la dimension conviviale du groupe
|
|
19
|
S’enfermer dans
une démarche
|
|
20
|
Donner des
conseils
|
▲▲▲
2. Bilan réalisé de façon
collective et orale
@ Christian BORRAT
Ce que je retiens de cette session
(positif et négatif), en tant que
formateur d'adultes :
·
Le GAPP nécessite une phase
d’analyse (phase 5). Elle est essentielle pour la construction et l’évolution
du fonctionnement du groupe
·
Le besoin de deux sessions pour comparer ses propres réactions est
ressenti : non pas pour faire de la répétition ou de la redondance mais
pour prendre du recul
·
L’alternance des dispositifs (travail de groupe) et la restitution au
grand groupe est positif
·
Les différentes techniques d’animation (Q-SORT, quoi de neuf…) sont
très intéressantes et ouvrent des perspectives de réinvestissement
·
La non sélection des stagiaires a permis de mettre en présence une
palette d’individus très diverse (âge, fonction, expérience)
·
Le partage des tâches (réalisation de photos, intendance, gestion BCD,
photocopies…) implique et responsabilise les stagiaires
·
La richesse des échanges de pratiques et les apports théoriques
·
L’ambiance du stage est propice au travail et à la réflexion (sérénité,
tranquillité)
·
Le dispositif (cadre, internat) favorise les temps de parole et
d’échanges ainsi que la convivialité
·
Le rôle des formateurs (Michel et Patrick), garants du dispositif et du
déroulement, est primordial
·
L’accompagnement des uns par les autres ; l’accompagnement dans
l’accompagnement
·
La présence de stagiaires d’un même département, voire d’une même école
à côté de stagiaires isolés a, au début, fait naître quelques craintes chez
certains. En réalité, un même sentiment de satisfaction et de bien-être a été
partagé par l’ensemble
·
Pour les stagiaires de l’Aude (les plus nombreux), cette concentration
leur a permis de se voir différemment, de se côtoyer et de se connaître
autrement
Echanges
sur une prochaine session
·
Une seule session sur le thème de l’accompagnement semble insuffisante
·
La construction de ce concept nécessite un suivi ; elle repose
également sur un processus de maturation
·
Il y a plusieurs niveaux d’enrichissement au cours des différents
stages
·
L’intersession est l’occasion de s’engager dans une continuité, de
mettre en œuvre et mutualiser nos réflexions
·
L’intersession devrait permettre des aller-retour et l’extension à
d’autres domaines de notre champ professionnel
·
La 2ème session : - carotte ou cadeau ?
-
dynamique
de projet.
A suivre…
p
p p
Quelques mois après la fin de la première session, chaque
participant a été invité par courrier électronique à répondre à deux questions et
éventuellement à s'exprimer librement à propos de cette formation.
On trouvera ci-dessous l'ensemble des réponses reçues et
anonymées.
1/ En quoi cette session a été formatrice pour
moi ?
Cette session a été formatrice pour moi car j’ai découvert durant
cette semaine, à travers les nombreux outils proposés, une autre manière
d’aider nos jeunes collègues à entrer dans le métier. J’ai aussi remis en cause
certains aspect de ma pratique personnelle en classe.
La perspective de mieux saisir les divers dispositifs
d’accompagnement et d’analyse de pratiques professionnelles était pour moi une
motivation première pour ce stage.
Dans un deuxième temps, l’opportunité de réfléchir et
avancer collectivement dans nos pratiques d’accompagnement et d’analyse à travers
la constitution de groupe de projet constituait mon second centre d’intérêt.
La session de Mèze a été formatrice pour moi car j’ai pu
échanger avec des collègues d’autres départements.
Ainsi "le concept d’accompagnement" s’est
élargi :
- accompagner
celui qui veut s’améliorer par un regard croisé ;
- aider
à clarifier ;
- ouvrir
des portes, reconnaître l’autre, encourager ;
- importance
de l’extériorité de l’accompagnateur ;
- l’accompagnement
a une durée limitée, mais est étalé dans le temps ;
- mettre
en place un projet, savoir entendre les demandes authentiques ;
- analyse
pédagogique et professionnelle à partir d’un vécu distancié ;
- il
ne suffit pas que l’on réunisse des enseignants pour qu’une rencontre
s’opère ;
- grâce
aux échanges chacun va construire ses propres recettes.
J’ai beaucoup aimé un GAPP ou l’animatrice tout en restant
très fidèle au cadre a apporté cette variante qui s’est révélée efficace afin
d’avoir une situation professionnelle.
"On fera un tour de table pour le choix de la
situation." "Dans un second temps on demande aux exposants
potentiels, l’urgence, l’importance, la souffrance"
Toute situation pédagogique ou professionnelle peut être
analysée en GAPP. Mais il faut accorder une très grande importance à la manière
de présenter le dispositif. La situation à analyser sera concrète et il
faudra faire référence à tout le vécu.
La session permet de s’acculturer au concept
d’accompagnement par :
- l’apport de
références théoriques (document de P. ROBO, intervention de G.CHAPPAZ)
- le vécu du stage
au quotidien mais aussi l’avant et l’après ("effet Ripolin")
- le partage et/ou
le témoignage des expériences de chacun.
Cette session devrait me permettre de passer un peu plus du
dire au faire.
Cette session m’a permis de découvrir bien des nouveaux
aspects de l’APP : cela tient probablement au fait que cette fois, je suis
venu avec un "vécu" en tant qu’animateur d’un groupe APP (T1). La
découverte de nouvelles "dimensions", de nouvelles interrogations a
été également stimulée par le "brassage" des participants (des
"anciens" et des "nouveaux") : le groupe m’a semblé au
départ beaucoup plus hétérogène qu’à "Mèze 2001-2002", mais plus
"cohérent", "convergent" à la fin de la semaine. (Il ne
s’agit là que de mon ressenti personnel, très subjectif). Les formateurs ont
ABSOLUMENT besoin de telles "rencontres" : pour être à même de
permettre à nos collègues "de terrain" de faire évoluer les pratiques
professionnelles, les CPC doivent eux-mêmes vivre l’évolution d’une problématique
portée par un groupe de travail : dans cette perspective de
formation, le GAPP est un thème de travail très favorable, voire idéal.
Cette formation m’a encore plus convaincue de la spécificité
d’être formateur.
-
Elle m’a permis d’appréhender l’accompagnement différemment,
c’est à dire avec plus de notions sur l’attitude, les relations à développer
entre accompagnant et accompagné.
-
J’ai appris ou du moins appréhendé des dispositifs, techniques
de gestion, d’animation de groupe.
-
L’importance du développement de la réflexion chez
l’accompagné.
L’ASSERTIVITE est le nom d’un concept que je sentais autour
de moi et à travers certaines personnes que je côtoie. C’est toujours un pas de
plus que de pouvoir mettre un mot sur des actes et des attitudes.
Merci tout simplement.
Le stage m’a fait grandir même si j’étais "mûre"
pour capter des messages. Je n’ai pas la prétention d’avoir trouvé la vérité
mais d’être plutôt sur un chemin que je choisis et qui donne du sens à ma vie.
On tâtonne, on hésite, parfois on fonce et on sent que quelque
chose fonctionne et nous réjouit. C’est une sorte de réalisation qui nous
comble de plaisir, quelques instants de bonheur et des couleurs dans la
vie.
– Réflexion par
rapport au métier et à la différence entre enseignant et formateur référence à un
savoir et des élèves ou référence à une tâche et des collègues ;
– Une part de théorie dans les domaines de
l’accompagnement, l’assertivité, l’écoute de soi et des autres, la
communication, la formulation des désirs et des manques, la prise de position sans
jugement et la relation d’aide à l’adulte dans un contexte professionnel qui
peut être étendue au domaine relationnel personnel ;
– Une technique de Coaching avec le GAPP.
Pour moi, la théorie ne peut se dissocier de la mise en
pratique. Après une année d'expérimentation, j'ai apprécié
l'apport de connaissances et les échanges de pratiques (dans lesquels
je place aussi les séances de GFAPP, observées d'un oeil différent quand
on a été confronté soi-même aux situations).
La manière dont le stage a été conduit est aussi pleine
d'enseignements.
Par rapport à ma spécialité, caractérisée par une évolution
permanente et rapide, le fait de se situer dans la posture du
stagiaire et non plus celle du maître de cérémonie, permet une approche
différente des difficultés.
J'ai découvert le principe et la philosophie des GAPP et
GFAPP . cela m'a permis de prendre du recul par rapport à mes actions de
formateur en direction des T1 et PE2 et de concevoir différemment les visites
aux stagiaires.
2/ Si ce fut le cas, quels facteurs ont contribué à
cette formation ?
Les différents moments autour de l’APP : présentation
de P. Robo, expérience et apports de Chappaz, expérimentation du GFAPP.
L’apport théorique de Georges Chappaz a beaucoup contribué à
ce bilan très positif.
- Le projet est
de faire réussir l’accompagné en acceptant l’incertitude.
- Les questions
sont plus importantes que les réponses.
- Remettre en route un désir
d’apprentissage est encore plus devenu le moteur de mes interventions dans
l’AIS.
- Il ne peut pas
y avoir d’accompagnement sans demande.
-
"Assertivité" permettre à l’autre de dire "je"
- Savoir donner
du temps au temps.
- Dans l’accompagnement savoir se
rapprocher de la personne pour ensuite s’éloigner peu à peu.
- Ne pas manipuler
le choix d’autrui.
Facteurs ayant contribué à cette formation :
- les nombreux
moments de verbalisation et de régulation
- les multiples
sollicitations afin de ne pas perdre ou laisser s’évaporer des impressions, des
sensations, des réflexions
- la recherche
permanente de conditions propices à l’échange et à l’écoute mutuelle
- la volonté de
(re)situer chacun dans une posture d’accompagnement (tantôt accompagnant,
tantôt accompagné) sur les voies de l’assertivité.
L’organisation minutieuse et la recherche "en
coopération" permet d’entrevoir des formes de travail qu’il serait
souhaitable de généraliser (répartition des tâches, codification de la prise de
parole, etc.) : c’est le fameux "travail d’équipe" dont on
parle tant, que l’on exige de la part des élèves, et qui reste si timide dans
certaines équipes éducatives (et de circonscription).
Le travail en équipe, le partage des tâches.
La découverte des GAPP.
La préparation du stage par les animateurs.
Les contenus.
Organisation - Accueil -
Convivialité - Site :
Un tout fait de petits riens
Un système en équilibre avec des contraintes et des
ressources
Un groupe organisé à partir d'individualités
Le principe d'un stage en internat me paraît un élément
essentiel en cela qu'il isole des interférences professionnelles ou
personnelles.
Le cadre et la qualité des formateurs, le choix des
intervenants, contribuent à cette formation.
Les échanges avec des personnes ayant déjà cette réflexion
et une expérience dans ce domaine
3/ Expression libre à propos de cette
formation :
L’institution donne l’offre d’être accompagné, je
dois tout mettre en œuvre afin de rendre cette situation agréable et
efficace.
Les autres ne sont pas des objets que je façonne.
Je dois savoir accepter la confrontation de la parole et les
conflits socio affectifs cognitifs.
Je dois accepter que l’autre prenne son chemin.
"Le soufflé qui retombe", c’est la hantise de tout
formateur, y compris du formateur de formateur. Le soufflé est souvent retombé,
il y a une responsabilité collective, une responsabilité individuelle... Le
soufflé, il faut le manger chaud, parce-que "ça présente bien", mais
même un peu dégonflé, il conserve sa saveur. Il reste donc toujours quelque chose
de TRES positif à l’issue de cette formation, même si les projets que l’on se
fixe en se quittant ne sont pas tous réalisés.
Je m'exprimerai plutôt sur les suites de la formation.
Quelles que soient les bonnes volontés exprimées lors d'un stage, il est
difficile de les faire suivre des faits : impératifs professionnels,
démotivation et/ou centres d'intérêts différents, distanciation... Le
bilan paraît toujours très mitigé à des organisateurs exigeants. La
compilation de documents est toujours problématique, les réseaux
d'échanges tardent à se mettre en place ou se délitent.
Je pense que des éléments de réponse se trouvent dans les
technologies de l'information et de la communication:
- il me semble indispensable que parmi les
stagiaires ou les organisateurs, une ou plusieurs personnes s'impliquent
personnellement et prennent à leur compte la réalisation du ou des documents de
synthèse : récupération et vérification de toutes les pièces, trame ou plan du
document final, compétences dans la mise en page multisupport.
- il me paraît nécessaire que du temps
"incompressible" soit consacré à la rédaction et au stockage des
documents de synthèse. Cela suppose une ambition plus modérée dans les
contenus.
- la mutualisation, l'échange par courrier électronique, ne
parviennent pas à "décoller" : l'outil apporte des facilités mais ne
remplace pas la proximité. Si on veut créer un réseau avec quelque chance de
réussite, chaque membre de ce réseau doit pouvoir puiser dans ces échanges des
éléments de réponse à ses problèmes quotidiens et non pas seulement sur une
partie de son activité.
S'il est difficile de structurer un suivi de formation, en
revanche les liens tissés à l'occasion du stage favorisent les collaborations
futures.
p
p p
@ Patrick
ROBO ?
- version du 01/03/2001 -
CONNOTATIONS
La démarche d'accompagnement n'est pas quelque
chose de nouveau ; nous avons tous entendu parler d'accompagnement scolaire,
d'accompagnement de projet, d'accompagnement d'équipe en projet,
d'accompagnement des adolescents, des malades, des mourants...
Mais qu'en est-il de l'accompagnement dans le cadre
de la formation des enseignants et/ou des formateurs dans l'Education nationale
?
Dès lors que l'on parle d'accompagnement, certaines
notions, certains concepts, certaines idées viennent à l'esprit tels que : suivi, soutien, aide, guide, conseil,
assistance, tutorat, mentorat, parrainage, médiation, entraide, mutualisation,
évaluation formative ou formatrice, mise en réseau, coopération, compagnonnage,
régulation…
DEFINITIONS
Le terme "accompagnement" est étrangement
absent de la plupart des dictionnaires, encyclopédies et guides actuels
relatifs à l'éducation et à la formation. On en trouve une
définition dans le Dictionnaire de la
formation et du développement personnel :
"Fonction qui, dans une équipe pédagogique, consiste à suivre un
stagiaire, et à cheminer avec lui, durant une période plus ou moins brève afin
d'échanger à propos de son action, d'y réfléchir ensemble et de l'évaluer (on
dit parfois Qparrainagef, Qsupervisionf)"
Pour le Dictionnaire
Universel Francophone En Ligne,
l'accompagnement
c'est "ce qui accompagne : servir du riz en
accompagnement d'un plat de viande."
Quant à l'Encyclopédia
Universalis, "La notion
d’accompagnement est directement liée à l’état actuel de la musique…"
L'approche étymologique nous conduit vers le "compagnon"
(à l'origine, celui qui partageait le même pain). Pouvons-nous, à cet instant,
penser au compagnon, celui qui se situe entre l'apprenti et le maître, et qui,
à son tour, pourra devenir maître ? Pouvons-nous penser à ce compagnonnage de
corporation ? Pouvons nous penser au compagnonnage entre pairs ?…
ACTUALISATION
Aujourd'hui,
cette idée d'accompagnement apparaît pourtant de plus en plus dans des textes
officiels et dans des publications relatives aux Sciences de l'Education.
þ Ainsi
dans la conférence de presse du Ministre de l'Education Nationale de Février
2001 nous pouvons lire :
"Evidemment, la formation
ne s’arrête pas à la fin de la deuxième année d’IUFM : les jeunes
professeurs, qui peuvent éprouver des difficultés dans l’exercice d’un métier
difficile, ont besoin d’un accompagnement
au moment de leur entrée dans le métier ; la formation donnée alors est
d’autant plus profitable qu’elle répond à des problèmes rencontrés et à des
difficultés éprouvées. J’ai décidé que cet accompagnement
dans le métier se ferait pendant la première et pendant la deuxième année
d’exercice. Cela complétera efficacement la formation dispensée en IUFM et
préparera la participation à la formation continue."
(…) " Par ailleurs tous
les professeurs des écoles stagiaires effectueront un stage de pratique accompagnée."
(…) " Sur toutes ces
questions, seule la formation qui accompagne l’entrée dans le métier est
pertinente. Elle prend sens réellement au niveau de l’école ou de
l’établissement et répond à des besoins qui naissent de la pratique
professionnelle quotidienne."
(…) " Dans cet esprit, l’accompagnement de l’entrée dans le
métier constitue un enjeu essentiel. Prenant appui sur les personnels
d’encadrement, il doit aider l’enseignant à comprendre le sens et la cohérence
des réformes engagées."
(…) " L’accompagnement à l’entrée dans le
métier devra revêtir les formes diversifiées nécessaires à son efficacité. Il
s’agit de considérer l’enseignant débutant comme un enseignant responsable à
part entière, mais qu’il convient d’accompagner
de manière adéquate. Ainsi, il pourra lui être proposé, par exemple :
l’alternance d’une aide collective et individuelle, des stages présentiels si
nécessaire, mais aussi des échanges guidés entre jeunes enseignants comme avec
des enseignants plus expérimentés. Pourront être envisagées toutes formes
utiles au sein desquelles l’enseignant débutant peut prendre une distance
réflexive par rapport à sa pratique, l’analyser, la confronter à d’autres,
disposer d’interlocuteurs capables de l’aider à trouver des solutions.
Afin de compléter le
dispositif, un enseignant
« accompagnateur » ou « référent », susceptible de
venir en aide au jeune enseignant, sera identifié dans chaque école ou
établissement scolaire."
(…) " Au-delà de cette
formation initiale confortée et de cet accompagnement
systématique de l’entrée dans le métier, je souhaite également que la
formation continue des enseignants voit son rôle réaffirmé et ses modalités de
mise en œuvre renouvelées."
(…) " Tout cela
s’accompagne d’un déplacement du rôle de l’enseignant qui est au moins en
partie, déchargé de son rôle d’apport d’information pour se recentrer sur ce
qui est la définition de sa mission : accompagner
la construction du savoir par les élèves."
(…) " Je souhaite que
la formation continue puisse également encourager le développement de tous les
talents. Les enseignants doivent être accompagnés
dans le développement de leur carrière comme dans leurs éventuels projets de
mobilité et de préparation à l’exercice possible de nouvelles fonctions."
þ Egalement
dans la note de service du 18/04/1996
relative aux missions et fonctions des Conseillers Pédagogiques de
Circonscription nous pouvons lire :
(…) "Il a été décidé
que les enseignants bénéficieraient d'une assistance
et d'un suivi au cours de leur
première année d'affectation.
(…) Le C.P.C. a pour
fonction première l'assistance et le
suivi des enseignants débutants,
notamment au cours de leur première année d'affectation.
(…) Il assiste les équipes enseignantes (…) Il soutient la mise en œuvre d'activités nouvelles et accompagne les équipes d'enseignants.
(…) Il accompagne les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, en
priorité les nouveaux nommés : il les aide
à utiliser, compléter et affirmer les compétences qu'ils possèdent déjà.
(…) Il convient que le
C.P.C. assure sa fonction essentielle d'aide
et de conseil, ce qui inclut un
travail de médiation, de négociation et d'aide."
þ La
circulaire du 20/01/1999 relative à
la Relance de l'éducation prioritaire précise dans le dixième point intitulé
"améliorer l'accompagnement des
enseignants et créer les conditions d'un pilotage plus performant" :
" – l'accueil, le soutien et la formation des équipes :
(…) de plus, il convient
d'accorder une attention toute particulière aux nouveaux arrivants. (…)
encourager le parrainage des
nouveaux affectés, entraide en
direction de ceux-ci.
(…) la formation des équipes
doit leur apporter une aide pour
réussir avec les élèves, pour faciliter la mise
en commun de pratiques et pour les évaluer.
Des groupes d'analyse de pratiques, de recherche-action, et des réseaux coopératifs sont de nature à
permettre aux équipes d'élargir leur champ de réflexion."
þ Dans
"Le Monde - La lettre de
l'Education n°263 du 15/3/99" il est fait référence à Claude ALLEGRE
indiquant, lors de la conférence des directeurs d'IUFM le 11 mars, que "les sortants de l'I.U.F.M. devront être suivis par groupe de sept ou huit,
pendant trois ans, par des formateurs. Un rendez-vous obligatoire les accompagnera plusieurs fois dans
l'année pendant leur début de carrière."
þ Déjà
en 1986, Pierre DUCROS et Diane FINKELSZTEIN dans
L'école face au changement nous
présentent "Des stratégies de
diffusion et d'accompagnement des
innovations scolaires" en particulier avec "un modèle de dispositif de ressources efficace pour l'aide à la
professionnalisation des enseignants (stratégie de réseau)" où "il ne s'agit pas de donner des cours ou
d'apporter des solutions toutes faites" mais plutôt de "tisser des liens et de traiter rapidement
les demandes qui seront formulées", et de "travailler selon une logique de résolution de problèmes".
þ Guy
LE BOTERF traite de "la fonction d'accompagnement d'un
processus de formation-action", fonction pédagogique qui vise
essentiellement à :
-
aider
le groupe-acteur à nommer ce qu'il fait et repérer les difficultés qu'il rencontre
(activité de conceptualisation);
-
mettre
le groupe-acteur en relation avec des ressources ;
-
fournir
des apports directs de connaissances ;
-
aider
le groupe-acteur à faire le point sur sa démarche et sa progression.
þ En
1994, Michel DEVELAY M., dans Peut-on
former les enseignants ?, écrit à propos du mode de formation personnalisée : "La
personnalisation de la formation vise à aller au-delà de la prise en compte de
l'individu pour s'intéresser aux personnes, dans leurs dimensions culturelles,
mentales, affectives et dans leurs rôles sociaux. Il s'agit donc de penser
la formation comme individualisée, dans le sens d'une auto-formation assistée
mais de surcroît en faisant exister des temps non seulement d'assistance - avec
ce que ce vocable possède de technique - mais des temps d'accompagnement - de «compagnon», qui partage son pain
avec. Ainsi, si auto-formation assistée conduit au plan logistique à faire
exister des centres de ressources performants et des formateurs capables
d'assistance technique, la formation personnalisée conduit au plan logistique
aux mêmes obligations, en substituant au formateur technicien, un formateur accompagnateur. Il s'agit
de créer en formation les conditions de la rencontre entre un «se formant» et
son accompagnateur, associés à une
tâche commune qui est d'identifier ce qui fait problème, d'adopter alors une
attitude de formulation d'hypothèses qui simultanément s'appuie sur un lieu de
ressources et se rend attentive aux contraintes de la situation à démêler,
d'envisager alors des possibles, de mettre en actes ses choix en s'étant
accordé les moyens de son action. On conçoit, dans cette perspective, qu'une
formation personnalisée entretienne des proximités avec la dimension
psychologique que nous avons développée précédemment car elle peut permettre
d'analyser la nature des relations d'identification qui se jouent dans tout accompagnement."
Michel
DEVELAY précise les caractéristiques du formateur pour une Formation
personnalisée : "C'est un
accompagnateur vivant avec le formé une plus grande proximité car se sentant
partie prenante de sa formation".
þ En
1997, une Université d'Eté s'est
tenue sur le thème "Accompagnement et formation" ; elle a donné lieu à publication d'actes
sous la direction de Georges CHAPPAZ, actes dans lesquels nous pouvons lire :
"Se développe une nouvelle fonction que l'on
nomme accompagnement qui vise entre
autres à aider le sujet à construire des liens qu'il ne saurait établir
spontanément seul.
Cette nouvelle fonction de médiation, selon WINNICOTT, met à la
disposition de l'autre un appareil psychique différent et plus performant.
Toutefois, elle implique de
la part de l'accompagnateur des
compétences d'écoute, d'aide à l'explication et d'aide à la prise de décision."
Pour
Gérard VERGNAUD,
cité dans cet ouvrage :
"La nouvelle problématique à laquelle les
enseignants, les formateurs, les chercheurs sont confrontés aujourd'hui et de
rechercher des modalités pratiques d'articulation entre des temps
"courts" (ceux de la classe, du programme, des élèves en situation
"ici et maintenant") et des temps "moyens ou longs" qui
sont ceux du développement… réussir cette articulation est aujourd'hui le plus
grand défi qui est posé tant aux chercheurs qu'aux praticiens."
Nous
percevons déjà qu'à la notion d'accompagnement est associée l'inscription dans
le temps/durée. Nous référant à Jacques ARDOINO, nous dirons qu'avec une telle
approche il y a inscription dans un "projet-visée" et non dans un
"projet-programmation".
Pour
Mireille CIFALI,
dans son intervention intitulée "Une altérité en acte" :
“Accompagner : au minimum c’est “aller avec”. Nous sommes dans
l’efficience d’une intersubjectivité. L’autre compte, il y a de la relation en
acte, on se meut et on se déplace sur un chemin qui est d’abord le sien. Celui
qui accompagne occupe une position particulière, où les problèmes de l’altérité
se présentent aigus, exigeants et incontournables.
Chaque
fois où quelqu’un est confronté à une expérience, un projet qui exige pour
aboutir son engagement à nul autre substituable, un accompagnement peut être une posture adéquate. Il y a cependant des
écueils et des extrêmes à éviter, des leurres à perdre. Entre dépendance et
solitude, où se situe l’accompagnement ? Et quelle est cette position ? Aide,
soutien, guide, pourvoyeur d’outils, de repérages, de références ... On y
navigue forcément entre imposition et autorisation.
Quelque
soit la difficulté ou l’épreuve, l’accompagnant
a la nécessité de s’y repérer pour ne pas sombrer avec, d’être dedans mais
aussi dehors, de s’engager sans s’y perdre : travail psychique afin de
maintenir une bonne distance, une juste mesure. Certaines qualités d’être et de
savoir sont importantes : fiabilité, authenticité, sincérité, discernement,
fidélité, capacité de sortir de soi, intelligence de l’instant sont
nécessaires. Acquiert-on, et comment, la capacité
d’accompagner ? Faut-il avoir été soi-même très loin dans la quête du
savoir, dans le repérage de vie, dans l’expérience professionnelle ? L’accompagnement convoque sans nul
doute une sagesse et une éthique particulière, un rapport spécifique au savoir
et une mobilisation particulière de la théorie. En quoi la notion de “démarche
clinique” aide-t-elle à nous y repérer ?
On
écrit un accompagnement à la
première personne et on y intègre un “tu” ou un “vous”. L’auteur y est donc
invariablement un “nous”.”
Accompagner c'est "savoir être
là", c'est "être pris dans une énigme", c'est "être
intelligent dans les situations singulières" ce qui nécessite des
"connaissances extraites des sciences humaines" mais aussi des
"compétences relationnelles". C'est "construire des
connaissances à même le vivant". C'est "restituer à celui qui est
tellement engouffré dans le présent son rapport à un passé et un futur". C'est
"être fiable" et "accepter l'incertitude".
Accompagner c'est "aller
avec", "être à côté de", "donner une place à l'autre"
; c'est "intégrer le fait que l'on ne peut pas agir et décider à la place
de quelqu'un", "s'éloigner de la prise de pouvoir qui peut advenir si
facilement dans nos métiers".
Pour
qu'il y ait accompagnement il faut
qu'il y ait demande. (mais comment travailler avec ceux qui ne demandent rien,
qui sont en résistance passive ?)"
Cet
accompagnement, pour Mireille CIFALI, trouve tout son sens dans la démarche
clinique qu'elle met en avant, démarche qui permet entre autre de construire
des savoirs de la pratique avec les acteurs ou, selon l'expression médicale,
"au chevet du patient".
þ Marc
DENNERY
s'interrogeant sur "Comment appliquer les connaissances acquises à la suite
d'une formation" parle de tutorat, de parrainage, d'accompagnement par le responsable hiérarchique, par le formateur
externe ou par l'expert pour "transformer
des connaissances théoriques ou pratiques en compétences maîtrisées,
c'est-à-dire en savoir, savoir-faire et savoir-être immédiatement mobilisables
dans une situation professionnelle donnée".
Pour
lui, l'accompagnement par le responsable hiérarchique n'est peut-être pas le
plus simple à mettre en œuvre ni celui qu'il faut développer le plus (...) la
relation hiérarchique induit parfois des comportements qui peuvent entraver le
bon déroulement du coaching. il évoque la nécessaire préparation - formation
des responsables hiérarchiques à l'accompagnement.
þ Dans
la revue profession formateur consultant
n° 2 – 1998, il est question de coaching
ou accompagnement individualisé et de team-building
ou accompagnement d'un groupe, d'une équipe. Le LAROUSSE fournit comme
définitions relatives à ces deux termes :
-
ACCOMPAGNEMENT ou TEAM-BUILDING
:
Action
d'accompagner et de guider un groupe ou Aider les équipes à développer
simultanément leur efficacité et leur harmonie (Le Larousse).
- COACHING ou ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE :
Action
de conseil individuel, d'accompagnement de collaborateurs, quel que soit leur
domaine d'activité professionnel, qui vise à les aider à se développer. (Le
Larousse).
Le
coaching permettant à l'accompagné de :
- "comprendre
les relations aux autres et de développer ses propres capacités ;
- pouvoir
dire dans un cadre protégé ce que l'on ne peut pas, ne sait pas, ne doit pas
dire ailleurs ;
- pouvoir
entendre ce que l'on ne peut, ne veut pas entendre, comprendre ailleurs ;
- pouvoir
être stimulé dans la co-action, c'est-à-dire encourager."
Mais pour Jean-Yves ARRIVÉ, directeur pédagogique et
maître de conférence, "rien de
surprenant à ce que le coaching fasse l'objet de controverse : son introduction
dans l'entreprise est récente. (…) Il reste aussi des tabous à briser, l'un
d'eux résiste plutôt bien : un dirigeant, un manager qui sollicite une aide, un
conseil, une écoute, est souvent jugé comme faible, indéterminé, parfois même
incompétent. Cela doit changer."
þ Dans
le rapport qui porte son nom, le Recteur PAIR écrit
:
"Le
pilotage n'est donc pas seulement décision mais aussi régulation. Pour sortir
de la “bureaucratie qui se nourrit de la non connaissance des situations
particulières, la régulation doit avoir un caractère de proximité : elle est accompagnement. Un responsable ne peut
donc l'exercer que pour un nombre relativement réduit d'unités ou de personnes.
(...)
Le rôle des équipes de circonscription
L'accompagnement des enseignants, en particulier débutants, par l'équipe de
circonscription (inspecteur et conseillers pédagogiques) constitue une richesse
du premier degré, qui manque cruellement dans le second degré.
(...)
Ce qui doit évoluer
Un accompagnement de l'action des enseignants pas assez
continu :
Le
premier niveau de régulation est la circonscription dirigée par un IEN : en
effet, les directeurs d'école n'ont aucune prérogative en ce domaine. Or un IEN
a la responsabilité de 300 enseignants en moyenne, qui en milieu rural peuvent
travailler dans plus de 70 écoles. Ces nombres sont trop élevés pour permettre,
non pas un pilotage de nature hiérarchique, mais une régulation qui soit un accompagnement continu et se traduise
par de véritables échanges entre les enseignants et leur responsable. Cette
insuffisance est une seconde explication des difficultés signalées plus haut
dans l'application des politiques définies au cours des dernières années et de
la faiblesse des résultats de certains enfants."
þ Dans
les travaux et réflexions des stages P.N.F., il est aussi question
d'accompagnement. Ainsi, par exemple, dans la fiche guide de stage du document
méthodologique produit en 1997, nous lisons :
-
Envisager un accompagnement sous des
formes différentes :
Ÿ groupes d’analyse de
pratiques,
Ÿ animation pédagogique
pour approfondissement,
Ÿ stage "deuxième
niveau",
Ÿ éventuellement accompagnement individuel, à la
demande...
Jacques
LEVINE, au cours de son intervention dans ce stage a évoqué le groupe de
"soutien au soutien" qui est d'abord un groupe d'accompagnement voulant rompre l'isolement des enseignants
qui viennent s'y ressourcer (effet de ressourcement interne).
þ Pour
terminer ici cette actualisation, j'évoquerai la nouvelle collection éditée par
le C.R.D.P. de MONTPELLIER dont le titre est "ACCOMPAGNER" et dont les objectifs sont "d'accompagner notamment les innovations dans
le système éducatif, de montrer la diversité des pratiques et des approches
pédagogiques, privilégiant l'ouverture sur la pluralité des usages et évitant
la rigidité des figures imposées."
L'idée
d'accompagnement est donc bien présente dans le milieu éducatif, dans le monde
enseignant ; elle concerne des personnes, des groupes, des dispositifs,
des projets… Elle s'inscrit dans une relation d'aide dans la proximité et la
durée. Mais accompagner l'Autre relève-t-il de l'innéité ?
DES COMPETENCES NECESSAIRES
ET DES ROLES
:
Ceux qui parlent d'accompagnement évoquent, comme
CHAPPAZ et CIFALI en particulier, des compétences nécessaires à tout
accompagnateur.
Pour Marie-José LACROIX, formatrice-consultante et
coach :
"Le
formateur se situe au niveau de l'expertise d'un savoir et d'une qualité
d'animation. En ce sens il est plutôt centré sur un contenu et une relation.
Dans le
coaching, la compétence du coach se situe certes dans sa formation, ses
expériences, ses savoirs, sa culture, mais plus encore dans son être, dans sa
capacité à accueillir totalement l'autre pour ce qu'il est, ainsi qu'à l'accompagner sans jamais se substituer
à lui. (…) Parler moins, écouter plus, entendre mieux ; au lieu d'apporter les
"bonnes" réponses, poser les bonnes questions."
Beaudour ALLALA
quant à lui liste une série d'aptitudes nécessaires au coach :
- "Ecoute
active- - Faculté d'observation
- Compréhension- - Lucidité vigilante
- Mobilisation
des ressources- -
Objectivité
- Médiation- -
Conscience de soi
- Sens
aigu de la psychologie humaine- -
Patience…
- Perception
de la réalité
Excellent
conseiller plutôt qu'expert, ajoute-t-il, l'accompagnateur doit être, en quelque sorte, le miroir de l'accompagné pour qu'il y
reflète sa situation actuelle."
Jacques
LEVINE évoque le "deuil de la toute puissance" et le
"renoncement à vouloir modifier l'Autre" qui devrait déboucher sur
"la recherche du modifiable avec l'Autre".
Pour
Marc DENNERY,
le coach, l'accompagnateur doit exercer quatre rôles principaux :
- écouter (s’intéresser à l’Autre, accepter
l’Autre, rechercher activement de l'information, renvoyer à l’Autre ce qu'il
induit).
- orienter ("plutôt que de lui donner le poisson, apprends-lui à pêcher" :
aider à traduire les connaissances acquises, à définir les objectifs, à évaluer
les résultats)
- sponsoriser (rendre l'environnement du stagiaire
réceptif, devenir le supporter, ouvrir les portes)
- reconnaître et encourager.
Gérard WIEL
dégage quatre fonctions pour l'accompagnateur :
- écouter
- clarifier
- proposer
- aider à décider
ces fonctions permettant, à une personne ou une
équipe, par la médiation de l'écoute, de l'analyse systémique, de l'analyse de
pratiques, de passer d'un état à un autre par une ou des transformation(s) dans
le cadre d'une institution et sur une durée.
Il
apparaît donc que l'accompagnement se fonde sur des valeurs et des principes
que l'on puisera en particulier dans le constructivisme et l'humanisme et qui
pourraient laisser penser à une déontologie de l'accompagnateur.
DES TYPOLOGIES
D'ACCOMPAGNEMENT
Après
ces premiers éclaircissements, nous pourrions nous demander en quoi consiste ou
devrait consister l'accompagnement d'enseignants. L'expérience et l'analyse de
pratique fait apparaître plusieurs champs d'accompagnement :
- l'accompagnement pédagogique (dans les dimensions
éthiques, éducatives, didactiques, praxéologiques, etc.)
- l'accompagnement psychologique (soutien, encouragement,
gratification, etc.)
- l'accompagnement matériel (prêt de documents, d'outils,
etc.)
- l'accompagnement social (intégration à un groupe,
travail en équipe, etc.)
- l'accompagnement professionnel (aide à une
qualification, développement de compétences, etc.)
- l'accompagnement formatif (cf. l'évaluation
formative/formatrice et la Zone Proximale de développement)
- ...
DES TYPOLOGIES D’ACCOMPAGNÉS
La
question peut se poser de savoir qui accompagner, qui a besoin d’accompagnement
? A cette question, plusieurs réponses problématisantes possibles.
L’accompagnement peut concerner :
Ø un enseignant débutant dans la
profession et/ou dans une pratique pédagogique et/ou sur un nouveau poste ;
Ø un enseignant qui rencontre des
difficultés dans son métier d’enseignant/éducateur, sachant qu’il y a :
· les enseignants qui ont conscience de leur difficulté avec
*
ceux
qui osent l’exprimer ;
*
ceux
qui n’osent pas l’exprimer ;
· les enseignants qui
n’ont pas conscience de leur difficulté et dont l’entourage en a parfois
conscience ;
Ø un enseignant qui souhaite améliorer,
modifier sa pratique ;
Ø un enseignant qui souhaiterait mener une
recherche
Ø un enseignant qui souhaite une
professionnalisation par une qualification nouvelle (par exemple passer le
CAFIPEMF)
Ø etc.
Aumond-Berlencourt C., Innovez ! de
l'injonction à l'accompagnement organisé, ESP, 1992.
BOUVIER et OBIN, La formation des enseignants sur le terrain,
Paris, Hachette.
CHAPPAZ G., (sld) Accompagnement et formation, Marseille,
CRDP et Université de Provence, 1998.
DENNERY M., Organiser le suivi de la formation ; méthodes et outils, Paris, ESF, 1997.
DEVELAY M., Peut-on former les enseignants ?, ESF, Paris, 1994
DUCROS P. et
FINKELSZTEIN D., L'école face au
changement, Grenoble, CRDP et MEN, 1986.
LE BOTERF G., L'ingénierie et l'évaluation de la formation,
Paris, Les éditions d'organisation, 1993.
WIEL G., Sortir du mal-être scolaire - Promouvoir la
fonction accompagnement, Saint-Etienne, Chronique sociale, 2000.
p
p p
@ Patrick
ROBO ?
PRAXIS
Les
métiers d'Enseignant, de Directeur
d'école, de Conseiller Pédagogique, de Psychologue, de Rééducateur en
psychopédagogie, de Formateur… ne sont pas simplement des métiers techniques, encore moins des
métiers mécaniques ; ce sont des métiers
de l'humain comme le dit souvent Mireille CIFALI, car ils agissent,
travaillent, sur, avec l'Autre mais aussi sur Soi avec son identité
professionnelle et son identité privée.
Ce
sont des métiers qui impliquent, qui engagent dans une double responsabilité
–sur les Autres et sur Soi–, qui modifient la personne et qui invitent,
conduisent au questionnement en relation avec l'évolution inéluctable du
métier.
Dès
lors que l'on s'inscrit dans une praxis, pratique
réfléchie et réflexive au sens où l'entend Francis
IMBERT, il devient incontournable
d'interroger, d'observer, d'analyser, de chercher à comprendre l'acte éducatif
ou de formation qui relève toujours de l'énigme sinon du pari. Mais chacun sait
qu'il est difficile, voire impossible de faire cela lorsque l'on est impliqué,
dans l'action, "le nez dans le guidon". D'où une nécessaire prise de
distance, de recul qui aidera à donner, trouver de l'intelligibilité à toute
action.
Cette
distanciation peut certes s'effectuer seul, mais elle est bien plus riche dès
lors qu'elle sera conduite à plusieurs, que l'on réfléchira, pensera, essaiera
de comprendre avec d'autres, tout particulièrement des pairs, dans une démarche
dialogique afin d'élaborer un savoir
de l'expérience, un savoir de la pratique.
Nous
savons que cela n'est pas coutumier dans le monde de l'éducation, que c'est
même parfois délicat – ce qui ne signifie pas impossible – et qu'il existe
plusieurs attitudes, plusieurs démarches pour interroger son métier dans une
démarche professionnalisante. En tout état de cause, il reviendra à chacun de
construire son savoir par une intelligence des situations, des actes
et actions.
DEMARCHE CLINIQUE
A l'instar de la médecine, nous
dirons ici que les "métiers de l'Education-Formation" peuvent être
examinés, pensés, réfléchis, améliorés, régulés par une démarche clinique.
Qu'entend-on
par démarche clinique ? Pour les médecins il s'agit de chercher,
s'interroger, comprendre et donc d'apprendre au chevet du patient. En ce qui
concerne l'enseignement et la formation il s'agira d'apprendre dans la
situation, l'action, l'acte pédagogiques ou andragogiques.
D'aucuns
diront peut-être que les Sciences de l'Education, les Sciences humaines
apportent suffisamment d'informations, voire des réponses… Mais chaque
enseignant, éducateur, directeur, formateur, etc., dans sa pratique
quotidienne, dans le feu de l'action, sait bien que cela n'est pas le cas tout
simplement parce que les lois générales de ces sciences de s'appliquent pas à
chaque situation, à chaque individu qui sont singuliers à l'instant
"T" où l'on agit. D'où la nécessité, plus particulièrement pour ce
qui pose problème, parfois (souvent) de manière énigmatique, d'essayer de
comprendre dans une démarche en trois temps, inspirée de Lacan :
-
le
temps de voir ;
-
le
temps de comprendre ;
-
le
temps de conclure (qui peut vouloir dire initier une nouvelle action).
Pour
Mireille CIFALI et Philippe. PERRENOUD qui la définissaient dans un fascicule
destiné aux
étudiants de l'Université de Genève qui se destinent au métier d'enseignant,
"La démarche clinique est
une façon de prendre du recul vis-à-vis d'une pratique : elle se fonde sur
l'observation, qu'il y ait problème ou non ; elle permet d'élaborer des
hypothèses et/ou des stratégies d'action par la réflexion individuelle ou
collective, la mobilisation d'apports théoriques multiples, des regards
complémentaires, des interrogations nouvelles. Elle sollicite des
personnes-ressources qui mettent en commun leurs points de vue pour faire
évoluer la pratique ainsi analysée. C'est un moyen de faire face à la
complexité du métier d'enseignant en évitant le double écueil d'une pratique
peu réfléchie ou d'une théorie déconnectée des réalités vécues (…) elle peut,
dans certains domaines s'inspirer d'une démarche expérimentale, dans d'autres
s'apparenter à une recherche-action, dans d'autres encore emprunter certains
outils ou paradigmes à la supervision ou à la relation analytique."
POSTURE ET ETHIQUE
La
démarche clinique, cette analyse de pratique, peut s'ancrer dans du récit oral,
dans de l'écrit, sous forme d'histoire de vie, de journal de bord, d'analyse de
situation… Elle présente l'intérêt de s'inscrire dans la durée, l'alternance
(temps de pratique, temps d'analyse, etc.) et prend appui sur l'expérience dans
les deux sens du terme (habitude et tentative) produisant du savoir de
l'action.
Nous sommes donc ici dans le paradigme de la
"Formation-Action" qui permet de se former en
agissant et non plus de se former d'abord pour agir ensuite.
Cette démarche, à l'inverse du modèle
applicationniste et/ou prescriptif demande à chacun, sujet, d'être acteur,
voire auteur, d'être responsable de sa
formation, de sa pratique et de leur théorisation. Elle offre une grande place
à la parole (orale, écrite) et à l'écoute de l'Autre, de Soi. Elle conjugue
plusieurs champs théoriques par l'approche multiréférentielle, notamment les
dimensions constructiviste, socio-constructiviste, systémique,
interactionniste… et table sur l'élaboration puis l'utilisation de compétences
collectives.
Mais il est évident que l'analyse de pratiques
fondée sur la démarche clinique demande une prise de risque :
-
pour
les "en formation" par le fait d'être invités à s'exposer et d'être
conduits à se mettre en question (et non nécessairement en cause) ;
-
pour
les formateurs qui ne sont plus dans la "maîtrise" mais dans
l'accompagnement, la médiation, la guidance, le partage et parfois le doute.
La formation par la démarche clinique suppose donc un changement de posture des formateurs
ainsi que des "en formation" et présente l'avantage d'être en
cohérence avec un acte éducatif (un acte formatif) qui aidera l'apprenant, le
"se formant" à ne plus être dans une attente de transmission de
savoirs normés, pré-établis et figés, mais à construire ses propres savoirs, à
se construire dans la réflexivité et le conflit (cognitif, socio-cognitif). Question d'éthique…
HYPOTHESES
Pour Mireille CIFALI,
la démarche clinique est basée sur un certain nombre d'hypothèses :
Hypothèse 1 : Tout
enseignant est impliqué dans son métier et ne peut fonctionner en
extériorité ;
Ø
L'implication nécessite une mise à distance.
Hypothèse 2 : Chaque
professionnel ne travaille que sur des situations singulières (même s'il a bien
préparé sa séance qui évoluera en fonction de la complexité des paramètres en
jeu). Nous agissons toujours dans la subjectivité et enseigner, former c'est sde
confronter à l'Autre.
Ø La
singularité de nos gestes mérite/nécessite d'être comprise car comprendre
permet d'éviter des actions destructrices (des Autres et/ou de Soi).
Ø Tout
se passe dans le menu détail, dans le minime, dans le banal et les cours de
Formation Initiale, de Formation Continue ne permettent pas de, ne suffisent
pas à estimer, saisir ce détail qui fera "grain de sable", mais…
Ø La
connaissance des théories permet de comprendre, de construire du sens. A chacun
d'intégrer les théories dans sa pensée propre.
Hypothèse 3 : Il doit
m'être possible de revenir sur mes actes pour les travailler car quand j'agis,
l'Autre réagit et je dois comprendre ce qui se passe pour continuer à agir.
Ø Les
difficultés doivent être traitées sans jugement (vrai ou faux ; bien ou
mal).
Hypothèse 4 : Il n'y a pas
de clivage entre la sphère privée et la sphère publique chez l'enseignant, le
formateur.
Ø La
peur,
l'angoisse, le plaisir sont là.
Ø J'apprends
toujours de l'Autre, élève, collègue… qui m'oblige à penser.
Hypothèse 5 : Les
praticiens n'écrivent pas parce qu'ils pensent qu'il faut écrire comme les théoriciens.
Ø La
transmission de l'expérience, l'analyse de la pratique se fait aussi par le
récit ; raconter une histoire, c'est déjà la comprendre.
Ø Ecrire
permet de (se) mettre à bonne distance.
ANALYSE DE PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Dans ce cadre-là, l'analyse de
pratiques professionnelles (A.P.P.) permettra une réflexion sur sa pratique,
une auto et/ou co-régulation de celle-ci, une formation au service de la praxis
et ce par un positionnement que l'on pourrait qualifier de "méta-cognitif".
Nous présenterons ici la mise en acte d'un Groupe d'Entraînement à l'Analyse de
Pratiques Professionnelles (G.E.A.P.P.) auprès de différentes catégories
professionnelles : enseignants débutants ou non, directeurs d'écoles,
conseillers pédagogiques…
Ø UN CADRE THEORIQUE :
L'analyse
de pratiques professionnelles se fonde sur des théories et paradigmes
complémentaires :
-
le constructivisme : le sujet construit
lui-même son savoir, ses schèmes, ses réalités à partir d'un "déjà
là" .
-
le socio-constructivisme : le sujet se forme
avec/contre les autres ;
-
la multiréférentialité : tout acte
pédagogique et/ou de formation est constitué d'objets (théoriques et pratiques)
pluriels et souvent hétérogènes entre eux ;
-
l'interactionnisme ou la systémique: les personnes, les choses,
les phénomènes, les groupes agissent entre eux ;
-
l'approche compréhensive : en référence à
l'épistémologie des méthodes qualitatives, cette approche est
caractérisée par la complexité, la recherche de sens, la
prise en compte des intentions, de motivations, des attentes, des
raisonnements, des croyances, des valeurs des acteurs.
Ø DES OBJECTIFS :
L'analyse de
pratiques professionnelles, en groupe, a pour objectifs de :
F Aider un acteur-professionnel impliqué
à y voir clair dans le cas évoqué : donner plus d'intelligibilité à un
vécu, le sien, sans pour autant lui apporter des réponses ni des conseils.
F Construire des "contre-schèmes de
vigilance et d'anticipation" ;
F Permettre à d'autres
acteurs non-impliqués :
-
d'analyser
la situation,
-
de
mieux appréhender des situations analogues vécues personnellement,
-
de
se préparer (former) à des situations semblables à venir.
F Permettre de comprendre par
homomorphisme d'autres situations
éducatives (niveau adultes ou enfants)
F Permettre de s'entraîner,
de se former à l'A.P.P.
F …
A noter qu'un Groupe
d'Entraînement à l'Analyse de Pratiques Professionnelles (GEAPP) n'est
pas :
·
un groupe de dynamique de
groupe
·
un groupe de thérapie
·
un groupe de production
·
un groupe de parole libre
·
un groupe de conseil(s)
Un G.E.A.P.P. est à la fois groupe d'ANALYSE et
groupe d'ENTRAINEMENT à l'analyse ; c'est un groupe de FORMATION
PROFESSIONNALISANTE et ACCOMPAGNANTE.
Ø DES PREALABLES
L'analyse de pratiques professionnelles en groupe
requiert des conditions premières :
G Démarche personnelle et volontaire de
participation ;
G Respect de l'Autre et de sa
parole ;
G Confidentialité : "ce qui est dit ici n'en sort
pas" ;
G Liberté d'expression dans le cadre
adopté ;
G Respect du fonctionnement, du rituel ;
G Gestion rigoureuse du temps ;
G Assiduité du groupe sur une période
choisie ;
G Régularité des réunions (rythme et
alternance)
Ø DES COMPETENCES
L'analyse de pratiques professionnelles en groupe nécessite
certaines capacités et compétences chez les participants-praticiens :
F Accepter d'être responsable de ses actes
(sans être coupable) ;
F Accepter la confrontation à soi, à l'Autre,
aux Autres ;
F Admettre l'incertitude ;
F Savoir écouter ;
F Savoir émettre des hypothèses de
compréhension (de ce qui s'est passé) ;
F Eviter le conseil (tu aurais dû ; à ta place je…) ;
F Renoncer à vouloir modifier l'Autre (mais
plutôt rechercher avec lui ce qui est modifiable) ;
F Faire le deuil de la toute puissance ;
F …
nb : il est évident que toutes ces compétences ne
sont pas convoquées en même temps et dans toutes les situations analysées, et
ce, que l'on soit exposant, animateur, participant, observateur.
Ø UNE APPROCHE MULTIREFERENTIELLE
Chaque situation, chaque cas évoqué sera analysé,
dans la mesure du possible, au travers de plusieurs approches :
-
Dimension
institutionnelle (le cadre officiel, les statuts et rôles, les lois et règles…)
-
Dimension
sociologique (le cadre de vie et de travail, position dans le groupe et la
société, phénomènes de groupe…)
-
Dimension
psychologique (la personne –sans mener un examen psychologique–)
-
Dimension
psychanalytique (avec l'aide d'un expert. Mais savoir que l'inconscient est là
et qu'il parle…)
-
Dimension
axiologique (les valeurs en jeu, en "je")
-
Dimension
téléologique (les finalités de l'action)
-
Dimension
pédagogique/andragogique (la didactique, la praxéologie, les techniques, le
matérialisme…)
-
Dimension
théorique (les théories sous-jacentes en œuvre)
-
Etc.
Nb : Le but est de travailler sur des variables mises en réseau, à
partir d'éléments informationnels (indices) prélevés en tant que faisant partie
d'un tout, pour passer de l'implication à l'explication en se rappelant
que :
-
expliquer, comprendre relèvent de la CONNAISSANCE ;
-
juger relève de la VALEUR,
de la NORME ;
-
raconter c'est déjà
organiser et donner du SENS
Toute situation analysée met généralement en scène, souvent de manière
dialectique et a minima :
-
Un sujet et une
personne ;
-
Une fonction et un statut,
des rôles ;
-
Une action et une pratique
ou une praxis ;
-
Des savoirs et des
capacités, des compétences ;
-
Des valeurs et des idées,
des opinions, des croyances, des représentations ;
-
Des relations interpersonnelles
et de groupes, institutionnelles ;
-
Un cadre espace/temps/durée
-
…
Ø UNE TECHNIQUE
Plusieurs techniques, ou plutôt variantes existent
pour l'analyse de situations ou de pratiques. Le G.E.A.P.P. repose sur :
þ Une dizaine de séances de trois heures dans
l'année ;
þ Chaque séance est cadrée, délimitée
par :
-
le
temps (minuté)
-
les
phases (4 à 6)
-
le
contenu (situation professionnelle, éducative ou de formation)
-
des
règles de prise de parole et de respect des participants et du fonctionnement.
þ Des phases successives :
-
Le
rappel des principes et du fonctionnement du G.E.A.P.P. (0 à 5 minutes)
-
L'exposé
d'une situation par un exposant volontaire (10 à 15 minutes)
-
Le
questionnement par les participants (15 à 45 minutes)
-
L'émission
d'hypothèses -pour aider à analyser, comprendre la situation et/ou induire la
recherche du modifiable- (15 à 45 minutes)
-
La
reprise de parole de l'exposant (0 à 5 minutes)
-
L'analyse
du fonctionnement -hors le cas exposé- (5 à 30 minutes)
þ Une animation-régulation par un
animateur compétent et volontaire.
Ø UN OBJET DE TRAVAIL/FORMATION
Le récit oral ou écrit d'une situation
professionnelle vécue personnellement par un exposant et qui lui pose question
ou problème sera l’objet, le support du travail de l’analyse et donc de la
formation.
Ce récit se fera sous forme d'expression libre
laissée à l'initiative de l'exposant sachant que la durée de présentation
(exposition) est limitée dans le temps de parole (ou de lecture) et qu'elle
doit apporter le maximum d'éléments dans ce temps contraint.
FORMATION ACCOMPAGNANTE
L'analyse
de pratiques professionnelles telle qu'elle vient d'être évoquée au travers
d'un Groupe d'Entraînement et d'Analyse se présente comme un processus et un
dispositif de formation inscrits dans la durée et présentant l'avantage d'accompagner les personnels volontaires
pour y participer.
Nous
avancerons l'idée qu'il s'agit là d'une "formation accompagnante" pouvant s'intégrer dans une démarche
de formation initiale ou continue, formation
certes différente des schémas habituels (stages, séminaires, conférences
pédagogiques…) mais dont la cohérence
avec les théories d'apprentissages aujourd'hui préconisées dans l'enseignement
est évidente.
Ce
dispositif de formation est intéressant à divers titres ; pour conclure nous en
retiendrons quelques uns :
-
La
centration sur des personnes impliquées et s'impliquant ;
-
L'inscription
dans l'alternance et la durée ;
-
La
mise en œuvre avec des moyens institutionnels existants ;
-
La
souplesse et l'adaptabilité organisationnelles ;
-
La
professionnalisation de chacun par les effets produits sur tous les
participants ;
-
La
production de savoirs de la pratique favorisant la théorisation de celle-ci ;
-
La
démultiplication par des formateurs ayant eux-mêmes vécu l'analyse de pratiques
professionnelles…
Outre
ces points d'intérêt il en est un qui mériterait d'être plus particulièrement
souligné ici car trop peu exploité en tant que moyen de formation pour des
adultes : nous évoquerons ici la co-formation
entre pairs.
A
ce niveau de conclusion nous pourrions alors envisager une réflexion sur des principes de formation inspirés du compagnonnage, principes qui favorisent à la fois transmission et mutualisation,
assimilation (de savoirs) et créativité, technicité et humanisme,
perfectionnement et accompagnement… et pourquoi ne pas penser alors à des
"dispositifs d'accompagnonnage"
au service d'une formation continuée
?
& & & & & & &
PETITE
BIBLIOGRAPHIE PRATIQUE
ARDOINO J., L'approche multiréférentielle en formation et en sciences de
l'éducation, Pratiques de formation (analyse), Paris, Université Paris
VIII, 1993.
ALTET M., La formation professionnelle des enseignants, Paris, PUF, 1994.
ALTET, M., Les compétences de l'enseignant-professionnel : entre savoirs,
schèmes d'action et adaptation, le savoir-analyser, in Paquay, L., Altet,
M., Charlier, E. et Perrenoud, Ph. (dir.), Former
des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles
compétences ?, Bruxelles, de Boeck, 1996, p. 27-40.
BLANCHARD-LAVILLE C. et FABLET D., Analyser les pratiques professionnelles,
Paris, L'Harmattan, 1998.
BLANCHARD-LAVILLE C. et FABLET D., L'analyse des pratiques professionnelles,
Paris, L'Harmattan, 2000.
Cifali
M., Le lien éducatif : contre-jour
psychanalytique, Paris, PUF, 1994.
DEVELAY M., Peut-on former les enseignants ?, ESF, Paris, 1994.
LEVINE
J., MOLL J., Je est un autre, Pour
un dialogue pédagogie-psychanalyse, Paris, E.S.F., 2000.
Perrenoud,
Ph., Le travail sur l'habitus dans la
formation des enseignants. Analyse des pratiques et prise de conscience, in
Paquay, L., Altet, M., Charlier, É. et Perrenoud, Ph. (dir.), Former des enseignants professionnels.
Quelles stratégies ? Quelles compétences ?, Bruxelles, de Boeck,
1996, pp. 181-208.
CAHIERS PEDAGOGIQUES, Analysons nos pratiques professionnelles,
n° 346, Paris, CRAP, 1996.
JE
EST UN AUTRE, revue de l'Association des Groupes de Soutien Au Soutien
(A.G.S.A.S.) dirigée par Jacques LEVINE - 2 place Général Koenig 75017 PARIS.
& & & & & & &
p
p p
@ Philippe GODẺ ?
L'équipe d'encadrement du stage "accompagnement
de l'entrée dans le métier" (Plan de Formation Lozère) a proposé, dans le
cadre des mercredis filés destinés aux "T1", plusieurs ateliers
de travail dont une présentation du dispositif des GAPP (Groupes d'Analyse de
Pratiques Professionnelles).
Ma collègue (CPC) et moi-même faisons partie
du GFAPP 34. C'est donc dans l'esprit des GFAPP initiés par Patrick ROBO dans
l'Hérault depuis 95/96 que nous avons conduit une séance d'introduction à
l'Analyse de Pratiques Professionnelles à l'IUFM de Mende, mercredi 5 février
après-midi.
Jusqu'au dernier moment, nous avons hésité
sur la stratégie à adopter pour une telle "présentation" : Je sais
que nous, formateurs, sommes en recherche constante face aux conditions
particulières de la mise en place d'un GAPP auprès des
"débutants" (choix de l'exposant, blocages...)
Initialement, nous avions pensé que
j'animerais SEUL un Groupe d'une dizaine de collègues T1 (Pendant que ma
collègue s'occuperait d'un autre Atelier, sur la Direction d'école) : j'aurais
alors procédé à une présentation du dispositif en restituant succinctement les
objectifs, le cadre théorique, le protocole de l'Analyse des PP. Ensuite,
j'aurais proposé une mise en situation avec l'exposition d'un "cas"
par un T1 participant (5 phases sur 80 mn maximum). Dans un dernier temps, nous
aurions eu un débat sur le déroulement de la séance (questions,
commentaires...)
La veille de cette intervention, j'ai passé
un coup de fil à ma collègue car il m'apparaissait, au fur et à mesure
que j'affinais la préparation de la séance, que l'animation d'une situation
SEUL avec des débutants (de plus, enseignants-débutants) présentait un
certain nombre de "risques" : en effet, il faut éviter
toute situation de "blocage" ou toute orientation vers des fausses
pistes possibles (choix de la situation exposée, réponses évasives ou
systématiquement fuyantes de la part de l'exposant dans la phase 2 (temps des
questions), réactions négatives ou sur la défensive dans la phase 4
–conclusion-).
Cela est particulièrement vrai avec un groupe
constitué de personnes qui ne sont pas des "vrais volontaires".
La lecture des messages de la liste et la
consultation des documents GFAPP 34 (cf. Michel Viciana "Une histoire
virtuelle... à analyser"), m'ont conforté dans cette réflexion et cela m'a
conduit à proposer à ma collègue de mener ce travail de présentation à deux.
Elle a proposé de "jouer" l'exposant, pendant que je
"jouerais" l'animateur.
Voici, chronologiquement, le déroulement de
cet après-midi de présentation des GAPP (3 heures) :
A) Analyse de
PP : pourquoi et comment travaille un GAPP ? (1 heure)
- Présentation des objectifs et du cadre
théorique (doc. GFAPP 34)
- L'approche multiréférentielle par
opposition au jugement et au conseil
- Présentation de la Grille "phases d'un
GAPP" / principes de confidentialité, assiduité, sécurité
Commentaires :
Quelques collègues
participants s'étonnent de la "rigidité" du dispositif tel qu'il est
présenté :
- Pourquoi proposer aux participants de ne pas
s'adresser directement, par le prénom par exemple, à l'exposant (mais plutôt
par la fonction). Nous répondons qu'il s'agit de s'adresser au professionnel,
pas à la personne, mais que dans le travail de découverte de cette journée, ils
peuvent passer outre cet aspect.
- Une participante craint que l'on soit dans le
domaine de la thérapie de groupe. Nous démentons en rappelant les aspects
essentiels de la démarche
- Certains T1 montrent une gêne visible quant aux
codes formels : régulation de la parole par l'animateur, les précautions de
langage qu'il faut prévoir lors de l'émission d'hypothèses. Nous rappelons que
le GAPP n'est pas un groupe de parole libre, c'est la règle du jeu qu'il faut
respecter pour poursuivre nos objectifs. Concernant les précautions de
formulation des hypothèses, nous proposons de "vivre" la situation
proposée ci-dessous pour "sentir" les moyens d'expressions adéquats.
B) Mise en situation : vivre 5 phases du GAPP (80 mn)
§ Exposant : D (CPC)
§ Animateur : Philippe Godé,
CPC
§ 20 T1 participants
1-
Phase
0 (5 mn)
Courte ; rappels des principes essentiels donnés en A) et
répartition du temps des phases pour cette séance.
2-
Phase
1 (10 mn)
D (CPC) expose une situation "virtuelle" liée à une
difficulté de direction d'école
3-
Phase
2 (30 mn)
Les participants posent des questions. A aucun moment je (l'animateur)
ne doit noter plusieurs demandes de prises de parole simultanées : les
questions viennent les unes après les autres.
-
43
questions en 30 minutes !
-
13
participants ont posé des questions, 7 n'ont rien dit
-
les
4 premières prises de parole ont été demandées par 4 personnes qui poseront à
elles seules
-
18
questions au cours de la séance.
-
Une
première intervention de l'animateur a été nécessaire car la question formulée
n'était pas claire, et surtout, elle ne permettait pas d'éclairer les
conditions de la situation.
-
Une
seconde intervention a été nécessaire, l'animateur estimant que la question
posée n'en était pas une, et que le participant était déjà sur un travail
d'hypothèse formulé sous forme de question.
4-
Phase
3 (30 mn données, 28 mn utilisées) Émission d'hypothèses
-
La
régulation de la parole est nécessaire, surtout au début la demande est
importante.
-
20
hypothèses en 28 mn
-
Phase
très délicate : on glisse rapidement vers le "jugement " une courte
interruption de la séance paraît même nécessaire à l'animateur pour
rappeler qu'il faut prendre toutes les précautions utiles pour éviter la
perception d'un "jugement" ou un "conseil" par
l'exposant.
-
Dans
l'ensemble, après cette "parenthèse" de quelques minutes, le cadre
est respecté
-
9
personnes ont émis des hypothèses (1 à 4 hypothèses pour chacun d'entre-eux),
donc 11 personnes n'ont pas participé à cette phase. Tous ceux qui ont émis des
hypothèses avaient également participé à la phase 2 (temps des questions)
5-
Phase
4 (5mn)
Ma collègue a joué le jeu de l'exposant : elle synthétise les aspects
de la situation qui lui ont été "révélés" par l'approche multi-référentielle.
C) Questions /
Réponses sur la situation vécue (25 mn)
La difficulté majeure,
exprimée par 2 ou 3 personnes, réside toujours dans la définition de la
frontière qui sépare "jugement" et "hypothèse". 2 personnes
estiment que l'on est "forcément dans le jugement" (phase 3) qui
serait juste "enrobé dans une belle rhétorique" : j'émets
l'hypothèse que...". Cette idée est même poussée à l'extrême par une
participante qui estime que l'on devrait "écouter toutes les parties
concernées par la situation envisagée" car "on a seulement un
son de cloche, celui de l'exposant".
Ces remarques nous ont
permis de reformuler une dernière fois les objectifs que se fixe le GAPP, mais
elles montrent bien les difficultés qui subsistent pour quelques personnes de
ce groupe quant à l'assimilation du cadre théorique et de ses principes
inhérents.
D) Commentaires concernant cette présentation
Pour nous, formateurs, les
difficultés présentée en (C) peuvent avoir plusieurs origines :
-
un
après-midi pour présenter le GAPP, c'est trop court (la journée complète serait
préférable).
-
20
participants, c'est beaucoup : 7 participants ne se sont pas du tout exprimés.
A cause du grand nombre ? Ou bien, au contraire, le grand nombre a-t-il permis
de "se fondre dans la masse" et donc contribué à la désinhibition des
13 personnes qui ont "joué le jeu" ?
-
le
fait que des enseignants "non-volontaires" participent à une
présentation de ce type "brouille les cartes", surtout si le cadre
théorique (socio-constructivisme, multiréférentialité, approche
compréhensive caractérisée par la complexité) n'est pas compris ou pas admis
par quelques personnes du groupe.
-
la
présentation d'une situation "factice" facilite la "prise de
risques" (parole, etc.) pour les participants et permet aux formateurs de
"calibrer" une situation "intéressante" pour les
enseignants (étude de cas) ; en revanche, il est indéniable que l'intensité de
la séance n'a rien à voir avec une situation "réelle" vécue par
l'exposant (les questions, les réponses et les hypothèses "sonnent
faux" dans une situation virtuelle).
-
La
co-animation sous forme d'une espèce de "jeu de rôles" nous (les
formateurs) a parfaitement convenu malgré les quelques remarques évoquées
ci-dessus. Elle présente beaucoup d'avantages et répond au mieux, d'après nous,
aux contraintes du groupe en question (stage d'accompagnement de l'entrée dans
le métier, et non sur la base du volontariat).
Conclusion générale :
A l'issue de l'après-midi du 05 février, les 20 participants T1 ont
bénéficié d'une information générale concernant les GAPP ( un document de
synthèse leur a été donné) et ils ont eu l'occasion de vivre une
"situation", même si elle était factice.
p
p p
REGLES DACTYLOGRAPHIQUES
Les
espaces et la ponctuation
@ ?
|
Signes à UN élément
|
|
|
|
|
|
|
Pas d'espace avant
et après
|
|
|
|
|
|
|
l’apostrophe
|
|
mot
|
'
|
mot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
le trait d’union
|
|
mot
|
-
|
mot
|
|
|
Une espace après
|
|
|
|
|
|
|
le point
|
|
mot
|
.
|
|
Mot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
la virgule
|
|
mot
|
,
|
|
mot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Signes à DEUX éléments
|
|
|
|
|
|
|
Une espace avant et
une après
|
|
|
|
|
|
|
le point-virgule
|
mot
|
|
;
|
|
mot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
le point d’exclamation
|
mot
|
|
!
|
|
Mot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
le point d’interrogation
|
mot
|
|
?
|
|
Mot
|
|
|
|
|
|
|
|
|
les deux points
|
mot
|
|
:
|
|
mot
|
p
p p
Construire
des savoirs et des compétences pour l’enseignement à travers l’interaction
professionnelle
Monique L’Hostie
Professeure, Université du Québec à Chicoutimi
communication
au Colloque de l'AFIRSE-UNESCO – mai 2003
- Introduction
On apprend à enseigner en
enseignant. En cette matière, rien ne vaut l’expérience de terrain. À l’instar
de Schön, nous pensons en effet que l’expérience est source de savoir et que la
pratique produit des connaissances qui ne peuvent être produites autrement qu’à
travers elle. Cela dit, il y a des limites aux apprentissages que l’on peut
faire seul, à partir des situations vécues, même en adoptant une posture de
«praticien réflexif» et en développant, en conséquence, une pratique congruente
d’autoanalyse de ses interventions pédagogiques en vue de les améliorer. Bien
que le travail individuel réflexif demeure nécessaire et bien qu’il puisse être
alimenté par des activités de formation continue telles que des lectures
personnelles, cours, conférences, etc., nous estimons que l’interaction entre
pairs, organisée au sein d’une dyade et d’un groupe d’analyse des pratiques
(Robo, 2002; Perrenoud, 2001), suscite une dynamique d’interaction
professionnelle qui est une puissante source de motivation et de développement
pour ceux et celles qui y participent (Payette et Champagne, 1997).
L’expérience acquise ces dernières années, à travers une pratique de
recherche-action-formation réalisée en collaboration avec un milieu scolaire,
constitue le fondement empirique de la réflexion théorique proposée dans le
présent texte. Cette expérience de terrain a été vécue en tant que professeure
chercheure impliquée avec des enseignants expérimentés dans un processus
collaboratif d’accompagnement de novices qui débutent en enseignement.
Les novices dont il question ici
sont ceux qui débutent dans l’enseignement supérieur, à l’ordre collégial plus
spécifiquement. Au Québec, cet ordre précède immédiatement les études
universitaires de premier cycle ou prépare l’entrée sur le marché du travail de
techniciens de haut niveau. Au seul secteur public, plus de 14 000
personnes, en équivalent temps complet, enseignent dans près d’une cinquantaine
de collèges d’enseignement général et professionnel communément appelés
«cégeps». Au collège, comme à l’université, il n’y a pas d’exigence formelle de
qualification à l’enseignement (par exemple, détenir un brevet d’enseignement)
posée pour l’obtention d’un poste d’enseignant. De fait, dans les cégeps, la
plupart des débutants en enseignement n’ont aucune formation en psychopédagogie
ni aucune expérience en enseignement. Leur formation est essentiellement
disciplinaire et leur expérience de travail, lorsqu’ils en ont une, est liée à
leur champ de spécialisation qui n’est pas l’enseignement (Conseil supérieur de
l’éducation, 2000, 1997). Pourtant, du jour au lendemain, ces personnes sont
plongées dans l’expérience concrète d’enseigner à des groupes d’étudiants et de
faire apprendre dans un environnement scolaire qu’ils ne connaissent que du
point de vue étudiant pour avoir eux-mêmes fréquenté les bancs d’un collège au
temps de leurs études. Pour ces novices, l’apprentissage de l’enseignement se
fait donc d’abord et avant tout dans l’action, «sur le tas» (Lauzon, 2001), de
surcroît dans un climat d’urgence où il y a beaucoup à faire en fort peu de
temps (par exemple : à quelques jours d’avis, préparer ses plans de cours
pour la session, son matériel didactique, planifier les contenus de ses
premiers exposés, se familiariser avec les outils utilisés en stage, etc.).
Ainsi, pour ces débutants en enseignement, l’apprentissage de l’acte
d’enseigner ainsi que la construction d’une identité et d’une pratique
enseignantes s’amorcent en même temps que se réalise l’insertion
professionnelle dans une nouvelle organisation et un nouvel environnement de
travail.
Aujourd’hui, compte tenu des
connaissances dont nous disposons au sujet de la socialisation professionnelle
des enseignants, nous savons que les toutes premières années d’expérience ont
un impact significatif sur le développement professionnel ultérieur de
l’individu; si ces expériences sont négatives, voire traumatisantes, elles
peuvent avoir des effets pervers (Raymond et Hade, 2000). Or, jusqu’à tout
récemment, dans la très grande majorité des établissements dédiés à
l’enseignement supérieur, la question du support aux nouveaux enseignants en
début de carrière a été laissée aux hasards du terrain, relevant
essentiellement du bon vouloir de tout-un-chacun et d’initiatives prises, ici
ou là, par certains collègues plus expérimentés. Consciente des inconvénients
et des limites d’une telle situation, notre équipe de recherche s’est mise au
travail dans le but de mettre au point un modèle d’accompagnement de nouveaux
enseignants qui débutent dans l’enseignement supérieur, plus précisément dans
les collèges d’enseignement général et professionnel (communément appelés
«cégeps»).
Nous avons voulu, en tenant compte
des spécificités du contexte et des acteurs concernés, élaborer un modèle
d’accompagnement qui supporte dès le départ la prise en charge de la tâche
d’enseignement et l’insertion professionnelle dans le milieu, qui stimule
l’élaboration d’une identité professionnelle enseignante et, surtout, qui
favorise la construction de connaissances ainsi que le développement de
compétences nécessaires à l’enseignement. Nous pensons en effet qu’avec le
support de praticiens expérimentés et la mise en place d’un cadre structurant
favorisant l’interaction professionnelle, un débutant en enseignement peut
tirer un meilleur profit de son vécu de terrain que s’il reste isolé
professionnellement et donc, de ce fait, accélérer la construction de
connaissances et de compétences qui lui seront utiles dans l’exercice du
métier. Quant à l’enseignant d’expérience qui s’engage volontairement dans un
processus d’accompagnement tel que celui proposé, nous sommes convaincus qu’il
y trouve matière à enrichir sa propre pratique.
Dans les sections qui suivent, nous
précisons et explicitons les postulats ainsi que les fondements théoriques et
épistémologiques sous-jacents au modèle d’accompagnement mis au point à travers l’épreuve du terrain
depuis deux ans dans un cégep de la région du Saguenay_Lac-Saint-Jean au
Québec. Ainsi, nous verrons qu’une approche de codéveloppement professionnel
fonde le modèle proposé. Cette approche constitue la pierre d’assise d’un
travail collaboratif, impliquant des enseignants expérimentés et des novices,
lequel se structure et s’organise autour des pratiques d’enseignement afin de
les améliorer. Ce travail collaboratif sur les pratiques se réalise à travers
deux modalités complémentaires
explicitées dans le texte : la dyade et le groupe d’analyse des
pratiques. Nous proposons donc un dispositif d’accompagnement conjuguant
analyse réflexive guidée et analyse collective des pratiques. Nous verrons,
dans le corps du texte, que de nombreux bénéfices sont escomptés d’une telle
conjugaison du point de vue de chacun des types d’acteurs impliqués
(enseignants novices et enseignants expérimentés). La clarification des
ancrages du modèle d’accompagnement est associée à une description des
dispositifs concrets de formation à l’enseignement à travers lesquels s’incarne
de façon tangible l’approche de codéveloppement professionnel favorisée afin
d’atteindre les visées poursuivies.
- L’interaction entre collègues comme mode de développement
professionnel
En début de carrière, le novice est
susceptible d’apprendre beaucoup par modelage et par compagnonnage s’il
bénéficie d’interactions riches avec ses collègues. La contribution des
collègues, au sein du département d’attache du novice, peut donc s’avérer
importante en terme de support logistique et de rétroaction significative, en
particulier à des moments clés tels que l’entrée en fonction, le début ou la
fin d’une session, etc. Dans plusieurs milieux d’enseignement, il existe des
pratiques établies de support, d’accueil et d’intégration des nouveaux
enseignants quoique la culture et la tradition départementales et
institutionnelles en cette matière varient considérablement d’un milieu à
l’autre. Une chose est sûre, les collègues expérimentés, par leurs
commentaires, conseils et suggestions, peuvent orienter et éclairer le novice,
lui permettre de valider un certain nombre de décisions à caractère
professionnel. Par exemple, lorsque ce dernier se retrouve d’entrée de jeu aux
prises avec l’épineuse question de la sélection et de la structuration des
contenus à enseigner, l’avis de pairs expérimentés peut alors être très
précieux pour lui. Comme nous l’avons observé lors de notre
recherche-action-formation, la plupart des pratiques existantes ont tout à fait
leur raison d’être et apportent quelque chose au novice (par exemple : une
visite guidée du collège, une remise de la documentation résumant les
principales politiques institutionnelles, l’intégration dans une équipe/cours
ou une équipe/niveau, le partage de matériel pédagogique incluant des plans de
cours, etc.). En général, ces pratiques facilitent l’entrée en fonction, la
prise en charge de la tâche et l’insertion professionnelle dans l’organisation
(département et collège). La contribution des pairs quand elle se manifeste
constitue donc une forme embryonnaire d’accompagnement et se doit d’être
encouragée. Cela dit, il faut une guidance et un support plus continus,
davantage systématiques et structurés, pour parler d’un accompagnement au sens
où l’entendent les spécialistes.
Le Boterf (1993) définit à juste
titre l’accompagnement comme une fonction pédagogique visant essentiellement à
aider la personne accompagnée à nommer ce qu’elle fait et à identifier les
problèmes qu’elle rencontre dans sa pratique, à la mettre en relation avec des
ressources et des connaissances pertinentes aux problèmes rencontrés (ce que
St-Arnaud (1999) appelle la fonction de suppléance) et, finalement, à l’aider à
faire le point sur sa démarche et sa progression. Selon Lafortune et Deaudelin
(2001, p.199), l’accompagnement correspond à un soutien apporté à des personnes
en situation d’apprentissage «afin qu’elles puissent progresser dans la
construction de leurs connaissances». Dans le cas présent, il s’agit en
l’occurrence d’aider les débutants à progresser prioritairement dans la construction
des connaissances relatives à l’enseignement (préparation puis réalisation des
activités de formation, évaluation des apprentissages). Le soutien apporté
devrait en outre accélérer le développement de compétences nécessaires à
l’enseignement telles que développer et mettre en œuvre des stratégies
d’enseignement axées sur l’apprentissage et sur le développement des élèves
(CSE, 2000).
Le modèle d’accompagnement proposé
favorise le jumelage volontaire entre un enseignant expérimenté et un
enseignant débutant travaillant au sein d’un même établissement voire d’un même
département. Une telle dyade a beaucoup en commun et partage un grand nombre de
préoccupations. Dans tous les cas, il importe que les acteurs concernés se
choisissent et s’ajustent mutuellement afin que «le courant passe», qu’une
nécessaire confiance s’installe et qu’une certaine complicité soit possible.
Tout ceci implique une période préparatoire à la relation au cours de laquelle
plusieurs aspects sont discutés et négociés dans la recherche d’une
entente (par exemple, le moment, le lieu, la fréquence des rencontres, les
attentes réciproques, les priorités, etc.).
Le type de soutien apporté varie
suivant les contraintes et les aléas des situations auxquelles la personne
accompagnée est confrontée. Aux premiers temps de la prise en charge de la
tâche d’enseignement, nous avons remarqué que le débutant a tendance à
solliciter souvent l’enseignant expérimenté auquel il est associé pour valider
auprès de lui ses réalisations et ses décisions à caractère professionnel
(«C’est O.K. ou c’est pas O.K.?»). Les demandes formulées alors par le novice
appellent une réponse qui s’apparente à du «coaching» ou à du tutorat,
c’est-à-dire à une assistance professionnelle de type directif : conseils,
suggestions, etc. On est encore loin ici d’un travail réflexif sur la pratique.
Cependant, tôt ou tard, il faudra bien y arriver puisque l’analyse de l’action
réelle en contexte d’enseignement constitue l’ancrage à partir duquel l’on
construit des connaissances et des compétences essentielles au métier de faire
apprendre. Cela dit, s’adonner à un travail conjoint touchant directement les
pratiques d’enseignement ne va pas de soi dans la plupart des milieux.
Pourtant, les enseignants, tant anciens que novices, ont tous quelque chose à
gagner en s’engageant dans un tel projet. Ils accepteront la proposition de
travailler systématiquement sur leurs pratiques dans la mesure où ils saisiront
le sens et la portée d’un travail collaboratif devant leur permettre d’améliorer
leurs pratiques.
- L’interaction entre collègues pensée en terme de codéveloppement
Payette et Champagne (1997)
définissent le codéveloppement professionnel comme une approche de formation
fondée sur l’idée que l’on peut «apprendre sur sa propre pratique, en écoutant
et en aidant des collègues à cheminer dans la compréhension et l’amélioration
effective de leur pratique» (p.8). Il s’agit, précisent-ils, d’élargir les
capacités de réflexion et d’action des acteurs impliqués en mettant «l’accent
sur le partage d’expériences, sur la réflexion individuelle et collective, sur
les interactions structurées entre praticiens» (id.); l’approche, ajoutent-ils,
«peut aussi favoriser la résolution de problèmes particuliers et la remise en
question de grilles d’analyse et de stratégies d’action» (ibid).
Dans cette optique, les collègues
qui se réunissent sur une base régulière, en dyade ou en petit groupe, pour
parler de leurs pratiques effectives, les confronter, en questionner ou en
approfondir un aspect, forment une communauté d’apprentissage étant entendu que
l’apport d’autrui ajoute aux efforts individuels; ainsi que le précisent
Payette et Champagne (id., p.26), «la réflexion individuelle reçoit alors une
variété d’éclairages qu’elle ne peut obtenir autrement». Ces auteurs ajoutent
que le travail pour améliorer une pratique «se fait par un long travail
d’objectivation (que favorisent) les échanges en groupe, les comparaisons
incessantes que chacun fait entre sa pratique professionnelle et celle des
autres, l’expression de ses pensées, de ses difficultés, de ses émotions, de
ses stratégies…» (ibid, p.24).
- Au cœur de l’interaction : les pratiques d’enseignement
Pour certains, la pratique
correspond à la «mise en application des manières de procéder relatives à un
secteur de l’activité humaine» (Dictionnaire actuel de l’éducation, 1993,
p.1007). Une telle définition cadre tout à fait avec la logique de la
rationalité technique et elle porte l’idée d’une conformité à un modèle idéal.
Elle apparaît cependant discutable en vertu d’une autre épistémologie de la
pratique professionnelle proposée notamment par ceux qui travaillent sur les
traces de Schön et pour qui la pratique correspond non pas à une application
mais plutôt à une construction personnelle et sociale. Chacun élabore sa propre
pratique, dans un contexte donné, à partir de ses schèmes de pensée et
d’action, sur la base des connaissances dont il dispose, de son expérience et
de son propre cadre de référence (croyances, valeurs, représentations, etc.)
(Gélinas et Fortin, 1997). C’est la dimension personnelle du processus. La
pratique se construit aussi à travers les interactions sociales dans l’action sur le terrain, avec les élèves et avec les collègues,
dans un contexte où existent des normes, des règles formelles et informelles,
qui conditionnent les pratiques de chacun. C’est la dimension sociale du
processus. Enfin, la pratique s’enrichit, se régule et se transforme dans la
foulée des retours réflexifs, plus ou moins fréquents, plus ou moins
systématisés, que fait le praticien sur sa propre pratique (ce que Schön nomme
la réflexion dans et sur l’action). Cela constitue la
dimension réflexive du processus d’élaboration des pratiques.
Dans le modèle d’accompagnement
proposé, les enseignants impliqués, tant les experts que les novices, sont
invités à accentuer la dimension réflexive de leur agir professionnel et à
intégrer cette dimension dans la définition de leur identité enseignante. Être
un enseignant réflexif c’est prendre, de manière systématique, sa propre
pratique professionnelle comme un objet à connaître et à transformer pour
l’améliorer (en améliorer l’efficacité, dirait St-Arnaud, 1992). C’est,
minimalement, développer une pratique d’autoanalyse de ses interventions
professionnelles qui permet des apprentissages par l’action et favorise la
régulation et l’enrichissement de ses façons de faire en contexte réel
d’intervention. Pour cela, il faut d’abord s’intéresser à des situations
d’intervention vécues sur le terrain puis décider de s’y attarder pour les
analyser (Perrenoud, 2001). Ce travail sur ses pratiques d’enseignement en
contexte représente l’essentiel du travail en dyade préconisé dans le cadre de
notre modèle.
- Le travail en dyade : visées, stratégies et moyens
Dans notre modèle, l’autoanalyse
ainsi que la coanalyse, en dyade, des interactions et des expériences concrètes
vécues sur le terrain par le débutant occupe une place tout à fait centrale. Ce
travail est facilité par l’enregistrement d’interventions sur bandes
audiovidéoscopiques permettant de revoir en différé, autant de fois que
nécessaire, le film des événements tels qu’ils se sont produits en contexte,
sur le terrain. Autrement, ce travail se fait à partir de descriptions de
séquences d’action fournies par le débutant. Accompagnateur et accompagné, à
partir de l’observation systématique et
de l’analyse fine de «l’action effective» en contexte réel d’enseignement
(Vermersch, 1994), travaillent ensemble à l’identification et à l’interprétation
des forces et des points faibles de l’action ainsi qu’au repérage et à
l’analyse des ressources mobilisées et des problèmes rencontrés dans l’action.
Un tel travail est possible parce
que le débutant est sur le terrain, dans l’action, plongé jusqu’au cou dans l’expérience réelle de l’enseignement et
c’est à cette expérience réelle sur le terrain (structurée par des schèmes et
des modèles initiaux) que va s’accrocher l’accompagnement pour démarrer un
travail sur les pratiques d’enseignement du novice. L’enseignant expérimenté
est là non seulement pour initier le novice à l’analyse réflexive (une analyse
réflexive digne de ce nom) mais encore pour proposer au débutant des clés
d’interprétation fournies par son savoir d’expérience lesquelles constituent
des «paradigmes interprétatifs» (Perrenoud, 1994) qui permettent une lecture de
l’action effective impossible sans ce savoir d’expérience. L’enseignant
expérimenté a en effet acquis une sensibilité informée à l’égard des diverses dimensions de la pratique :
dimensions techniques et instrumentales et également éthiques, affectives,
symboliques… (Payette et Champagne, op.cit.). C’est à partir de cette
sensibilité qu’il peut partager avec le débutant les informations dont il
dispose et les connaissances qu’il a élaborées à travers son expérience. Dans
notre modèle, il est invité à le faire au moment opportun en fonction des
besoins concrets du débutant lesquels évoluent et varient dans le temps selon
les situations vécues par ce dernier. Sur la base des compétences qui sont les
siennes, le professionnel mature peut orienter le débutant dans des directions
prometteuses plutôt que de le laisser au prise avec la seule logique des
essais/erreurs et de l’apprentissage par tâtonnements successifs. Il peut en
outre le supporter au plan psychologique par une écoute active empathique et
par des encouragements toujours bienvenus (en soulignant notamment les bons
coups et les progrès réalisés).
Ainsi, l’accompagnateur participe
activement à la construction des connaissances et des compétences pédagogiques
du débutant pour que ce dernier puisse améliorer sciemment ses interventions
auprès des élèves. Ce faisant, on peut penser que le nocice va élaborer, plus
rapidement qu’il ne l’aurait fait s’il avait été laissé à lui-même, un savoir,
un savoir-faire et un savoir-être nécessaires à un enseignement de qualité.
L’interaction professionnelle nourrit aussi l’enseignant expérimenté notamment
parce qu’elle le conduit à voir des choses devenues habituelles avec le regard
«neuf» du débutant.
Les débutants ne sont pas complètement
démunis lorsqu’ils prennent en charge une tâche d’enseignement puisqu’ils
disposent d’un ensemble incorporé de schèmes de pensée et d’action leur
permettant d’agir en situation sans avoir besoin de délibérer longuement sur le
quoi dire et le comment faire. La réflexion dans l’action (au sens où l’entend
Schön) se fait donc en bonne partie de manière inconsciente à partir de cet
ensemble de schèmes incorporés que Bourdieu nomme l’habitus. Les débutants sont
aussi porteurs d’une représentation de l’acte d’enseigner qu’ils se sont forgée
à travers une longue fréquentation de l’école à titre d’élève. Cette
représentation est aidante dans la mesure où elle inclut une vision du comment
enseigner que les novices auront
tendance à reproduire puisque, c’est connu, chacun est porté à enseigner comme
on lui a enseigné. Les nouveaux enseignants n’agissent donc pas de manière
aléatoire mais, dès le moment où ils commencent à enseigner, ils mettent en
œuvre des modèles d’action (Bourassa, Serre et Ross, 1999) dont ils ne sont pas
nécessairement conscients. L’accompagnement, parce qu’il est fondamentalement
centré sur l’action du débutant, devrait précisément lui permettre de prendre
conscience des modèles implicites qu’il porte en lui et qui constituent pour lui le point de départ du
travail d’amélioration de ses pratiques.
Souvent, le débutant va choisir de
s’arrêter sur une situation qu’il a ressentie comme insatisfaisante. Avec le
support de son accompagnateur et à travers une interaction verbale avec celui-ci
conduite selon une logique de maïeutique, il s’appliquera d’abord à décrire le
plus fidèlement possible ce qui s’est passé et comment cela s’est passé dans
l’action. Il s’attardera, comme le suggére Vermersch (op. cit., p.44), à
détailler «le déroulement de l’action effective ou dimension procédurale de
l’action». Il examinera en outre l’intention qu’il poursuivait alors, dans
cette situation précise, de même que la stratégie qu’il a déployée pour arriver
à ses fins (St-Arnaud, op.cit.). Il questionnera son cadre de référence
(représentations, valeurs, croyances, etc.). Tout ceci devrait lui permettre de
dégager son modèle d’action en situation d’enseignement (par exemple :
comment il gère les interactions dans la classe, sur quelle base et dans quel
but). Il tentera alors de bien cerner ce qui fait problème («problem setting») et il envisagera des
hypothèses de solution afin de résoudre ledit problème («problem solving»). Dès que possible, il mettra à l’épreuve du
terrain l’une ou l’autre de ces pistes de solution pour en vérifier la valeur
en contexte réel d’intervention. Cela impliquera vraisemblablement de changer
quelque chose dans son modèle d’action et donc, de transformer ce dernier en
modifiant soit l’intention (qu’il juge par exemple irréaliste, après examen),
soit la stratégie (qu’il estime par exemple trop directive, après analyse) ou
encore, le cadre de référence sous-jacent à l’action (il comprend par exemple
qu’il doit adapter ses exigences en tenant compte des caractéristiques des
élèves). Parce qu’il souhaite faire mieux dorénavant dans une situation
semblable, il fournira l’effort que requière le changement.
À d’autres moments, ce sont des
situations satisfaisantes qui font l’objet d’une analyse dans une optique
réflexive. Schön (1996) insiste à juste titre sur l’intérêt d’un tel travail.
Pour ce faire, on suit à peu de chose près la démarche décrite ci-haut.
Cependant, l’analyse d’une situation satisfaisante conduit non pas à envisager
des solutions pour faire face à un problème mais permet plutôt au débutant de
formaliser un modèle d’action efficace. Cela est avantageux puisque ledit
modèle pourra, au besoin, être actualisé dans toute une famille de situations
comparables.
Ainsi, en vue d’améliorer la qualité
de ses interventions, de comprendre et d’enrichir ses modèles d’action en
construisant des connaissances pertinentes à l’agir professionnel d’un
enseignant et en développant des compétences pédagogiques, l’enseignant novice
est invité à se centrer non seulement sur ce qui fait problème dans son action
mais aussi sur ce qui semble efficace dans un contexte donné et à examiner les
possibilités de transférabilité d’un modèle d’action efficace à une famille de
situations comparables. Dans tous les cas, les clés d’interprétation fournies par
le savoir d’expérience de l’accompagnateur, le partage des idées entre le
novice et l’expert, la confrontation des façons de faire et des cadres de
référence (représentations, valeurs, croyances et connaissances de sens commun,
bagage théorique), sont autant d’opportunités d’enrichir les grilles de
lectures et donc les interprétations de chacun (tant pour le problem setting que pour le problem solving).
- Le travail en groupe d’analyse des pratiques d’enseignement :
visées, stratégies et moyens
Le modèle d’accompagnement mis au
point par notre équipe invite les accompagnateurs et les accompagnés à se
constituer en groupe d’analyse des pratiques pour compléter le travail réalisé
en dyade. Il y a en effet des limites aux apprentissages que l’on fait seul ou
à deux. Le groupe (entre quatre et huit participants idéalement) est une source
puissante de motivation (Payette et Champagne, 1997), un important lieu de
discussions sur la pratique professionnelle et d’interactions structurées
autour d’intérêts partagés relatifs à l’amélioration de l’intervention
éducative.
Une rencontre en groupe d’analyse
dure environ deux heures et elle s’organise autour de la présentation d’une
situation d’enseignement vécue par un enseignant débutant (un récit de pratique(s)).
La rencontre se déroule suivant une séquence qui est sensiblement toujours la
même. Cette séquence a été mise au point à partir de scénarios proposés par
Robo (2002) et par Payette et Champagne (1997). Avant de présenter une
situation de son choix, le novice formule d’abord ses attentes par rapport au
groupe de collègues présents (par exemple : aide pour l’analyse d’un
incident critique ou aide pour la recherche de solutions à un problème vécu
illustré par la situation décrite et racontée). Une fois la situation exposée,
les collègues posent des questions pour obtenir plus d’informations et plus de
précisions sur la situation présentée. Ce n’est qu’ensuite que l’on passe à la
période de discussions au cours de laquelle les uns et les autres sont appelés
à réagir en tenant compte des attentes formulées au départ : on échange,
on fait part de sa compréhension de la
situation, on s’interroge sur un aspect particulier, on suggère des pistes de
solution, etc. Pour boucler la séquence, la personne qui a présenté est invitée
à résumer en quelques phrases l’essentiel de ce que les autres lui ont «révélé»
et à partager, à chaud, ce que ces contenus lui apportent dans sa compréhension
de l’action vécue et ce qu’ils lui suggèrent comme pistes pour l’action à venir.
Le travail en groupe d’analyse se termine habituellement par un tour de table
au cours duquel chaque participant communique en quelques phrases ce qu’il
retient de la rencontre.
Après quelques rencontres, le groupe
trouve sa vitesse de croisière. Chacun est rassuré en constatant qu’il est
confronté à des défis, des émotions et des difficultés semblables à ceux que
rencontrent les autres collègues. La confiance s’installe entre les membres du
groupe. On se sent solidaire et on est content de rompre avec l’isolement
professionnel qui a longtemps caractérisé la condition enseignante. On partage
ses expériences et ses préoccupations. On vit la réciprocité. On constate la
richesse du travail collectif principalement, l’effet de système qui favorise
l’émergence d’interprétations et de pistes d’action impossible autrement que
par l’interaction professionnelle en groupe. À travers le travail réalisé en
groupe, chacun élargit ses capacités
d’action et de réflexion et se retrouve ainsi en mesure d’améliorer sa pratique.
Les débutants, pour leur part, sont amenés sans qu’il n’y paraisse à développer
une conception objectivée de l’enseignement, c’est-à-dire à se doter d’une
représentation fine, contrastée et nuancée des multiples dimensions qui
composent un travail d’enseignement. Cet important dispositif de construction
de connaissances et de développement de compétences contribue fortement (avec
la pratique réflexive) à l’élaboration d’une identité professionnelle
enseignante.
- Conclusion : une nécessaire formation à l’accompagnement
Accompagner un novice en
enseignement, au sens fort du terme, est quelque chose qui s’apprend. Au cours
des deux dernières années, dans le cadre de notre projet de
recherche-action-formation mené dans un cégep, seize enseignants expérimentés
se sont initiés à l’accompagnement et ont accompagné, au total, trente-trois
débutants en enseignement. Nous avons aidé les enseignants expérimentés à se
former pour l’accompagnement en privilégiant trois types complémentaires de
formation, vécus en synergie sur une période de plusieurs mois : la
formation par l’action, l’autoformation et la coformation.
De la même manière qu’on apprend à
enseigner en enseignant, nous sommes persuadés qu’on apprend à accompagner en
accompagnant. L’expérience est source d’apprentissage, avons-nous écrit
précédemment. En conséquence, des enseignants expérimentés (volontaires) ont
été jumelés à des débutants en enseignement (volontaires) et ont amorcé
l’accompagnement de ces derniers en même temps qu’ils débutaient des activités
d’autoformation et de coformation pour l’accompagnement.
Un guide de
l’accompagnement a été élaboré par l’équipe de recherche. Il s’agit d’un outil
pour assister la démarche d’auto-apprentissage dans laquelle s’engage
l’enseignant expérimenté devenu accompagnateur. Par sa structure, ses contenus
ainsi que les outils qu’il propose, le guide favorise l’appropriation du modèle
d’accompagnement préconisé en présentant et en explicitant, sous diverses
formes (textes, figures, tableaux), l’approche de codéveloppement professionnel
au fondement du modèle, les principales phases du processus d’accompagnement,
les stratégies et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le travail en
dyade et en groupe d’analyse des pratiques, les principaux concepts-clés tels
que l’analyse réflexive, le modèle d’action et ses composantes, la pratique
d’enseignement et la transformation d’une pratique en tant que processus, etc.
Le guide fournit en outre des fiches d’autoévaluation permettant de consolider,
de réguler et d’améliorer la qualité de son action effective en tant
qu’accompagnateur (connaissances et compétences).
Des rencontres
collectives ont été tenues sur une base régulière (aux deux ou trois semaines
sur une période de quelques mois) avec les enseignants en train de se former à
l’accompagnement. Des périodes d’échanges et de discussions ont permis de
clarifier des éléments de contenu présentés dans le guide. Les enseignants
expérimentés ont été initiés à l’analyse réflexive guidée et au travail en
groupe d’analyse de pratiques par des simulations. Du temps a été consacré à
des retours réflexifs sur l’expérience vécue sur le terrain en dyade avec un
débutant. Encore une fois, en cohérence avec notre cadre de référence,
l’apprentissage par l’action, le partage des expériences ainsi que la
confrontation des points de vue et des façons de faire, ont été favorisés.
Références bibliographiques
Bourassa, B., Serre, F. et Ross, D. (1999). Apprendre de son expérience.
Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.
Conseil Supérieur de l’Éducation (1997). Enseigner au collégial : Une pratique
professionnelle en renouvellement. Avis à la ministre de l’Éducation,
décembre 1997. Sainte-Foy : CSE.
Conseil Supérieur de l'Éducation (2000). La formation du personnel enseignant du
collégial: un projet collectif enraciné dans le milieu. Avis au ministre de
l'Éducation, mai 2000. Sainte-Foy: CSE.
Dictionnaire actuel de l’éducation (1993). Montréal/
Paris : Larousse.
Lafortune, L. et Deaudelin, C. (2001). Accompagnement socioconstructiviste.
Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.
Lauzon, M. (2001). L’apprentissage
de l’enseignement au collégial : Une construction personnelle et sociale.
Thèse de doctorat (inédite). Université du Québec à Montréal.
Le Boterf, G. (1993). L’ingénierie et l’évaluation de la formation. Paris : Les
éditions d’organisation.
L’Hostie, M., Sauvageau, J., Bouchard, I., Dôme,
J.-M., Robertson, A. (2002). Modèle d’accompagnement de la relève enseignante
au collégial, communication présentée au colloque Recherche collaborative : renouvellement des pratiques éducatives,
organisé par le Consortium Régional de Recherche en Éducation (CRRE), Hôtel Le
Montagnais, Chicoutimi, 12 avril 2002.
Payette, A. et Champagne, C. (1997). Le groupe de codéveloppement professionnel.
Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec.
Perrenoud, P. (2001). Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant.
Paris : ESF éditeur.
Raymond, D. et Hade, D. (2000). Module d’insertion professionnelle des nouveaux enseignants du
collégial (MIPEC). Document de travail, version 5, juin 2000. Sherbrooke : PERFORMA.
Robo, P. (2002). L’analyse de
pratiques professionnelles : un dispositif de formation accompagnante. Vie pédagogique 122 février-mars (7-11).
Schön, D.A. (1996). À la
recherche d’une nouvelle épistémologie de la pratique et de ce qu’elle implique
pour l’éducation des adultes, dans J.-M. Barbier, Savoirs théoriques et savoirs d’action. Paris : Presses
Universitaires de France (201-222).
St-Arnaud, Y.
(1999). Le changement assisté. Compétences pour intervenir en relations
humaines. Montréal : Gaëtan Morin
Éditeur.
St-Arnaud, Y, (1992). Connaître par l’action. Montréal : Les Presses de l’Université
de Montréal.
Vermersch, P. (1994). L’entretien d’explicitation. Paris : ESF Éditeur.
pp
p
Andragogie : science et pratique de l’éducation donnée aux adultes.
Assertivité : capacité et compétence de quelqu’un qui dit « je ».
Attitude : organisation émotionnelle, motivationnelle, perceptive et cognitive qui
conduit un individu à réagir positivement ou négativement.
Charte : ensemble de principes fondamentaux formalisés par accord entre des
parties.
Congruence : selon Carls Rogers, capacité à être présent au monde et, en
particulier, capacité à se référer à son vécu et exposer à l’autre la structure
de sa personnalité.
Contrat : accord volontaire entre deux ou plusieurs personnes et faisant naître
des obligations entre elles.
Dispositif : ensemble de mesures, de moyens agencés en vue d’un but précis.
Empathie : percevoir avec précision le cadre de référence interne d’autrui, comme
si on était la personne elle-même, mais sans oublier qu’on est un autre.
Extériorité : position du monde extérieur qui s’oppose à l’intimité de l’individu.
Groupe Balint : espace de parole, possibilité de formation qui permet d’intégrer la
dimension relationnelle et de rechercher de quelles ressources l’on dispose
dans la sphère professionnelle. Le premier groupe Balint réunissait douze
médecins une fois par semaine pendant deux heures durant plusieurs années. Il
proposait un « séminaire de discussion de groupe sur les problèmes liés à
l’exercice de la pratique médicale ». Il s’agissait de s’inspirer de la
méthode analytique de la libre association pour donner la parole aux médecins
sur leur travail professionnel.
Modalité : forme particulière sous laquelle se présente une chose, un phénomène.
Multiréférentialité : utiliser, en les combinant, divers angles d’approche pour comprendre
une situation.
Posture : attitude morale de quelqu’un. Synonyme : comportement.
Praxéologie : science ou théorie de l’action ; connaissance des lois de
l’action humaine conduisant à des conclusions opératoires.
Zone proximale de
développement : « distance entre le niveau de développement actuel tel qu’on peut
le déterminer à travers la façon l’enfant résout les problèmes seul et le
niveau de développement potentiel tel qu’on peut le déterminer à travers la
façon dont l’enfant résout les problèmes lorsqu’il est assisté par l’adulte ou
collabore avec des pairs plus avancés. » (Vygotsky)
Zone proximale de
rencontre : personne n’est au clair sur ce concept né à Mèze, autour d’une table
(de mensa, latin). L’influence tellurique du mont Saint-Clair, au bord de
l’étang de Thau, nous rend optimistes sur sa prochaine définition.
p
p p
"Vois-tu,
la seule révolution possible, c'est d'essayer de s'améliorer soi-même en
espérant que les autres fassent la même démarche. Le Monde ira mieux alors." Georges
Brassens
"Si
le métier de formateur recelait des solutions miracles qui fonctionnaient à
tous les coups, on le saurait !"
Jean Donnay et Evelyne Charlier
"C'est
nouveau…. ça vient de sortir."
Coluche
"Plutôt
que de lui donner le poisson, apprends-lui à pêcher" Proverbe
Chinois
"Savoir
être là"
"Etre pris dans une énigme"
"
Etre intelligent dans les situations singulières"
"Construire
des connaissances à même le vivant"
"Restituer
à celui qui est tellement engouffré dans le présent son rapport à un passé et
un futur"
"Etre
fiable"
"Accepter
l'incertitude"
"Aller
avec"
"Etre
à côté de"
"Donner
une place à l'autre"
"S'éloigner
de la prise de pouvoir qui peut advenir si facilement"
"On
écrit un accompagnement à la première personne et on y intègre un
"tu" ou un "vous". L'auteur y est donc invariablement un
"nous"." Mireille Cifali
"Mieux
vaut être seul que mal accompagné."
Pierre Gringore
"On
ne se sent bien dans un groupe que dès lors qu' on s'y sent utile." Charles
Macio
"Le
chemin se construit en marchant." "El camino
caminente" Antonio Machado
"Donner
du temps au temps." François Miterrand
"L'empathie
… consiste à percevoir avec précision le cadre de référence interne d'autrui,
avec les composantes émotionnelles et les significations qui s'y attachent,
"comme si" on était la personne même sans jamais perdre de vue le
"comme si"…" Carl Rogers
"Si
je me mets à la place de l'autre où est-ce qu'il va se mettre ?" Jacques
Lacan
"La
réponse est le malheur de la question." Maurice Blanchot
Le
poids des mots. "Ils sont si légers pour celui qui les jette, si lourds
pour celui qui les reçoit. La flèche est partie, déjà tu regrettes. Elle s'est
plantée au fond de moi." Guy Béart
"Il
faut poser une fin à l'accompagnement." Gérard Wiel
"C’est dans l’air du temps"
"Tout être humain est langage humain
et toute expression sourd de son individualité laquelle est toujours ordonnée
par d’autres s’ils l’accueillent en humain, par des paroles qui l’honorent" Françoise
Dolto
"Ce n’est qu’un début, continuons le combat." Coluche
"Quelqu’un parlant à d’autres peut
entendre des choses qu’il ne sait pas de la/sa situation" René
Bajet
"Pour y voir clair, il faut d’abord
s’entendre" Jacky Beillerot
"Nécessité » d’un langage commun
pour travailler ensemble" Philippe Meirieu
"Le vrai voyageur ne sait où il va." Lie Tseu
p
p p
ALTET M., PAQUAY L., PERRENOUD P, Formateurs d’enseignants ; Quelle
professionnalisation ?, Bruxelles, de Boeck, 2002
Aumond-Berlencourt
C., Innovez ! de l'injonction à
l'accompagnement organisé, ESP, 1992.
BOUVIER
et OBIN, La formation des enseignants sur
le terrain, Paris, Hachette.
CHAPPAZ
G., (sld) Accompagnement et formation, Marseille, CRDP et Université de
Provence, 1998.
CHEVALIER
L, Classes laborieuses et classes
dangereuses, Librairie générale française, 1978 réédition
CRESAS, On n'enseigne pas tout seul, INRP, 2000.
DENNERY
M., Organiser le suivi de la formation ;
méthodes et outils, Paris, ESF, 1997.
DEVELAY
M., Peut-on former les enseignants ?,
ESF, Paris, 1994
DONNAY J.
et CHARLIER E, Comprendre des situations
de formation, Bruxelles, de
Boeck, 1991
DUCROS P.
et FINKELSZTEIN D., L'école face au
changement, Grenoble, CRDP et MEN, 1986.
IMBERT F., «Le groupe Balint, un
dispositif pour un "métier impossible" : enseigner» in BLANCHARD-
LAVILLE C. et FABLET D., L'analyse des
pratiques professionnelles, nouvelle édition revue et corrigée, Paris,
L'Harmattan, 2000.
LE BOTERF
G., L'ingénierie et l'évaluation de la
formation, Paris, Les éditions d'organisation, 1993.
LE
BOUEDEC G. et al., L’accompagnement en
éducation et formation, Un projet impossible ?, Paris, L’Harmattan,
2001.
LES ACTES
DE LA DESCO, Analyse de pratiques
professionnelles et entrée dans le métier, CRDP Versailles, 2002
Paquay,
L., Altet, M., Charlier, É. et Perrenoud, Ph. (dir.), Former
des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ?,
Bruxelles, de Boeck, 1996
PERRENOUD P, Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant, Paris, ESF, 2001
ROGERS C,
Liberté pour apprendre, Dunod, 1996
ROGERS C,
Le développement de la personne, Dunod,
1996
WIEL G., Sortir du mal-être scolaire - Promouvoir la
fonction accompagnement, Saint-Etienne, Chronique sociale, 2000.
Revues
Cahiers pédagogiques N° 346
09/96 Analysons nos pratiques
professionnelles
Cahiers pédagogiques N° 390 01/01 Peut-on naître "conseiller" pédagogique?
Cahiers pédagogiques N° 393 04/01 Accompagner, une idée neuve en éducation
Vie pédagogique N°
122 février / mars 2002 Dossier: Des
classes, des écoles et des commissions scolaires en marche
Vie pédagogique N° 123 avril / mai 2002 Dossier: Les compétences : un premier regard sur le
comment
 COMMENT PRESENTER
UNE NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
COMMENT PRESENTER
UNE NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
Extrait de :
ROUVEYRAN (J-C.), Le guide de
la thèse, le guide du mémoire, Paris,
Ed. Maisonneuve et Larose, 1999.
Ecrire dans
l'ordre et en respectant le style :
1. NOM (Prénom ou Initiale),
2. Titre : sous-titre,
3. Numéro d'édition,
4. Lieu d'édition, Nom de
l'éditeur, date d'édition,
5. Nombre de volumes, nombre
de pages en chiffres suivi de p.
6. (Nom de la collection ; numéro dans la
collection.)
ex : GRAWITZ
(Madeleine), Méthodes des sciences
sociales, 10e éd., Paris, Dalloz, 1996, 920 p. (Précis Dalloz Science
Politique.)
[dans cet ouvrage, des
conseils pratiques rédigés par P. Robo, pour utiliser le traitement de texte au
service du mémoire, de la thèse]
p
p p
|
AGSAS
|
Association des Groupes de Soutien au Soutien (groupes
d’accompagnement initié par Jacques Lévine)
|
|
Adsl
|
Internet haut débit
|
|
Ais
|
Adaptation et Intégration Scolaire
|
|
CPC
|
Conseiller Pédagogique de Circonscription
|
|
CRAP
|
Cercle d’Actions et de Recherches
Pédagogiques (qui édite les cahiers
pédagogiques)
|
|
Cafipemf
|
Certificat d’Aptitude aux
Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Ecoles Maître-Formateur
|
|
cd-iufm
|
Conférence des Directeurs d’IUFM
|
|
Cea
|
Commissariat à l’Energie Atomique
|
|
Crac
|
Centre Régional d’Art Contemporain
|
|
Csp
|
Conseil Scientifique et Pédagogique
|
|
Dafpi
|
Délégation Académique à la Formation des
Personnels et Innovations
|
|
Fc
|
Formation Continue
|
|
Fi
|
Formation Initiale
|
|
GEAPP
|
Groupe d’Entraînement à l’Analyse de la Pratique
Professionnelle
|
|
Gap
|
Groupe d’Analyse de Pratiques
|
|
Gap-ft
|
Groupe d’Analyse de Pratiques - Formation
Transversale
|
|
Gap
|
Groupe d'Approfondissement Professionnel (initié
par André De Peretti)
|
|
Gapp
|
Groupe d’Analyse de Pratiques Professionnelles
|
|
Geapp
|
Groupe d’Entraînement à l’Analyse de Pratiques
Professionnelles
|
|
Gease
|
Groupe d’Entraînement à l’Analyse de Situations
Professionnelles
|
|
Gfa
|
Groupe de Formation-Action
|
|
Gfapp
|
Groupe de Formation à l’Analyse de Pratiques
Professionnelles
|
|
Gsas
|
Groupe de Soutien au Soutien
|
|
IUFM
|
Institut Universitaire de Formation des Maîtres
|
|
Ime / ir
|
Institut Médico-Educatif/ Institut de Rééducation
|
|
Irts
|
Institut Régional des Travailleurs Sociaux
|
|
Miam
|
Musée International des Arts Modestes
|
|
Rep
|
Réseau d’Education Prioritaire
|
|
Sasco
|
Séminaire d’Analyse de Situations de
Communication
|
|
T1
|
Titulaire 1ère année, 2ème année, x années
|
|
Tlfi
|
Trésors de la Langue Française Informatisée
|
|
Tr - Trbd
|
Titulaire Remplaçant-…Brigade Départementale
|
|
Zil
|
Zone Intervention Localisée
|
|
Zpd
|
Zone Proximale de Développement
|
|
Zpr
|
Zone Proximale de Rencontre
|
p
p p
LES HUÎTRES
GRATINÉES
J Pocher les huîtres avec
leur coquille dans de l'eau froide ;
 J Retirer les huîtres de
l'eau juste avant ébullition ;
J Retirer les huîtres de
l'eau juste avant ébullition ;
J Retirer le couvercle de
l'huître et réserver.
Sauce Rouille :
J Faire une mayonnaise et y rajouter du safran .
Sauce à la crème :
J Faire réduire des échalotes
dans un fonds de vin blanc ;
J Ajouter de la crème fraîche liquide ;
J Saler, poivrez ;
J Laisser réduire pour épaissir la sauce.
J Dans l'huître, mettre une
cuillère à café de sauce rouille et napper de sauce crème ;
J Saupoudrer de chapelure ;
J Mettre
à four très chaud pour dorer ;
J Servir chaud.
Recette aimablement communiquée par le Chef du
centre Thalassa.
Dégustation
Nom
latin : Microcosmus sulcatus Fam :
Pyuridés
Ce curieux animal dont l'aspect se rapproche de
celui d'une pomme de terre ridée constitue un met très prisé sur le littoral
méditerranéen. Habitat : Le violet vit
fixé sur des fonds sablonneux ou rocheux, en se confondant avec son
environnement.
Biologie : Le violet se nourrit de particules en
suspension amenées par l'eau qu'il filtre. Il est hermaphrodite mais il ne peut
émettre simultanément spermatozoïdes et ovules. Les larves, planctoniques, ont
un aspect de têtard; elles ne nagent que quelques heures, puis tombent sur le
fond où elles se fixent.
Le nom microcosmus
vient du latin et veut dire "petit monde" : en effet la surface de
l'animal est toujours recouverte d'un grand nombre de petits organismes
(éponges, vers, etc.).
Deux espèces sont commercialisées : microcosmus sulcatus (syphons couleur
rose clair) et microcosmus sabatieri
(siphons rayés de bandes rouges).
Sources : La vie au
bord de mer. Guide ARTHAUD.
QUESTION 1
Est-ce le Sulcatus ou le Sabatieri qui a été dégusté
lors de la première session du stage ?
QUESTION 2
Quelle est l'appellation locale du violet ?
Réponses :

p
p p
C'ETAIT LE REPAS COOPERATIF
DE LUNDI
En direct des quatre coins de
l’Aude
Le pâté de porc de chez lui
La fouace aux fritons et celle à l’anis mais de chez le boulanger
Le cassoulet de Carcassonne avec ses sept croûtes amoureusement cassées
La tomette des Corbières affinée au grenache mais qui fait toujours
béééé
Le fiadone (gâteau corse non explosif )
La Narbonnaise (galette briochée pliée et fourrée aux fruits confits
et les vins
les rouges : Minervois Mavingaut (éMAVINcentGAUThier), Roc
flamboyant de Fitou, Corbières : Hauterive de Boutenac
Les blancs : Côtes de Prouilhe
La Lozère a présenté à
l’assemblée
Les tartes aux cèpes
Le pâté de poulet (de course) aux cèpes
Le pâté de poulet (idem) aux figues
Les pâtés aux sangliers (un sanglier pour un pâté)
La confiture de châtaignes
Les mignons pélardons ronds, ronds de la ferme Issarte et ceux de la
ferme Resses
Les Pyrénées Orientales nous
l’ont joué à fond ethnie
La butifara blanca
La butifara negre
Le pa de fetges
Le fuet al roquefort.
Le Rivesaltes tuilé
Et le rouge du Roussillon villages
et …. exotique avec
Le Jurançon et le foie gras
Le cidre et les galettes bretonnes
Le Gard a cuisiné pour nous
Le lapin aux olives noires et aux cèpes (à manger chaud)
L’Hérault nous a offert
Le pain aux épices et la liqueur de verveine (slupp)
Le saucisson de Lacaune et le vin rouge de Fougère
Le pâté de porc en croûte
…sans oublier les huîtres du
bassin de Thau, les bijus et le Picpoul offerts par la Municipalité de Mèze.
p
p p
|
Département
|
Nom – Prénom
Adresse
|
Téléphone
Fax- mél
|
|
Aude
|
BAÏSSET Pierre
Ecole E. Zola
Chemin de Saint Salvaire
11000 NARBONNE
|
04 68 42 09 17
pierre.baisset@ac-montpellier.fr
|
|
Pyrénées-Orientales
|
BORRAT Christian
I.A P.O.
AIS Le Soler
Av. J.Giraudoux BP 1080
66103 PERPIGNAN Cedex
|
04 68 66 28 16
04 68 66 28 23
christian.borrat@ac-montpellier.fr
|
|
Aude
|
BOUCHE Sandrine
Ecole d'application
les Serres –
Rue des Etudes –
11000 CARCASSONNE
|
04 68 25 32 59
04 68 25 76 93
ecole.serres@wanadoo.fr
|
|
Pyrénées-Orientales
|
CENENT Patrick
I.A. Perpignan-Ouest BP 1080
Av. J.Giraudoux
66103 PERPIGNAN
Cedex
|
04 68 66 28 17
04 68 66 28 40
p.cenent@ac-montpellier.fr
|
|
Aude
|
COSTA Jacques
Ecole d'application des Serres
Rue des Etudes
11000 CARCASSONNE
|
04 68 25 32 59
04 68 25 76 93
ecole.serres@wanadoo.fr
|
|
Aude
|
COSTA Odile
Ecole d'application des Serres
Rue des Etudes
11000 CARCASSONNE
|
04 68 25 32 59
04 68 25 76 93
ecole.serres@wanadoo.fr
|
|
Aude
|
DELON Maryvonne
I.A. de
l'Aude - Carcassonne II
56, av
Henri Goût
11000
CARCASSONNE CEDEX 09
|
04 68 11 58 08
04 68 72 03 82
maryvonne.delon@ac-montpellier.fr
|
|
Lozère
|
DENIS Patricia
Ecole primaire annexe
Michel del Castillo
1, rue du Faubourg
Montbel
48000 MENDE
|
04 66 65 07 94
04 66 65 00 11
pat.denis-goutorbe@wanadoo.fr
|
|
Aude
|
FARNOS André
I.A. de l'Aude Narbonne I
1 ter, rue Felix Aldy
11100 NARBONNE
|
04 68 90 14 83
andre.farnos@ac-montpellier.fr
|
|
Lozère
|
FARRAN Dominique
I.E.N. Mende II
rue de Chanteronne
48000 MENDE
|
04 66 49 51 33
04 66 49 51 15
dominique.farran@ac-montpellier.fr
|
|
Lozère
|
GODE Philippe
I.D.E.N.
rue M.Boissier
48400 FLORAC
|
04 66 45 02
17
04 66 45 26
93
imfaien.florac@ac-montpellier.fr
|
|
Aude
|
MASCARIN Marie-Thérèse
Ecole annexe Isly Rue d'Isly
11000 CARCASSONNE
|
04 68 25 00
44
04 68 25 76
93
ecole.isly@wanadoo.fr
|
|
Hérault
|
RAMPLOU Annette
IE.N.Piémont
Héraultais
2, rue du
Vignal
34600
BEDARIEUX
|
04 67 95 15 67
04 67 95 98 43
annette.ramplou@ac-montpellier.fr
|
|
Aude
|
ROUGE-SOUILLARD Maryse
I.A. de
l'Aude Narbonne Rural
1 ter, rue Felix Aldy
11100
NARBONNE
|
04 68 90 14 85
04 68 32 71 92
Maryse.Rouge-Souillard@ac-montpellier.fr
|
|
Aude
|
ROUSSEL Jacques
Ecole d'application les Serres
Rue des Etudes 11000 CARCASSONNE
|
04 68 25 32 59
04 68 25 76 93
ecole.serres@wanadoo.fr
|
|
Aude
|
SAINT MARTIN Laury
Ecole annexe Isly Rue d'Isly
11000 CARCASSONNE
|
04 68 25 00 44
04 68 25 76 93
ecole.isly@wanadoo.fr
|
|
Pyrénées-Orientales
|
SALLEFRANQUE Valérie
Ecole Elém. d'application G. Dagneaux Bd Desnoyés
66000 PERPIGNAN Cedex
|
04 68 61 04 25
Primdagneau@wanadoo.fr
|
|
Aude
|
SOKOLOW Daniel
Ecole d'application les Serres Rue des Etudes
11000 CARCASSONNE
|
04 68 25 32 59
04 68 25 76 93
ecole.serres@wanadoo.fr
|
|
Aude
|
SOUM Claude
Ecole St Saëns
Rue Camille Saint Saëns 11000 CARCASSONNE
|
04 68 47 23 04
claude.soum@ac-montpellier.fr
|
|
Gard
|
TOURVIEILLE Jean-Louis
Inspection de l'éducation nationale
Circonscription Vergèze-AIS
60, rue Pierre-Semard
30000 NIMES
|
04 66 67 02 53
04 66 21 41 88
jean-louis.tourvieille@ac-montpellier.fr
|
|
Hérault
|
VIDAL Michel
Inspection Éducation Nationale
91, rue Bonaparte
34080 MONTPELLIER
|
04.67.75.56.50
04.67.75.56.50
michel.vidal@ac-montpellier.fr
|
|
Hérault
|
ROBO Patrick
I.U.F.M.
2, place M.
Godechot - BP 4152
34092 MONTPELLIER CEDEX 5
|
04.67.91.53.02
04.67.60.74.16
patrick.robo@montpellier.iufm.fr
|
ïcccGcccð
A suivre… vers la 2ème session !
 AIDE...................................... 9[6]
AIDE...................................... 9[6]
 REFLEXION...................................... 3
REFLEXION...................................... 3![]()

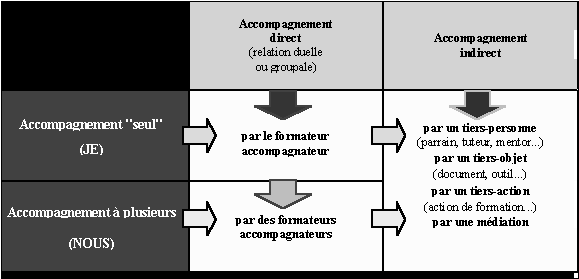
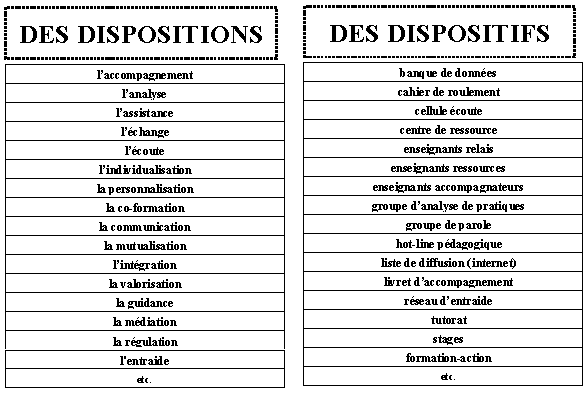

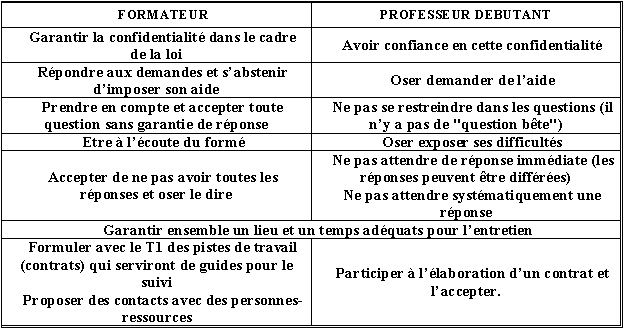


![]()
![]() au plan
personnel
au plan
personnel![]()
![]() cadre institutionnel projet
personnel
cadre institutionnel projet
personnel
![]() Construction
Construction
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()